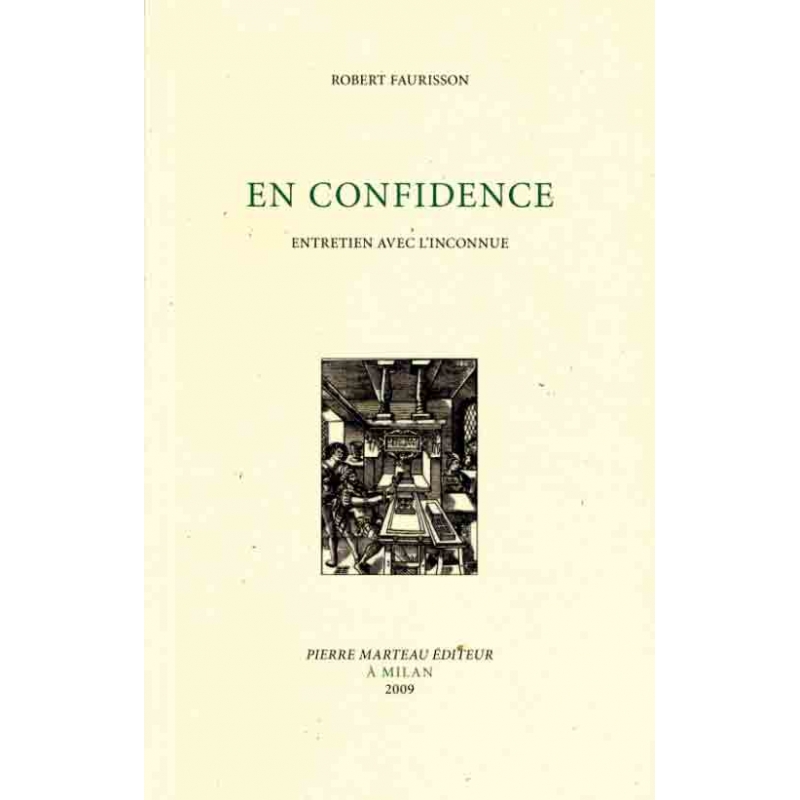En confidence – Entretien avec L’Inconnue [Maria Poumier]
En confidence, Pierre Marteau Éditeur à Milan, 2009, 80 pages – 10 €
L’Inconnue : Robert Faurisson, depuis bientôt trente ans, vous défrayez la chronique par votre opiniâtreté dans un combat solitaire pour des idées qui vous sont très personnelles et que nous ne commenterons pas ici ; elles sont suffisamment glosées ailleurs. Je vous propose de faire connaître au public d’autres facettes de votre personnalité, à partir de quelques images simples, violemment contrastées, qui se sont imposées et qui sont comme l’émanation de votre personnage public. En fait, vous jouissez d’une double célébrité : d’aucuns vous admirent pour votre refus de l’à-peu-près et pour la rigueur de votre méthode, qui leur est un sésame ; d’autres vous tiennent pour un dangereux prestidigitateur, réussissant à hypnotiser ceux qui acceptent de vous entendre. Les premiers voient déjà la plaque de la « Place Robert Faurisson » à Vichy, non loin de l’Allier et de la source des Célestins, devant le lycée où vous enseigniez Rimbaud aux jeunes filles – avant de passer à des plaisirs encore plus scabreux – ou près de l’endroit où trois gaillards ont entrepris de vous assassiner en 1989. Les seconds, dont se réclament vos assassins ratés, se démènent depuis bientôt trente ans pour vous envoyer en prison, au cimetière, ou à l’hôpital psychiatrique, sans y parvenir. Devant un destin aussi rare, par les surprenants excès que vous avez provoqués, on ne peut s’empêcher de vous tenir, de quelque bord que l’on se place, pour un être improbable, un Arsène Lupin, si vous permettez, une figure du mythe de l’évasion à répétition, qui nous nargue, le tout dans un cadre qui peut paraître ludique, bénin, puisqu’il n’y a pas mort d’homme. Votre passion a toujours été la littérature ; il n’est pas rare que le romanesque transfigure ses lecteurs ; c’est ce qui était arrivé à don Quichotte, à Madame Bovary et à bien d’autres. Je vais donc me permettre de vous traiter comme un personnage de roman, qui aurait été formaté par ses lectures ; vous appartenez à la légende avant que le roman de votre vie ait été écrit, certes, mais on pourrait en dire autant de bien des gens célèbres. M’autorisez-vous à vous traiter de la sorte ?
RF : Je « nargue », pensez-vous. « Narguer », c’est « braver, avec un mépris moqueur ». Pourquoi pas ? Toutefois ce que je brave ou que je défie de cette manière, le plus souvent ce ne sont pas des individus mais l’autorité ou le danger. J’aime à braver qui fait parade de son autorité et j’ai un certain goût du risque, même physique, puisqu’il se trouve que je suis porté à la hardiesse. Je ne pense pas faire montre d’arrogance mais parfois, devant la lourdeur, je cache mal mon accablement. Sans être pour autant un don Quichotte car je me crois dépourvu d’illusions, je sais que l’autorité que je défie l’emportera ; elle me brisera. Dans treize mois, j’aurai quatre-vingts ans. Mes juges accusateurs auront gagné. Les criminels du camp des vainqueurs l’auront emporté et ils riront de nous. C’est leur version de l’histoire qui s’imposera.
Dans le portrait somme toute flatteur que vous brossez de moi et dont je vous sais gré parce que je n’ai pas l’habitude de me voir ainsi traiter, je perçois déjà les éléments de la caricature que mes puissants adversaires dessineront de moi. Retenez que, dans mon tout dernier procès devant la XIe chambre de la cour d’appel de Paris, présidée par Dame Trébucq, les avocats des trois parties civiles se sont accordés à dire que le trait dominant de ma personnalité n’est rien autre que la lâcheté. La cour et le ministère public opinaient du chef.
Vous me parlez de « personnage romanesque ». Soit, mais a-t-on besoin de la fiction quand la réalité est là, si intéressante à débusquer et à rendre avec exactitude, même quand elle est sordide ? Les grands romans sont en réalité des chroniques ; le fait qu’il leur arrive de prendre une couleur romanesque, épique ou poétique n’y change rien. Des œuvres m’ont ému comme, par exemple, Les Perses d’Éschyle ou certains sonnets mystérieux de Nerval ou encore la trilogie allemande de Céline (D’un château l’autre, Nord, Rigodon) mais je n’en connais aucune dont je dirais qu’elle m’a formé ou, comme vous dites, « formaté ». Ce qui m’a formé, ce sont avant tout des événements de la vie réelle et non, je pense, mes lectures.
XXX : Dans les blagues qui circulent, on vous appelle Herr Zoolocauste, Docteur Frisson, Faufaux, L’Affreuxrisson, Norton Cru007 (par allusion à Jean Norton Cru, révisionniste de la Première Guerre mondiale, comme vous d’ascendance franco-britannique et, comme vous, universitaire)… Votre nom de famille Faurisson signifie-t-il quelque chose, en patois charentais, le berceau de votre famille paternelle ?
RF : Nous y sommes : des blagues. D’autres sobriquets encore me sont revenus aux oreilles. Je goûte l’ironie, la gouaille ou même le calembour et je sais que mes efforts peuvent prêter à rire. Trente années durant, je me suis démené en faveur d’une cause que je n’avais manifestement pas les moyens de faire triompher. Pour le spectateur, il peut être comique l’homme qui trébuche et puis qui, tel un pantin, se désarticule et tombe à terre mais je vous garantis qu’en pareille circonstance, me retrouvant le nez dans la poussière, je n’ai personnellement jamais ri.
« Faurisson » est un diminutif de « Faure », qui, comme « Fèvre », « Lefébure », désigne l’artisan (en latin, « faber ») ; je suis en ce moment même à mon établi.
XXX : Je reprends pour commencer les termes de François Brigneau, le premier qui vous ait consacré une biographie, sous le titre Mais qui est donc le professeur Faurisson ?, aux éditions La Sfinge, Rome, 2005. Il vous voit avant tout en détective; ressemblez-vous à Sherlock Holmes, le détective en robe de chambre, trouvant des indices là où d’autres ne voient que la normalité, pulvérisant les mensonges et les faux témoignages ou telle ingénieuse mise en scène d’un criminel ou encore des croyances reposant sur la notoriété publique ? Diriez-vous que la loupe est votre principal instrument de travail ?
RF : Cet opuscule est paru en 1992 aux éditions François Brigneau ; ce que vous mentionnez est une réédition. Oui, ma foi, l’hérédité écossaise aidant (ma mère, Jessie Hay Aitken, dite Jessica, est née à Edimbourg), je peux passer aux yeux de certains de mes amis pour une sorte de Sherlock Holmes en houppelande de voyage, traînant ses guêtres sur les lieux d’un crime supposé et, la loupe à la main, cherchant dans les coins et les recoins à distinguer le vrai d’avec le faux. Cependant, au cours de mes recherches je n’ai pas été un solitaire. J’ai consulté nombre de spécialistes en France et à l’étranger. Il est possible que certains me trouvent des airs de Nimbus mais je ne marche pas dans les nuages.
XXX : L’image d’Arsène Lupin m’était d’abord venue à l’esprit par votre capacité à rebondir ; après tant de procès, après avoir été condamné à payer tant d’amendes, de dommages-intérêts, de frais de publications judiciaires forcées et alors que la loi permet maintenant de vous coffrer, ce qui n’était pas possible auparavant, vous continuez à rendre fous vos adversaires, à ce qu’il semble.
RF : « Monsieur Faurisson, vous hantez mes nuits ! » m’a lancé en 1981 un avocat de la partie adverse, Bernard Jouanneau, que j’ai fait pleurer de désespoir en 1982 au terme d’une plaidoirie dont il avait lui-même fini par percevoir l’inanité sonore. En 2007, il a plus ou moins répété la formule. Vous allez croire que je me réjouis de rendre « fous » mes adversaires. Pas vraiment. Leur folie n’a pas besoin de moi pour se manifester. Elle me consterne. Quant à ma capacité à rebondir, le grand âge venant, elle s’en est allée. Je suis perclus. J’ai reçu trop de coups. J’évite pourtant de m’en plaindre. J’ai conscience de quelques réalités qui font que mon sort, comparé à celui de tant d’autres rebelles, est enviable : d’abord, je vis dans un pays de cocagne, la France ; ensuite, la République française est bonne fille, du moins quand elle n’est pas en guerre ou en guerre civile, que cette dernière soit franche ou larvée; enfin, je dois me rendre à l’évidence : jusqu’ici j’ai eu la baraka. Peut-être dois-je cette dernière chance au fait qu’en général je suis allé droit au danger et cela à tel point que l’adversaire en a été déconcerté et qu’il en a parfois, sur l’instant, perdu ses moyens de riposte. Parfois aussi, et ce n’est pas glorieux, j’ai pris la fuite à grands pas et mes poursuivants, manquant de souffle ou de conviction, ne m’ont pas rattrapé. Jusqu’ici, à la différence de tant de mes compagnons de route qui, hors de France, ont connu ou connaissent la prison, mon hérésie en matière d’histoire ne m’a pas valu un seul jour de prison sauf, bien entendu, avec sursis. On m’a pourri la vie et celle des miens, ce qui n’est déjà pas si mal. Les futés, les malins, ceux qui peuvent à juste titre me lancer à la figure : « Je ne suis pas fou (ou : folle), moi » vous diront peut-être : « C’est Faurisson qui s’est pourri la vie et qui a pourri celle des siens. Qu’il ne vienne pas se plaindre ! » Mais où ces gens-là prendraient-ils que je me plains ? Je constate la dure réalité et c’est tout.
XXX : La question des chambres à gaz et, par voie de conséquence, du nombre des victimes de l’Holocauste, tant juifs qu’Allemands et Palestiniens, est profondément tragique, et même vos ennemis ne sauraient vous reprocher de traiter le sujet à la légère, puisqu’ils considèrent que vous êtes non seulement un lâche, mais un individu pire qu’un assassin ordinaire, tout le contraire d’un humoriste, pour le moins. Votre ténacité donne de vous une image d’héroïsme tragique, même si vous tenez à faire savoir que vous connaissez des moments de faiblesse. Certains vous ont comparé à Giordano Bruno, dans le rôle du savant sur lequel s’acharnent les tribunaux, convaincus que ses théories mettent en péril leur autorité et l’équilibre de la société tout entière. Vous sentez-vous le Giordano Bruno de notre temps ?
RF : Accusé d’hérésie par l’Inquisition, Giordano Bruno a été incarcéré pendant sept ans ; puis, en 1600, il a été brûlé vif après d’affreux supplices ; on lui a arraché la langue, qu’il avait impie. Une trentaine d’années plus tard, Descartes en tirera la leçon : mieux vaut s’avancer masqué (« Larvatus prodeo »). Nous n’en sommes plus à ces formes de répression. Pour ma part, depuis trente ans, mes adversaires m’infligent une sorte de supplice chinois particulièrement vicieux dont je vous passerai les détails. Il y a là, je vous en préviens, de quoi briser un homme et sa famille. Voyez, à Lyon, l’affaire Bernard Notin : on commence par s’en prendre à vos animaux familiers, puis à vos enfants, à votre femme, à votre personne physique et au libre exercice de votre métier ; les chers collègues affectent de ne plus vous connaître et même, dans leurs assemblées délibératives, ils décident de vous sanctionner. Aucune vie sociale n’est plus possible. On vous chasse de l’université. Vous croyez trouver un refuge dans un pays lointain, sur un autre continent (l’Afrique) ; on vous y découvre et votre compte est bon. L’appareil de la justice et les médias ne vous laissent plus un instant de répit ; vous croyez trouver un avocat et vous tombez sur un arriviste et un faiseur qui, désireux d’apaiser la partie adverse et de se concilier les juges, vous fait signer votre abjuration : en pure perte, car la meute n’en clatit que de plus belle. Votre femme exige le divorce, vous perdez la garde de vos quatre enfants, et vous voilà contraint à l’exil (au Mexique) parce que la presse française vous a marqué au fer rouge. Tout cela pour prix de trois lignes timidement révisionnistes que vous avez réussi à glisser dans une obscure revue scientifique ; par le fait, cette dernière a précipitamment décidé de se pilonner elle-même et de rechercher dans toutes les bibliothèques les exemplaires de la livraison sacrilège afin de les détruire (par le feu ?). Une chasse aux sorcières révisionnistes se déclenchera ensuite dans les universités lyonnaises ; elle fera de célèbres victimes ; enfin, en juin 1999, un grave incendie détruira dans sa majeure partie la bibliothèque interuniversitaire soupçonnée d’abriter des ouvrages révisionnistes ; l’enquête de police commencera par découvrir qu’il s’agit d’un incendie criminel, puis, par un tour de main judiciaire, l’incendie sera décrété accidentel. Autorités politiques (Anne-Marie Comparini) et responsables médiatiques refuseront d’exiger des éclaircissements sur l’enquête en cours : l’affaire est étouffée. Le silence s’est fait sur cet incendie ; moi, je ne l’oublie pas.
Personnellement, il m’est arrivé de craquer ; mes proches et mes amis le savent. Puis, mes forces me sont en partie revenues et je suis remonté en ligne. Certains s’imaginent que les épreuves vous trempent ; ce n’est pas mon impression.
J’éprouve de l’indulgence pour les révisionnistes qui en sont venus à abjurer le révisionnisme mais je trouve détestables ceux d’entre eux qui, allant plus bas encore, se sont mis au service du camp adverse ou bien ceux qui se font gloire d’avoir été plus intelligents que tel révisionniste et plus fins tacticiens dans leur propre comportement face aux censeurs et aux juges. Ils se permettent alors d’en remontrer à celui qui a fait le sacrifice de sa tranquillité, sinon de sa vie.
XXX : D’un autre côté, au spectacle de votre entêtement et de celui de vos adversaires, absolument symétriques, on ne peut s’empêcher de trouver matière à rire. Je recopie par exemple les noms d’oiseau accumulés par Georges Wellers à votre endroit en 1987 : « La “star” française du négativisme […]. Un homme bizarre, extravagant, voire anormal […]. Un aveugle volontaire […] un faux savant cherchant la contre-vérité, rien que la contre-vérité, la contre-vérité à tout prix […], un ignare […]. Le fantaisiste ou le démagogue qu’est Faurisson […] un cas de confusion mentale qui relève de la compétence des psychiatres […] un cas d’impudence motivée par des raisons politico-financières […] incorrigible et sans scrupules […] un grotesque […] stupide et illettré […] ».
Voilà pour le premier camp, dont l’hystérie et les hyperboles sont hilarantes.
RF : Dans sa philippique, titrée « Qui est Robert Faurisson ? » (Le Monde juif, juillet-septembre 1987, p. 94-116), G. Wellers en a débité bien d’autres sur mon compte mais son intempérance lui a joué un tour. Emporté par son élan, il s’est pris à dénoncer également ce qu’il a appelé mon « instruction du niveau du baccalauréat, sinon au-dessous » (p. 111). Pour le coup, cette accusation m’avait intrigué. Depuis quelques années déjà, nous cherchions, Pierre Guillaume et moi, à savoir quels pouvaient bien être les diplômes universitaires de ce personnage au français approximatif et qui ne manquait aucune occasion de brandir ses titres, dont celui de « maître de recherches en physiologie au CNRS ». Lors d’un procès, la présidente d’un tribunal avait, à notre demande, tenté d’obtenir une réponse claire de l’intéressé. En vain. Par la suite, je décidais d’écrire directement à G. Wellers. Là encore en pure perte : dans ses réponses il esquivait la question et, à tout coup, excipait de son titre au lieu d’indiquer ses diplômes. Je pense qu’il ne possédait exactement aucun diplôme. Peut-être avait-il, tout au plus, entrepris quelques études scientifiques jusqu’à la licence (mais avait-il seulement obtenu cette licence ?) dans un coin obscur de l’Union soviétique au cours des années 1920. L’homme est mort en 1991. Paix à ses restes ! En 2007, son accusation à mon encontre semble avoir inspiré plusieurs amis ou témoins de Robert Badinter qui, à la XVIIe chambre, ont, sous serment, attesté de ce que j’avais usurpé mon titre de professeur d’université. La shutzpah de ces gens ne connaît pas de bornes.
XXX : Pour ma part, j’avoue que j’ai ri quand je vous ai vu saluer l’un des avocats qui vous persécutent depuis plus de vingt ans d’un très attentionné « Alors, cher maître, ça gaze, vos chambres à gaz ? », avec votre « â » appuyé, d’un français qui appartient à une autre époque. On a l’impression que le couple infernal que vous formez avec ceux qui vous honnissent aurait sa place chez Edmond Rostand ou chez Alfred Jarry. On peut même dire que vous êtes entré dans le répertoire comique des jeunes, puisqu’ils disent maintenant « gazer » quelqu’un, là où on disait autrefois « chambrer ». C’est une consécration indirecte, mais réelle, et les dictionnaires de la langue française devront en tenir compte !
Revenons au sujet. Cervantes a certainement été contaminé par sa créature quichottesque, tout le monde a reconnu Balzac dans Rastignac, Flaubert a proclamé « Emma Bovary, c’est moi » ; j’ai l’impression qu’en tant que créateur de personnages de comédie, dans les spectacles que constituent les audiences de vos procès, où vous semblez mener les acteurs et le public par le bout du nez, vous êtes aussi un peu Molière, le Molière qui est dans les coulisses, et le Molière sur scène. Mais comment appelleriez-vous le type psychologique et social que vous avez en quelque sorte façonné, comme condensé de vos adversaires, après Harpagon, Tartuffe, Alceste, le Malade imaginaire et tant d’autres ?
RF : Vous avez raison de dire que j’aime à me payer la tête des avocats de la partie adverse. Je vais parfois jusqu’à les remercier de l’indigence de leurs prestations. Mettez-vous à leur place : on leur demande de défendre une thèse indéfendable et de prouver que deux et deux font six. Étonnez-vous qu’ils évitent le sujet de fond et qu’ils recourent aux expédients du métier : effets de manches, de robe, de bouche, de poitrail, mines éplorées, airs outragés, émotions feintes. Ce qui les rend nerveux, c’est qu’ils savent qu’au terme de l’audience ils risquent de s’entendre décerner de ma part, à haute voix, une note assortie d’un jugement. Les représentants du ministère public ont le droit de ma part à un traitement identique. Quant aux juges, je leur dénie poliment le droit de me juger au nom d’une loi d’exception et il m’arrive de souligner leur incompétence en matière de recherche historique. Ils ne m’intimident pas. Si tel président s’autorise à manifester à mon égard une hostilité de principe, ou bien je n’y prête pas attention ou bien je lui demande de changer de ton, et il en change. Il est possible que l’assistance en ressente quelque gêne ou bien, à l’inverse, quelque plaisir. Moi, cela ne m’amuse pas. Je ne suis ni à la fête ni au théâtre.
Je comprends néanmoins que vous me parliez de théâtre, de comédie ou de roman. Mes adversaires me font l’honneur de me comparer au Méphistophélès du Faust de Goethe, « l’esprit qui toujours nie » (der Geist der stets verneint). Pour ma part, il advient que, leur rendant la politesse, je les décrive sous les traits de tel personnage de Molière (Gorgibus), de La Fontaine (Garo), de Fontenelle (Libavius), de Voltaire (Pangloss), ou de Céline (« l’Agité du bocal » [comme Sartre], « Dur-de-Mèche » [comme Malraux] ou « mon assassin mou, mon assassin d’escalier » [comme Roger Vailland]), quand ce n’est pas de Shakespeare ou de Cervantès tandis que mon avocat évoquera Courteline ou Anatole France. Mais vous avez raison : si je me mets à la place du spectateur de ces procès révoltants et grotesques, ce qui lui vient probablement à l’esprit, ce sont surtout les personnages de Tartuffe pour les juges, de Maître Bafouillet, avocat du sapeur Camember, pour certains avocats des pieuses associations et, enfin, de don Quichotte pour votre serviteur. J’ai parfois conscience du ridicule de ma situation : je ressemble au nageur qui a l’air de vouloir remonter le Niagara à la nage. Dans ces moments-là, serais-je lourd comme Candide ? Naïf comme l’enfant d’Andersen ? Inconscient comme don Quichotte qui, se précipitant au secours d’une colonne de forçats enchaînés, se fait copieusement rosser par ceux qu’il vient pourtant de libérer ? Après tout, le peuple allemand, dans son ensemble, ne me sait aucun gré de ce que je le défends contre une atroce calomnie ; selon toute apparence, il se moque du fait que les révisionnistes lui permettraient de s’abstenir d’une repentance qui n’a aucune raison d’être ; au contraire, Allemands et Autrichiens, dans leur ensemble, paraissent admettre la répression judiciaire et extrajudiciaire qui s’exerce contre le révisionnisme. Molière avait décidément tout vu et tout décrit du spectacle de la comédie humaine ; il paraissait s’en amuser mais il en souffrait ; il est mort dans son accoutrement de comédien. Dans le meilleur des cas, je mourrai à mon établi.
XXX : Dans la vie, ce sont les professeurs qui s’offrent le privilège de pouvoir jouer tous les rôles. Vous êtes de ces maîtres que recherchent les étudiants. Des personnes qui ont eu l’occasion de vous voir et de vous écouter et non pas seulement de vous lire ont pu distinguer en vous, à côté de l’érudit en certaines matières, un homme de scène, une sorte de virtuose dans ses prestations. Avec vous, on est parfois enclin à en redemander, du cours magistral, qu’on soit ou non d’accord avec vos prises de position ! Avez-vous le sentiment de dominer vos auditoires – et probablement aussi vos lecteurs – comme un professeur peut le faire face à ses étudiants ?
RF : Si le public me fait face, je peux juger de la portée de mes propos. Si l’auditoire se trouve dans mon dos, – et c’est le cas au prétoire, – j’en suis réduit à des impressions. Dans les deux cas, je pense que j’intéresse ou que j’irrite. Je note que les gardes du palais ou les gendarmes en faction qui me sont à portée de vue semblent s’intéresser à mes arguments, peut-être parce que, tout compte fait, je m’exprime moins en professeur qu’en enquêteur de police technique ou scientifique. Je connais mon affaire. Je vais droit au sujet et je m’exprime en français de France, sans fioritures, sans contorsions de langage, sans jargon, sans chiqué d’aucune sorte. Je recherche l’exactitude, la précision, la limpidité, ce qui ne signifie bien sûr pas que j’y parvienne toujours. Si je sens que je vais être conduit à employer un mot rare ou à user de notions délicates, je prépare le terrain de sorte que, le moment venu, l’auditeur pourra se féliciter d’avoir à peu près tout saisi. Le comportement soit des juges, soit du représentant (mâle ou femelle) du ministère public, soit de la greffière, soit des jeunes stagiaires, soit, enfin, des avocats me fournit des indications sur la marche à suivre et sur le tempo qu’il me faudra imprimer à la démonstration en cours. La plupart de ces gens de basoche, j’ai l’impression de les percer à jour. Je crois savoir lire dans leur pensée, et cela simplement parce que, quand ma prestation les déconcerte, ils ne parviennent pas à cacher leur désarroi. Sur le sujet de fond, ils découvrent leur ignorance et se retrouvent en potaches. Habitués à intimider, ils sentent que la situation leur échappe car il se trouve, en sus, que j’ai la chance de n’être pas timide ; j’ai tendance, en pensée, à dépouiller de leurs oripeaux les gens que je vois ainsi déguisés de robes et à me les représenter dans le plus simple appareil. Quant aux avocats des parties civiles, ils souffrent en silence ou à grands cris ; c’est selon. Le futur bâtonnier des avocats de Paris, Christian Charrière-Bournazel, en lève les bras au ciel : « Aucune chance, hélas, avec celui-là, qu’il devienne Alzheimer ! » ou encore : « Mais c’est incroyable ! D’où provient tant d’énergie ? » Et d’ajouter : « On est donc encore loin de la solution biologique ! » Deux nigauds, l’un journaliste et l’autre professeur de lycée, tous deux antirévisionnistes affichés, viennent de publier un livre où, évoquant l’un de mes plus récents procès, ils écrivent à mon propos : « C’est une bête de prétoire qui entre ce jour-là dans la XVIIe chambre, surchauffée par la canicule » (Michel Prazan, Adrien Minard, Roger Garaudy, Itinéraire d’un négationniste, Calmann-Lévy, 2007, p. 391). Allons donc ! Cette force qui m’anime est essentiellement celle que vous donne la défense d’une idée exacte ; elle n’est pas d’un forcené mais d’un homme qui, à la différence de ceux qui veulent sa perte, n’a pas besoin de mentir pour défendre sa cause. Soit ! Confessons que j’abuse parfois de cette position de force et que j’en profite pour chambrer la corporation mais, n’ayez crainte, quels que soient leurs systèmes respectifs de défense, les révisionnistes, à tout coup, payent la note finale ; cette note est écrite d’avance dans la loi Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990, une loi d’exception inspirée d’une loi israélienne de juillet 1986 et voulue, à l’époque, par le grand rabbin Sirat, Pierre Vidal-Naquet et Georges Wellers. Il s’agit d’une loi d’épuration de la pensée. Nos accusateurs sont purs et nous sommes impurs, intrinsèquement.
XXX : Franchement, je vous trouve, en un sens, aussi polisson que le Rimbaud que vous avez mis au jour, dans votre façon impitoyable de mener votre Bateau Ivre au milieu « des noyés, confiture exquise des poètes », car vous adorez noyer sous votre audace, vos arguments et vos documents ceux qui se risquent à vous contredire… Peut-être un libertin, même, qui explore toutes les voies, pour faire trembler sur leurs bases vos lecteurs, vos éventuels partenaires dans des jeux intellectuels interdits… Appréciez-vous le marquis de Sade ?
RF : J’ai autrefois tenté de lire Sade ; j’ai échoué ; il m’ennuyait. Je lui trouvais des airs de pédagogue de la cruauté et de l’égoïsme. La polissonnerie, en revanche, n’était pas pour me déplaire ; elle distrait, elle amuse, elle est inventive. J’en ai passé l’âge mais il m’en reste le pli. J’entreprends l’adversaire, je l’attire dans mes rets, je m’en joue quitte à m’attirer des coups de griffe et même plus. C’est un jeu, mais j’en ris de moins en moins.
XXX : En fait vous avez toujours été cruel avec vos victimes, à commencer par Étiemble, à qui vous avez mis le nez dans ses malhonnêtetés ; j’ose dire que vous avez été, par votre mise à nu de la fausse science de vos collègues professeurs de lettres, aussi professionnel qu’Isidore Ducasse, en somme, dans la mesure où il s’est moqué de ceux qui étaient prêts à le porter aux nues, parce qu’ils ont la vue très basse, et prennent facilement les vessies pour des lanternes ; il pratiquait, vous l’avez démontré, la sublimation parodique de la fenouillardise, et on peut se demander s’il n’attendait pas votre déchiffrement de sa cuistrerie sarcastique. Mais autant vous aimez Rimbaud, autant Isidore Ducasse et ses adorateurs comme André Breton semblent vous faire plutôt pitié…
RF : Parmi mes défauts avouables il y a une sévérité excessive ; en font principalement les frais les puissants du jour, les intellectuels qui jargonnent, les moralisateurs de tout poil, les donneurs de leçons, les fanfarons. René Étiemble, que j’ai pas mal étrillé en son temps, avait édifié sur le compte de Rimbaud un monument de sottise universitaire et d’esbroufe (il aurait dû lire Rimbaud avant de le commenter), mais au moins s’exprimait-il en français. André Breton, autre pape en son genre, aurait dû lire Les Chants de Maldoror, par le comte de Lautréamont avant d’y voir un proto-évangile du surréalisme ; il s’est fait « gasconner » par ce loustic d’Isidore Ducasse qui, pourtant, avait malicieusement glissé, tout à la fin de sa pochade, un avertissement à l’adresse du lecteur. Au dernier chant, il faisait dire au grotesque « comte de Lautréamont » aux « paupières ployant [sic] sous les résédas de la modestie » : « [Si je meurs,] je veux au moins que le lecteur en deuil puisse se dire : “Il faut lui rendre justice. Il m’a beaucoup crétinisé” ». Et il amorce la toute fin du livre avec une histoire de « queue de poisson », laquelle s’achève sur : «Allez-y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire» ; ce sont ses derniers mots.
Je n’aime pas trop Rimbaud ; je le trouve contraint, terriblement discipliné, mal dans sa peau, encore trop marqué par le thème latin, par les règles de la syntaxe classique ; dans sa révolte d’adolescent prolongé, il reste le fils du capitaine Rimbaud et de « la mère Rimbe » « aussi inflexible que 73 administrations à casquettes de plomb » ; je salue sa virtuosité d’enfant prodige mais c’est tout. Ducasse ne me fait pas pitié puisqu’il a réussi son coup et berné les gogos. D’André Breton il ne reste à peu près rien ; ce qu’on retient encore de lui se réduit à quelques rares poèmes de facture traditionnelle et à un récit d’inspiration autobiographique.
XXX : D’un autre côté je me demande si vous n’êtes pas aussi romantique que votre cher Nerval dans votre passion désespérée et absolue pour une idée unique, qui vous occupe entièrement, une vision, une abstraction, une Dulcinée que vous appelez la Vérité, et pour qui vous avez d’ores et déjà tout sacrifié, comme «le veuf, l’inconsolé».
RF : Nerval est sincère, son cœur est pur, son français est également pur. Nous lui devons ces joyaux que sont les poèmes des Chimères ainsi que les sonnets qu’on a groupés, après sa mort, sous le titre d’Autres Chimères. De tous les poèmes de la langue française, le plus beau me paraît être « Delfica », un sonnet dont je pense avoir déchiffré le sens et dont certains vers, en particulier, sont si prenants : « Reconnais-tu le TEMPLE au péristyle immense, / Et les citrons amers où s’imprimaient tes dents ? » ou : « Ils reviendront ces dieux que tu pleures toujours ! / Le temps va ramener l’ordre des anciens jours ; / La terre a tressailli d’un souffle prophétique… » ou encore : « Cependant la sibylle au visage latin / Est endormie encor sous l’arc de Constantin : / – Et rien n’a dérangé le sévère portique. » Dans ces confidences masquées, on ne dénote ni jeu ni pose. Nerval, Baudelaire et Rimbaud sont tous trois pathétiques mais, pour moi, le plus sincère et le plus touchant est Nerval. Baudelaire, par la puissance de son art, suscite parfois l’admiration ; Rimbaud, lui, est trop souvent hargneux et sarcastique ; il jetait sa gourme et il réglait ses comptes. Je tiens Hugo pour le plus grand écrivain français du XIXe siècle. Au XXe siècle, j’ai aimé, en dehors de Céline qui les dépasse tous, Apollinaire, Proust, Fourest, Larbaud et Michaux.
Ma Dulcinée est modeste ; elle n’est pas exactement la Vérité, surtout adornée d’une majuscule ; elle est la simple exactitude. Si j’étais un écrivain, je choisirais la prose ; je serais une sorte d’écrivain public qui recueillerait tous les éléments d’une vie tragique pour en faire un récit dont on pourrait vérifier le moindre détail ; j’en bannirais les effets de théâtre, le pathos, l’exagération ; Stendhal cherchait, disait-il, à rivaliser avec le Code civil ; je n’irais pas aussi loin ; je me contenterais de prendre pour modèle le rapport de gendarmerie, tout sec, circonstancié, méticuleux et j’essaierais de lui donner de la tenue.
XXX : Vous avez devancé ma question sur votre affinité avec Victor Hugo ; le rapport que vous entretenez avec lui, comme avec tous les écrivains que vous avez mentionnés, répond tout à fait à mon attente. Vous avez emprunté les rails sur lesquels je souhaitais vous voir vous élancer afin de sortir gaiement de la prison mentale dans laquelle vous a enfermé la concentration nécessaire à votre combat. J’espère que cette escapade buissonnière dans les belles-lettres vous est aussi agréable qu’à moi ; je vous voyais quelque peu corseté par votre entêtement, formant comme un couple inséparable, de type sado-maso, avec vos ennemis, dans des rôles, d’un certain point de vue, d’ailleurs interchangeables, et acculé comme eux dans une impasse. Continuons ce délassement, laissons-nous aller. Comme un vrai romantique, vous expliquez votre passage de la gauche de votre jeunesse à la défense des grands vaincus de la Seconde Guerre mondiale par l’attirance obstinée envers les perdants. C’est très beau, exaltant et généreux. Si l’Allemagne nazie avait gagné la guerre, vous porteriez-vous maintenant à la défense des démocraties judéo-centrées ? Vous aimez à citer l’éloge de Jeanne d’Arc par Joseph Delteil, un modèle d’écriture surréaliste, et, de ce fait même, violemment engagé à gauche, tendu par la révolte contre les conformistes et les frileux, les descendants de ceux qui ont voulu la mort de Jeanne d’Arc, celle qui ruait dans un jeu de quilles. Comment concevez-vous le rapport entre l’intellectuel et le peuple ?
RF : Je ne goûte pas trop le romantisme de celui qui « porte son cœur en écharpe » ; je préfère le romantisme de « la force qui va ». L’énergie, oui ; le dolorisme, non. Classique ou romantique, la littérature française ménage, par ailleurs, trop de place à l’amour. De ce point de vue, Racine, que j’admire pour d’autres raisons, est assommant ; et puis, aujourd’hui, la pilule a tué les tergiversations angoissées d’un Claudel sur le thème des « derniers engagements » et du « j’y va-ti, j’y va-ti pas ? ». Hugo souffre de défauts particulièrement voyants ; son emphase parfois et son côté « bouche d’ombre » agacent mais l’homme est complet et le monde qu’il a créé est complet ; tous les genres et tous les tons s’y trouvent. Quelle vigueur et quelle maîtrise ! Je reviens souvent à la lecture des Contemplations ; j’en ai su autrefois de longs fragments et, encore à mon âge, je m’en récite quelquefois de courts extraits, en marchant dans les parcs et les jardins de ma ville ; je me les scande, jazze ou slamme à la manière de « Grand Corps Malade ». J’en fais presque des vocalises, des variations, des fantaisies à la manière, en son temps, du Neveu de Rameau. Quant au théâtre, j’ai tendance à m’en éloigner. Les acteurs en font trop ; ils donnent dans « l’expressionnisme » à l’allemande ; c’est la grande mode : à fond la sono vocale et en se roulant par terre. Les rares fois où je me rends seul au spectacle, je loue un strapontin ou une place au fond de la salle pour pouvoir éventuellement m’éclipser. Or, en octobre 2003, rassemblant mon courage, je suis allé écouter un acteur de théâtre et de cinéma dont le jeu jusqu’ici me paraissait un peu trop appuyé. Il s’agissait de Philippe Noiret (tiens ! tiens ! un juif) récitant des extraits des Contemplations. Je n’ai pas regretté ma soirée : une merveille de justesse de bout en bout, depuis les poèmes les plus frais, drôles et moqueurs jusqu’aux plus poignants. Moi qui me méfie de la vie des écrivains ou, plutôt, de ce qu’on croit qu’a été leur vie, j’ai tenu, il y a bien longtemps, à visiter en pèlerin les maisons de Victor Hugo à Paris, à Villequier et à Guernesey. Moi qui n’apprécie guère qu’on en appelle aux bons sentiments surtout dans le domaine de la politique, j’ai encore maintenant l’envie de partir m’engager sous la bannière de Hugo quand, dans L’Homme qui rit, Gwynplaine, au visage déformé en un rictus pour plaire aux puissants, se lance, à la chambre des Lords, dans une vibrante défense de la cause du peuple. Vous le voyez, la force de Hugo nous oblige à sortir de nous-mêmes. Cette force, Baudelaire en a fait la remarque, s’accompagne de bonté et de charité ; « charité », voilà bien un mot passé de mode ; il désignait l’amour de Dieu et du prochain : Hugo aimait Dieu et son prochain. (C’est un athée qui vous parle ici). Reportez-vous à ce que nous dit Hugo dans la préface des Misérables sur la dégradation de l’homme par le prolétariat, sur la déchéance de la femme et sur l’atrophie de l’enfant. Je n’ai rien publié sur ses œuvres. J’ai pourtant fait sur « Booz endormi » ce que je pense être une jolie découverte ; j’ai écrit un papier là-dessus en collaboration avec un universitaire qui, peu d’années auparavant, avait été l’un des mes élèves, brillantissime, au Lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand ; je m’apprêtais à publier notre étude commune quand les journaux ont claironné mon « révisionnisme » : l’étude a été refusée par l’éditeur et l’ancien élève, qui aujourd’hui détient une chaire en Sorbonne, ne m’a plus donné signe de vie.
À propos du « romantisme » qu’il y aurait à défendre les grands vaincus de la dernière guerre mondiale, soyons clair. Parmi les pendus de Nuremberg, prenons le cas du plus méprisé d’entre eux : Julius Streicher, surtout connu pour avoir fondé et publié un hebdomadaire antijuif, Der Stürmer (dans le langage sportif, « l’avant »)[1]. Si je devais me faire l’avocat de Streicher, ce ne serait ni par « romantisme » ni par compassion mais par indignation. Son cas a été pathétique. Avant sa comparution il a été abominablement torturé. Il s’en est plaint devant ses juges. Le président du tribunal de Nuremberg a décidé, avec l’assentiment, s’il vous plaît, de Hanns Marx, avocat commis d’office et dont l’attitude vis-à-vis de son client a été indigne en maintes circonstances, de rayer du procès-verbal toute mention du récit de ces tortures mais le Times de Londres nous en a résumé la substance. Procureur adjoint des États-Unis au procès, Telford Taylor a publié en 1992 un livre dont je recommande la lecture, The Anatomy of the Nuremberg Trials / A Personal Memoir. On y voit comme le cas de Streicher à la fois le choque et le hante. Taylor n’était pas un tendre et, à ses yeux d’Américain, l’injustifiable procès de Nuremberg se justifiait mais, là, dans le cas de Streicher, sa surprise ou sa réprobation l’ont emporté et, à une dizaine de reprises, il les a exprimées en termes bien sentis. T. Taylor n’a pas fait l’apologie d’un antisémite ; il a clamé son indignation devant la pendaison – en fait la lente strangulation – d’un homme pour délit d’opinion, une opinion qui, en Allemagne, était pleinement légale. À l’époque, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, caricatures et écrits antisémites étaient, en principe, autorisés.
À propos de mes adversaires, vous pensez que je suis « acculé comme eux dans une impasse » et vous trouvez que nous pourrions, eux et moi, donner l’impression de former « comme un couple inséparable, de type sado-maso ». Je suis d’accord, hélas, avec vous sur le premier point. Nous sommes, eux et moi, dans une impasse : en matière de preuves vérifiables et solides, les révisionnistes ont entassé Ossa sur Pélion, mais ils n’en sont guère plus avancés sur les plans médiatique ou judiciaire. Leurs adversaires, en un premier temps, ont invoqué des preuves qui n’en étaient pas et ont tenté d’argumenter ; puis, en un second temps, constatant leurs échecs sur le plan du débat, il ne leur est resté, à partir de la fin des années 1990, que le recours soit à la violence judiciaire ou extrajudiciaire, soit à l’invective et au renforcement de leur propagande dans tous les azimuts. Quant à la relation de type sado-masochiste, elle n’est qu’apparente. C’est avec soulagement que nos adversaires verraient disparaître le révisionnisme et, pour ma part, si, un jour, les éminences juives se décidaient à reconnaître franchement qu’elles se sont fourvoyées sur quelque article de foi essentiel de leur Shoah (par exemple, l’existence et le fonctionnement de leurs magiques « chambres à gaz »), croyez bien que, pour ma part, dès le lendemain matin, je quitterais avec un soupir de soulagement la galère révisionniste. En 1988 l’universitaire juif américain Arno Mayer a reconnu que « les sources pour l’étude des chambres à gaz sont à la fois rares et douteuses. » Plusieurs années auparavant, Raul Hilberg avait déjà entièrement revu son histoire de « la destruction des juifs d’Europe » (version de 1961) pour concéder qu’il n’existait, en fin de compte, pas le moindre document attestant d’une politique de destruction de ces juifs. En 1983, lors d’une conférence, il lançait– ne riez pas ! – que cette prétendue politique de destruction, menée sans ordre, sans plan et sans budget, s’était faite « par suite [, au sein de la bureaucratie allemande,] d’une incroyable rencontre des esprits, d’une transmission de pensée consensuelle » ; puis, en 1985, dans l’édition « définitive » de son grand œuvre, il écrivait que cette même politique de destruction des juifs avait été accomplie « par suite [, au sein de la bureaucratie allemande] d’un état d’esprit, d’une compréhension tacite, d’une consonance et d’une synchronisation ». Ces merveilles, il ne nous les a jamais expliquées. Il faut dire que de telles merveilles inexpliquées offrent à Hilberg et à ses compères un avantage : elles « expliquent », si l’on peut dire, le fait que nous ne trouvons aucune trace matérielle ou documentaire, aucune preuve tangible de ce qui, au plein cœur de l’Europe, aurait constitué un hallucinant massacre aux proportions industrielles. Enfin, en 1995, Jean-Claude Pressac, l’affidé du couple Klarsfeld, jetant par-dessus bord tout ce qu’il avait lui-même écrit, s’est résigné à confesser à Valérie Igounet, auteur d’une Histoire du négationnisme en France (Seuil, 2000), que le fatras holocaustique était « pourri » et bon pour « les poubelles de l’histoire ». Au sortir de la guerre, le tribunal de Nuremberg, qui n’en était pas à une énormité près, avait considéré comme « preuve authentique » et interdit de contestation un rapport selon lequel les Allemands avaient fait, à Auschwitz, quatre millions de victimes. Par la suite, les travaux de Paul Rassinier (mort en 1967) et, à partir des années 1976-1980, les travaux d’autres révisionnistes, français ou étrangers, ont prouvé le caractère outrageusement mensonger de ce chiffre. Mais il a fallu attendre le printemps de 1990 pour que les autorités du Musée d’Auschwitz décident enfin que le chiffre de quatre millions de victimes n’était plus tenable. Encore la décision a-t-elle été tenue secrète (il serait intéressant de pouvoir accéder aux archives de l’affaire). En un premier temps, le chiffre mensonger a été discrètement effacé des dix-neuf stèles commémoratives qui, à l’époque, le reproduisaient. Puis, au terme de cinq années de tergiversations, elles aussi secrètes, le nouveau chiffre a été arbitrairement fixé à… un million et demi et, tel quel, il a été inscrit sur les dix-neuf stèles (aujourd’hui au nombre de vingt et une) ! Bien d’autres révisions à la baisse ont ensuite été officiellement admises : en 2002, Fritjof Meyer n’est-il pas descendu au chiffre de 510 000 victimes sans encourir de condamnation judiciaire ? Si, par extraordinaire, un beau jour, les tenants de la vérité officielle rééditaient ce genre d’audaces et si elles voulaient bien, par exemple, rendre vraiment publiques les révisions déchirantes de R. Hilberg, d’A. Mayer et, surtout, de Jean-Claude Pressac, je me retirerais du combat, quitte à voir certains de mes adversaires clamer que, décidément, l’humanité est redevable aux fils d’Israël d’une géniale découverte de plus : « Chambres à gaz hitlériennes et génocide des juifs n’ont jamais existé ! Il s’agissait d’une imposture montée de toutes pièces par des antisémites afin de discréditer les juifs ! ». Je m’empresserais alors, par exemple, de préparer une nouvelle édition de ma Clé des Chimères et Autres Chimères de Nerval (J.-J. Pauvert, 1977) avec, cette fois-ci, des illustrations remarquables de justesse, que je dois au talent de Françoise Pichard, alias « Chard » ; depuis des années, ce projet de publication et quelques autres projets du même genre s’empoussièrent dans mes archives.
Vous me voyez en « vrai romantique ». Je pense être un « vrai classique » mais à la manière moderne, celle de Louis-Ferdinand Céline, dont je partage les vues et les goûts en bien des matières.
Vous me demandez : « Si l’Allemagne nazie avait gagné la guerre, vous porteriez-vous maintenant à la défense des démocraties judéo-centrées ? ». Ma réponse est : fort probablement oui. Tout vainqueur définitif étant porté à l’excès (voyez le diktat de Versailles), il importe de veiller à ce qu’il n’abuse pas de sa position dominante.
À propos de Joseph Delteil et de sa Jeanne d’Arc[2], vous m’interrogez sur ma conception du rapport entre l’intellectuel et le peuple. Ma réponse se trouve dans Les Dieux ont soif, d’Anatole France. L’intellectuel, surtout s’il est de gauche, est porté à se pousser du col. Il en devient nocif, dangereux et pourvoyeur de guillotine. Il est beau parleur. Volontiers il vous soupçonne de n’avoir ni autant d’intelligence ni autant de cœur qu’il ne s’en attribue et il doit donc, pour l’amour du peuple, vous en punir et, au besoin, vous « raccourcir ». Je dis : « Méfiance ! Aux abris ! » Et puis sa lourde dialectique amène parfois l’intellectuel de gauche à se contredire avec un beau sang-froid. Voyez précisément Anatole France qui, après avoir publié ce roman historique en 1912, a, par la suite, plus ou moins approuvé le communisme moscoutaire. Je trouve l’intellectuel de droite généralement plus libre, plus tolérant (il n’est pas dans le vent !), doué de plus de talent et moins dangereux mais il a parfois tendance à croire en « l’élite » sans définir ce qu’il entend par là ; ce qui est suspect, c’est qu’il se classe lui-même dans cette élite-là ; ainsi que Molière le fait dire à Armande : « Nul n’aura de l’esprit hors nous et nos amis. » C’est ridicule. Que l’intellectuel de droite soit mis au ban des grands médias, je le déplore, mais le statut de réprouvé ne vous confère en soi aucune supériorité ni ne vous autorise à prendre la pose. En somme, la sagesse des auteurs anciens et de nos auteurs classiques aurait-elle, pour toujours et en tout domaine, raison sur le fond ? C’est à se le demander. Lisez, de Céline, les vingt pages de son Mea Culpa, publiées en 1937. J’en rendrais volontiers la lecture et la méditation obligatoires, surtout à nos prédicants de tout poil ; dans son genre, c’est du Bossuet.
XXX : En dehors de Proust, y a-t-il d’autres écrivains juifs que vous admiriez ? Kafka, par exemple, qui est un fabuliste, ne peut pas vous laisser indifférent…
RF : Au cours de mes recherches historiques, j’ai lu pléthore d’auteurs juifs. En littérature, c’est à peine si je connais Heine, Kafka, Max Jacob, Albert Cohen ou Pérec ; je n’en ai plus que de vagues souvenirs et je m’abstiendrai de vous confier mes impressions ; le peu que je connaisse de la littérature juive me met aussi mal à l’aise que la peinture juive. Prenez Chagall : un jour de 1988, visitant à Baden-Baden une exposition d’œuvres de peintres paysagistes, je suis tombé en arrêt devant un grand et superbe tableau de Chagall qui, je dois le dire, a, depuis lors, éclipsé dans ma mémoire tous les autres tableaux de cette riche exposition : il avait en son centre une sorte d’immense cercle (ou soleil ?) à la couleur bleue ou violette d’une éblouissante intensité. J’ai d’abord pensé que j’aurais aimé avoir chez moi une reproduction de ce tableau mais, à la réflexion, j’ai changé d’avis et j’ai éprouvé un malaise à l’idée d’installer ainsi chez moi, comme à demeure, une présence aussi obsédante et peut-être aussi malsaine que celle d’une tumeur cancéreuse grossissant à vue d’œil.
Prenez, par ailleurs, l’humour juif ; le monde du spectacle nous en livre à plein seau ; or je trouve que cet humour-là est le contraire du réel humour : sous les apparences de l’autodérision, on s’y admire, on s’y épate ; le juif y apparaît transi de bonheur au récit de son propre malheur, devant sa propre ingéniosité et son propre toupet, qu’il appelle shutzpah. Voyez, par exemple, l’histoire du jeune juif qui égorge son père, puis étrangle sa mère et finit par réclamer une pension d’orphelin. Là-dedans, nulle gaîté gratuite et sans victime, nul détachement mais une délectation malsaine. J’ai lu quelques œuvres de Kafka en traduction et je me souviens d’avoir vu une adaptation théâtrale du Procès : trop d’anxiété, de péché, de tuberculose, de haine du père ; trop d’inventions maladives comme le champion du jeûne, la machine à supplicier, le héros métamorphosé en bête immonde qui se repaît de saletés ou encore trop de ces juges sans visages. Les juges ont toujours un visage : là est le vrai drame. Cela dit, pour ce qui est de l’auteur, j’en garde le souvenir d’un homme sincère. C’est à lui, je crois, qu’on doit : « Dieu ne veut pas que j’écrive, mais moi je dois. »
XXX : Et Montaigne et Proust, qui, chacun à leur façon, ont dû vous séduire par leur perspicacité, par l’acuité de leur regard sur la vie intérieure et sur la société ?
Je reviens de temps à autre à Montaigne et je continue de lire Proust. Le premier est pour moi une énigme : comment pouvait-il à la fois voir la vie telle qu’elle est et l’aimer quand même ? Car il la voit avec une perspicacité de tous les instants ; rien ne lui échappe des horreurs de la création et surtout des hommes ; dans ce qu’il appelle ses « farcissures », il décrit « à sauts et à gambades » tout ce que l’humanité a pu inventer de bassesses, d’hypocrisies, de cruautés et, pourtant, il aime ses frères humains et il s’aime lui-même comme il faut, m’a-t-on dit, apprendre à s’aimer. Quand, à Paris, je passe devant sa statue du square Paul-Painlevé, entre le « Musée de Cluny » et la Sorbonne, je m’arrête pour une brève station ; j’y relis sa déclaration d’amour pour la ville de Paris. Il aimait cette ville, nous confie-t-il, « jusqu’à ses verrues et à ses taches » (ces derniers mots ne sont pas reproduits sur le socle de la statue). Nous y voilà donc : il faudrait avoir la force d’aimer Paris et la vie jusqu’à leurs verrues et à leurs taches respectives. Il y a là un degré de sagesse auquel je ne suis, pour ma part, jamais parvenu. Cela dit, Montaigne, réputé sceptique, croyait au mythe du bon sauvage ; il est vrai que cette admiration du sauvage lui permettait de mettre en accusation, non sans justesse et non sans l’éloquence du cœur, les conquérants de la très chrétienne Espagne. Il me fait ici songer à Tacite vantant d’autant plus les Germains qu’il cherchait par là, selon un procédé rhétorique bien connu, à mieux faire la leçon aux Romains, ses compatriotes.
Proust, lui, a construit un monde. Ce malade perpétuel avait une force de Titan. Céline a dénoncé « la très minusculisante analyse d’enculage à la Prout-Proust, “montée-nuance” en demi-dard de quart de mouche » et il faut convenir que sont exaspérants les commentateurs qui se pâment devant les préciosités de leur idole mais la puissance de l’auteur de À la recherche du temps perdu est indéniable et je crois qu’en dépit de la férocité de certaines de ses pages, sa lecture peut nous rendre plus humains. Imaginons un spécimen de l’actuelle génération estudiantine ; supposons-le matérialiste, épris de vitesse, de « mauvaise » musique et, en outre, incapable de lire posément plus d’une page de littérature. Offrons-lui une page, une seule, extraite du recueil intitulé Les Plaisirs et les jours ; cette page se présente comme un « Éloge de la mauvaise musique ». Elle commence par une invite qui déconcerte : « Détestez la mauvaise musique, ne la méprisez pas. » L’auteur vise ici, pour sa propre époque, « musique de café-concert ou musique de salon, romances de petite grisette ou de grandes cocottes, marches sans allure, ritournelles sans grâce » par opposition à la musique, si l’on veut, de Fauré. De cette « mauvaise musique » il écrit qu’elle s’est, bien plus que la bonne musique, remplie du rêve et des larmes des hommes et il ajoute : « Qu’elle vous soit par là vénérable. Sa place, nulle dans l’histoire de l’Art, est immense dans l’histoire sentimentale des sociétés. » Il conclut : « Un cahier de mauvaises romances, usé pour avoir trop servi, doit nous toucher comme un cimetière ou un village. Qu’importe que les maisons n’aient pas de goût, que les tombes disparaissent sous les inscriptions et les ornements de mauvais goût. De cette poussière peut s’envoler, devant une imagination assez sympathique et respectueuse pour taire un moment ses dédains esthétiques, la nuée des âmes tenant au bec le rêve encore vert qui leur faisait pressentir l’autre monde, et jouir ou pleurer dans celui-ci. » Reportez-vous au texte tout entier et vous verrez que le chemin à parcourir pour aller de la première à la dernière phrase de cette page est jonché de tant de pénétrantes observations et de tant de finesses d’expression que le lecteur, le pied et le cœur légers, parviendra au terme de sa lecture avec le sentiment qu’un enchanteur lui a fait découvrir un paysage qui lui était familier mais dont il n’avait pas su jusqu’ici discerner le charme. Par ailleurs, quelle leçon de tolérance et d’ouverture d’esprit puisque, aussi bien, l’auteur nous rappelle que, là où s’affichait le mépris général des connaisseurs (ici à l’endroit de la mauvaise musique), il y avait encore à apprendre et à respecter ! Mais permettez que je vous cite aussi, de Proust, un trait que je qualifierais de révisionniste. En 1919 le peintre Jacques-Émile Blanche (un descendant du Dr Émile Blanche et du Dr Esprit Blanche qui avaient soigné Nerval) publie ses Propos de peintre – De David à Degas. Proust en signe la préface. A un moment il en vient à évoquer la cathédrale de Reims, cette cathédrale, écrit-il non sans ironie, que « de sauvages Allemands aimaient tant que, ne pouvant la prendre de force, ils l’ont vitriolée [sic] ». Il ajoute : « Hélas ! je ne prévoyais pas ce hideux crime passionnel contre une Vierge de pierre, je ne savais pas prophétiser, quand j’écrivis La Mort des Cathédrales. » Sur quoi, il ajoute en note : « On peut aisément deviner que je n’ai pas attendu la défaite de l’Allemagne pour écrire ces lignes ; elles lui sont antérieures ; les gens qui crient “à mort” sur le passage d’un condamné me sont peu sympathiques, et je n’ai pas l’habitude d’insulter les vaincus. » Cette préface avait, en effet, été écrite sous sa première forme, nous dit-on, au printemps de 1918. Voilà de quoi méditer en 2007. Durant la Seconde Guerre mondiale quasiment toutes les cathédrales allemandes seront détruites ou phosphorisées par les vertueuses démocraties occidentales et, aujourd’hui, nul n’aurait l’idée, parmi nos belles consciences, d’aller nous dire qu’il est mal d’insulter les vaincus. Au contraire, dans nos écoles, les enfants apprennent à vilipender ceux qu’on a, d’autorité, stigmatisés du signe de Caïn et ils gagnent des bons points à insulter la mémoire de ces vaincus.
XXX : Dans l’un de vos écrits, vous avez raconté qu’en 1978-1979, quand « l’affaire Faurisson » a commencé à l’Université de Lyon, vos cours portaient précisément sur Proust ; des manifestants juifs, venus de Paris, ont, dans la pratique, obtenu que vous soyez interdit d’enseignement alors même que vous étiez en train d’expliquer à vos étudiants les motifs de votre admiration pour l’œuvre d’un auteur qui se trouvait être de père chrétien et de mère juive.
RF : Oui, en novembre 1978, c’est sur un cycle de cours consacré à une œuvre de Proust (le premier volume d’À la recherche du temps perdu) que s’était ouverte l’année universitaire. Je me souviens d’avoir invité mes étudiants à découvrir le tour de force que constituait tout ce début d’une œuvre monumentale. Hardiment, défiant toute précaution, l’auteur avait choisi pour entrée en matière une phrase qui présentait le risque d’inviter le lecteur au sommeil : « Longtemps je me suis couché de bonne heure. » Et, là-dessus, aggravant les risques d’endormir le lecteur, il se lançait dans une longue évocation de celui qui, s’étant ainsi couché de bonne heure, va soudain s’éveiller en pleine nuit et ne plus savoir exactement où il est. L’éveillé se trompera pendant quelques secondes sur l’emplacement réel des pièces du mobilier. Il lui faudra donc découvrir et recomposer un monde, celui de sa chambre à coucher, qui lui était pourtant familier mais qui s’était figé dans son esprit. Pendant un bref instant, remettant (ou se remettant) les meubles et les objets de sa chambre à leur véritable place, il assistera à la création d’un monde surgi de la nuit. Pour la première fois, il percevra, de tous ses sens éveillés, y compris l’odorat et le goût, mais non le toucher, ce que jusqu’ici il ne voyait qu’en esprit. Le début de ce premier volume, sous l’apparence du récit d’une banale expérience vécue, nous donne, comme en musique, le la de toute l’œuvre à venir : nous avions vécu en automates, nous avions perdu notre vie et notre temps ; or, comme dans une expérience « mystique », nous pourrions partir à la recherche de ce temps perdu et, qui sait, retrouver le goût, les saveurs, les couleurs, les accents et les formes de la vraie vie. Ce début ressemble non sans humour à la promulgation d’un « art poétique ». L’auteur s’y engage devant nous à retrouver ou à recréer, d’une manière à la fois lente et fulgurante, un temps et un monde que, pour sa part, il n’avait pas su voir, entendre et goûter dans toute leur complexité native et dans la fraîcheur de leur mystère. Il nous entraîne ainsi dans une aventure intime sans heurt, sans fracas mais qui est tout simplement magique, du moins pour celui qui a franchi les portes de corne et d’ivoire, autrement dit la porte des cauchemars et celle des rêves.
XXX : Elle est magnifique, cette façon de quitter votre personnage et d’entrer dans l’« aventure intime sans heurt » de Proust.
RF : J’entends parfois dire : « Faurisson est ailleurs ». Ajoutez à cela que si, à l’époque, je cherchais, devant mes étudiants, à m’expliquer le mystère de Proust, je m’efforçais aussi, en même temps, d’assouvir une tout autre curiosité, celle-là de nature historique. S’il est dangereux de n’avoir qu’une seule passion, il est également vain d’en entretenir une multiplicité ; deux passions au minimum seront nécessaires et suffisantes ; elles entreront en rivalité et vous prémuniront contre la monomanie. Bref, c’est à cette époque qu’à la suite de la révélation, par un folliculaire lyonnais, de mes travaux révisionnistes, s’est levée la tempête. On s’est chargé de me sortir de mes chères études et de me faire connaître le heurt et le fracas. J’ai alors vu de près la haine et la lâcheté. J’ai été pris en chasse jusque dans la rue, et puis interdit d’enseignement, de facto. À une ou deux exceptions près, des étudiants qui, je pense, auraient, en toute autre circonstance que celle d’une confrontation avec « les juifs », pris ma défense avec ardeur ont été saisis d’une peur panique, hideuse à voir, elle aussi. Le courage n’est pas aussi rare qu’on le dit parfois mais affronter la puissance d’organisations juives exige de l’héroïsme. Je ne connais pas de haine plus fiévreuse que la haine vétéro-testamentaire. Dans l’Allemagne vaincue, le tortionnaire juif s’en est donné à cœur joie. Venue des steppes de l’Est ou débarquée d’Amérique, la soldatesque s’est offert des bacchanales. Nos propres « résistants », nos « tueurs à la balle et au couteau » auxquels les juifs Druon et Kessel, auteurs des paroles du « Chant des partisans », disaient : « Tuez vite ! », ont eu droit à des journées franches. Ils ont tué, ou vite ou lentement. Ils ont souillé. Ils ont tondu, volé, violé, pillé. À de trop rares exceptions près, les responsables des armées occidentales ont laissé faire et ont eu l’aplomb de juger des vaincus dont les crimes réels étaient dérisoires par rapport à ceux de leurs vainqueurs. Et cela persiste encore en 2007. On ne cesse de tresser des couronnes aux vainqueurs et de pourchasser le vaincu, fût-il nonagénaire. On enseigne la haine, on l’entretient, on échauffe les esprits. On apprend aux jeunes gens à diaboliser. On leur fait croire que le Diable et le Bon Dieu existent sur terre : le premier se serait incarné dans le « Nazisme » et le second en « la Démocratie », y compris, à une certaine époque, en celle de Staline. C’est du catéchisme, du dressage, de l’éducation internationale pavlovienne à la Élie Wiesel ou à la Simon Wiesenthal. Le révisionnisme, lui, enseigne à douter, à réfléchir, à peser ; il ne croit ni au Bien ni au Mal absolus ; il relativise. Le révisionnisme est un humanisme. Cela n’implique pas qu’au moment de conclure sur ce qui s’est passé dans le monde entre 1933 et 1945 nous nous contenterons de tout relativiser ; avec la prudence qui est nécessaire pour trancher du vrai et du faux, nous essaierons de distinguer d’abord ce que, de part et d’autre, chaque camp aura fait pour éviter la guerre, puis, une fois la guerre déclenchée, ce que chaque camp aura pu accumuler soit en fait d’horreurs vérifiées, soit en fait de respect ou d’humanité à l’égard de l’adversaire. Libre ensuite à chacun de porter, en toute connaissance de cause, un jugement d’ensemble sur chaque belligérant en particulier et sur cette guerre en général.
XXX : Vous avez dit quelque part comprendre et admirer le geste de la femme de Goebbels, qui tua ses six enfants avant de recevoir la mort de son mari. Cela nous ramène à la grandeur tragique.
RF : On pensera bien ce qu’on voudra de la vie et de l’œuvre de Joseph Goebbels mais sa fin et celle de son épouse, Magda, sont dignes de la tragédie antique. Leur décision commune de tuer leurs six enfants par le poison a été le contraire d’un crime. Imaginez ce qu’aurait été le sort de ces jeunes orphelins dans les ruines de la Chancellerie envahies par la soldatesque de l’Armée soviétique. L’Europe tout entière était ivre de vengeance. En Italie, Mussolini, sa maîtresse et des responsables fascistes venaient tout juste d’être massacrés, puis pendus par les chevilles. Une fois dépendus, les cadavres avaient fait l’objet de traitements innommables, y compris de la part de mégères (comme à Tulle, en juin 1944, ces mégères françaises qui se seraient soulagées sur des cadavres de soldats allemands ; d’où les représailles qui ont suivi, par l’infamante pendaison et non par le peloton d’exécution). En plus de ce qu’ils auraient vu (les cadavres de leurs parents, en particulier), les enfants Goebbels auraient connu, pour le moins, les horreurs infligées à tant d’enfants de « nazis » ou de « collabos », même longtemps après la fin de la guerre. Il n’est pas jusqu’au sort réservé par les Norvégiens aux enfants nés d’une mère norvégienne et d’un soldat allemand qui n’ait été une ignominie. Si Médée a égorgé ses deux enfants, ce n’est que par jalousie amoureuse ; Euripide, Sénèque, Corneille, Anouilh, Pasolini nous ont donné à voir cette tragédie d’une mère aimante et amoureuse. Un jour peut-être le cas de Magda Goebbels inspirera un oratorio de caractère bien plus tragique encore car il s’inscrira dans un tout autre contexte, celui d’une histoire pleine de fureur où s’est englouti tout un pays, tout un continent. Aux sots qui mettent sur le même plan « les horreurs hitlériennes » et « les horreurs staliniennes », tellement plus monstrueuses en qualité et en quantité, je conseillerais la lecture d’un récent numéro de la très conventionnelle revue Histoire (octobre 2007) portant sur « Les crimes cachés du communisme », tels qu’ils se confirment à la lecture d’archives jusqu’ici inédites. Quant à ceux qui veulent se faire une idée aussi juste que possible des derniers jours vécus par Adolf Hitler et les siens, qu’ils évitent les reconstitutions filmiques à la Grand-Guignol comme La Chute et les témoignages « recueillis par X ou Y », y compris celui de Rochus Misch « recueilli » par un journaliste fantaisiste du Monde, Nicolas Bourcier, et qu’ils se procurent plutôt l’étonnant DVD du même Rochus Misch, Der letzte Zeuge ! (Le Dernier Témoin !). C’est diantrement solide et persuasif ; je crois qu’il en existe des versions sous-titrées en anglais ou en français.
XXX : Vous aimez rappeler le geste créateur d’Éschyle, qui tenait à réhabiliter, contre son public lui-même, les Perses, nobles et battus à plate couture par les Grecs. Trouvez-vous dans la littérature française des œuvres qui aient donné naissance à des mythes à la hauteur de gestes semblables ? (Personnellement, je n’en trouve pas ; les Espagnols ont inventé don Juan, les Allemands Faust, les Russes l’Idiot, mais nous, à part Gargantua…).
RF : En 472 avant notre ère Éschyle, qui a 53 ans, fait jouer Les Perses. Le héros de cette grandiose tragédie est Xerxès, roi de Perse, fils de Darius. Les Grecs ont d’abord vaincu Darius à Marathon, en 490, puis Xerxès à la bataille navale de Salamine, en 480. Éschyle a participé à ces deux batailles qui, pour lui, ont sauvé Athènes de l’occupation des Barbares. Il a nourri tous les préjugés des Grecs sur le compte des Perses. Il conservera une bonne part de ces préjugés lorsqu’il écrira sa tragédie mais, décidant de prendre pour héros Xerxès lui-même, il donnera néanmoins à son personnage une stature magnifique. Bien sûr, il nous dira que les dieux ont châtié ce dernier pour sa « démesure » (« hybris ») mais il le fera avec tant d’humanité et de compassion que, grâce à lui, les cris déchirants du roi vaincu ont traversé les siècles et témoignent encore aujourd’hui de la grandeur et de la misère de l’homme. Nulle haine, nul esprit de vengeance chez l’ancien combattant grec. On est là dans un tout autre registre que celui de l’Ancien Testament où le dieu des juifs se montre impitoyable non seulement envers les ennemis du peuple élu mais aussi à l’égard des juifs qui, négligeant ses injonctions, n’auraient pas massacré les vaincus jusqu’au dernier : malheur à l’Israélite qui aurait épargné un seul Amalécite ; le bon Israélite est celui qui tue le vaincu, le prisonnier, la femme, l’enfant et qui, parfois, se paie en réparations sur les biens de ceux qu’il a écrasés. Vous connaissez l’histoire d’Esther et de Mardochée : circonvenant Assuérus, roi de Perse (probablement Xerxès !), ces deux juifs parviennent à obtenir que le roi venge le peuple juif en faisant pendre son fidèle conseiller Haman et ses dix fils et en massacrant plus de 75 000 autres Perses. C’est cette tuerie qui, aujourd’hui encore, se célèbre chaque année à la fête de Pourim. Le saviez-vous, dans leur respect des croyances religieuses juives, les Iraniens, ces descendants des Perses, ont laissé s’édifier chez eux un imposant mausolée dédié à Esther et à Mardochée : situé à Hamadan, au sud-ouest de Téhéran, ce mausolée est l’un des centres de pèlerinage les plus importants du pays aussi bien pour les Iraniens que pour les étrangers. On est là, en fait d’ouverture d’esprit, à mille lieues d’une représentation hébraïque de la vie. « Là voilà, ma fête de Pourim 1946 », a justement lâché Julius Streicher au pied de la potence de Nuremberg. Ce n’est un secret pour personne que, dans sa conception même et dans sa conduite, le procès de Nuremberg a été essentiellement une mascarade judéo-américaine ; la délégation américaine était « à peu près à 75% juive » ; l’avocat général Thomas J. Dodd en a fait la remarque dans une lettre adressée à son épouse le 25 septembre 1945 et qui vient d’être rendue publique par leur fils. Mais, pour en venir à Klaus Barbie, qui lisait le grec dans le texte et comprenait parfaitement le français (en plus de l’espagnol), je me souviens de lui avoir envoyé dans sa geôle de Lyon, peu avant sa mort, un exemplaire des Perses d’Éschyle paru dans la collection des Belles-Lettres (« collection Budé ») avec, à droite, le texte grec et, à gauche, la traduction française ; dans mon « envoi » ou dédicace, je lui avais demandé de pardonner à la France de l’avoir kidnappé en usant de méthodes de gangster et de l’avoir livré au vainqueur et à sa justice couchée.
À propos de la grandeur d’âme d’Éschyle vous me demandez : « Trouvez-vous dans la littérature française des œuvres qui aient donné naissance à des mythes à la hauteur de gestes semblables? (Personnellement, je n’en trouve pas ; les Espagnols ont inventé don Juan, les Allemands Faust, les Russes l’Idiot, mais nous, à part Gargantua…) ». Ma réponse est que, dans notre littérature, des personnages tirés de la réalité historique ou créés de toutes pièces ont donné naissance à des mythes français qui sont parfois comparables à ceux que vous citez. Je pense à la transfiguration littéraire de personnages tels que le Roland de la chanson de geste, à Jeanne d’Arc (inspirant Villon, Michelet, Péguy, Delteil), au « héros cornélien » (dans Le Cid, Horace, Cinna ou la Clémence d’Auguste), à Napoléon, mais aussi à des créations de Victor Hugo (Jean Valjean, Cosette, Gavroche dans Les Misérables sans compter, dans La Légende des siècles, toute une galerie de héros français). Peut-être pourrait-on mentionner aussi le Cyrano de Rostand. Et pourquoi pas le Bardamu de Céline, si français par sa gouaille et dont la grandeur de prolétaire tient au refus à la fois d’obéir, de tuer et de se faire tuer ?
XXX : Nous voici revenus au domaine du tragique, de cette beauté-là qui n’est, comme disait Rilke, que « l’annonce du terrible ». Œdipe s’est crevé les yeux en constatant que tous ses efforts n’avaient servi qu’à précipiter les crimes qu’il redoutait. Pouvez-vous discerner des effets secondaires qui vous consternent, dans le résultat de votre entreprise prométhéenne ?
RF : Mon entreprise n’est pas prométhéenne ; je n’ai inventé ni le feu, ni la poudre, ni rien du tout. Je me suis mis à l’école de Jean Norton Cru et, surtout, de Paul Rassinier et j’ai apporté à mes recherches historiques le même soin qu’autrefois, dans mon enfance, à mes exercices scolaires de latin ou de grec. Les jésuites m’avaient appris à porter en tête de mes copies, en toute matière : « Labor improbus omnia vincit ». Un latiniste, attentif ici à l’emplacement de l’adjectif, vous le confirmera, la formule signifie : « Le travail, s’il est sans merci, vient à bout de tout ».[3] Certes beaucoup travaillent avec application mais sans doute bien peu vont-ils jusqu’à suivre la recommandation de Boileau : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ; / Polissez-le sans cesse et le repolissez. » Il est des activités, en particulier celle du journaliste, où il est impossible de s’infliger une telle discipline.
Vous m’interrogez sur les « effets secondaires » qui, dites-vous, me « consterneraient ». Croyez que j’aurais à dire sur le sujet mais permettez-moi de m’en abstenir. Le domaine est trop vaste et le catalogue de mes moments de « consternation », y compris au sujet de mes propres entreprises, découragerait trop de lecteurs révisionnistes qui, comme moi, se dépensent sans compter.
XXX : Reprenons maintenant le point de vue de vos adversaires, après avoir exploré plusieurs facettes de votre destin. Vous avez en quelque sorte refusé un destin d’historien, comme vous avez refusé toute responsabilité en politique, dans la mesure où vous n’avez pas essayé d’écrire une synthèse sur la Seconde Guerre mondiale. Votre règle de méthode, votre profession de foi dans le détail, même si c’est le détail qui tue, et qui vous tue, est comme un cartésianisme extrémiste, étouffant, une prison mentale. Et vous dites vous-même que c’est peut-être maladif, cette obsession de l’exactitude qui vous a acculé à n’étudier que l’un des aspects monstrueux de l’humanité contemporaine. Le propre du maniaque n’est-il pas d’être inconscient de son travers ?
RF : Je peux donner l’impression d’être un maniaque. À côté d’une vie aux passions et aux activités diverses et normales, j’ai nourri et, parvenu à un âge avancé, je persiste à nourrir deux passions essentielles : l’une pour le révisionnisme littéraire et l’autre pour le révisionnisme historique. Vous me ferez peut-être observer que ces deux passions n’en forment qu’une. En tout état de cause, le terme de « manie » me paraît impropre parce qu’il me semble que ces deux passions ne s’accompagnent pas chez moi d’un trouble de la personnalité. Mais avant d’aller plus loin, permettez-moi de vous expliquer d’abord ce que je crois être le fond de toute l’affaire ; vous déciderez ensuite si je suis ou non affligé de maniaquerie.
J’ignore si je le dois à la religion catholique dans laquelle j’ai été élevé (et que j’ai quittée pour l’athéisme) ou à ma formation classique, ou encore à une éducation spartiate, mais le fait est que, tout au long de ma vie, j’ai entretenu une conscience aiguë de mes propres limites et des limites de chacun. La forfanterie m’agace. Fût-il, en son domaine, ce qu’il est convenu d’appeler un génie, tout homme me paraît être au fond un assez pauvre hère. J’admire les prouesses sportives, artistiques, scientifiques ; elles peuvent m’inspirer un moment d’enthousiasme, mais jamais elles n’effacent pour moi la misère de notre condition humaine, dont, chaque jour, s’offrent tant d’exemples à nos yeux. Mes moments d’ivresse se dissipent presque dans l’heure et j’éprouve de la gêne au spectacle d’une admiration continue surtout s’il s’agit de s’admirer soi-même. Je déçois mon entourage quand il s’enquiert de mon avis sur telle ou telle question et que je me vois contraint de répondre : « Je ne sais pas », « Je n’ai pas lu le dossier », « Je n’ai pas étudié la question », « Je ne connais pas ces personnes », « Je ne sais rien de l’affaire dont vous me parlez sinon ce qu’en racontent les journaux et la télévision,… ». Encore une fois, mes travaux et mes jours sont à l’opposé de ceux du journaliste. Ouvrant Le Monde, j’y découvre quotidiennement, en page 2, une sorte de prêche, appelé « éditorial ». Une voix anonyme, celle de la ligne directrice du journal, y traite souverainement de tout sujet et nous indique, à chaque fois, où sont la voie, la vérité et la vie. C’est du haut d’une chaire et sur un ton de patenôtre qu’on s’adresse ainsi à son lectorat. Au Monde, on tranche à vif de tout sujet, et cela sur un ton de nez fort dévot. On vous y gronde. Parfois l’on s’y montre circonspect et modeste, mais non sans ostentation. Comment des journalistes peuvent-ils se gober à ce point ? Personnellement, je me trouve nul en cent domaines. Vous connaissez le questionnaire où, entre autres questions, on vous demande en quelle sorte d’animal vous vous verriez. Pour ma part, je répondrais : « En une coccinelle . » La coccinelle, que je suis donc pour la circonstance, ne s’envole guère d’un jardin, dont elle connaît tous les recoins. En « bête à Bon Dieu », elle exerce aux côtés du jardinier l’activité que la nature lui a prescrite. Mais voici que parfois, dans son jardin, pénètrent des lourdauds, dont pétaradent les machines. Ils plient à leur discipline le vert et le sec, la gent animale et jusqu’aux lois de la nature, à qui ils font la leçon. Ils savent, ils régissent, ils répriment. Ils sont l’ordre et la loi. Que pèse à leurs yeux le jugement d’une coccinelle qui est là et qui les observe ?
Je suis incapable d’embrasser un vaste sujet et, à plus forte raison, tout un ensemble de sujets. N’attendez pas de moi un travail de grand historien, un panorama, une synthèse d’ordre littéraire ou historique ou encore des analyses politiques ou idéologiques d’envergure. Je ne vous fournirai que des articles, des études, des essais et quelques monographies. Prêchant d’exemple, je recommandais à chacun de mes étudiants de ne choisir pour son mémoire de maîtrise ou pour sa thèse qu’un sujet restreint et strictement délimité. Au terme de leur besogne, ces étudiants devaient m’apporter la preuve qu’ils avaient scrupuleusement observé tous les coins et recoins du jardin choisi ; alors, et seulement alors, je leur accordais le droit de porter sur ce jardin le jugement de leur choix. Ils devaient le faire en français, c’est-à-dire en proscrivant la moindre trace de ce jargon qui, à tout coup, cache une pensée pauvre. Encore une manie de ma part, me direz-vous peut-être.
XXX : Il est impossible de ne pas admirer votre sens de la langue. Quoique vous vous en défendiez, et que nous ne disposions d’aucun poème, roman ou texte de théâtre signé de votre nom, vous êtes un artiste, un créateur d’images linguistiques définitives, ce qui est exceptionnel. Mais j’irai plus loin, je pense que vous avez bâti et mis en scène votre biographie comme un scénario parfait, quelle que soit la fin que le sort vous réserve. Si j’étais votre réalisateur, la dernière image du film serait celle de votre vélo, celui sur lequel vous allez encore, à près de 80 ans, chercher le pain tous les matins, votre vélo vert bouteille retenu, par une chaîne fidèle, au soupirail de votre très modeste cave-caverne, dans une rue proprette, sans un passant, sans un bruit, dans une ville creuse, qui vous épie derrière chacune de ses jalousies. Pressentez-vous autour de vous les fantômes du grand cinéma français de jadis ?
RF : Vous l’avez bien vu, ce coin du « Quartier de France » à Vichy. Simenon avait été intrigué par cet aspect du secteur que j’habite. Il en avait tiré un roman « d’atmosphère » : Maigret à Vichy. Il paraît que, dans sa jeunesse, Fernandel (Fernand Contandin) est venu avec sa famille habiter la modeste villa où je réside depuis 1968. Par la suite, Jean-Pierre Rampal également y est passé. J’habite Vichy depuis un demi-siècle. « La Reine des villes d’eaux », aimable et sans caractère, est largement postiche ; on y a imité tous les styles d’habitation ou de construction : basque, flamand, anglais, italien, espagnol, mauresque… Il y fait bon vivre. Ses parcs, ses jardins, son plan d’eau, ses espaces de loisirs et de sports, ses créations universitaires en font, avec ses environs, une ville attrayante bien que surpeuplée de vieux. On y souffre d’avoir accueilli Pétain et Laval de 1940 à 1944. En compensation, on y donne volontiers dans la surenchère résistancialiste ; par moments, c’est à se demander si la capitale de l’État français n’aurait pas été un haut lieu de la Résistance. Faurisson, hélas, habite Vichy. Il y est d’une remarquable discrétion mais il lui est arrivé de faire jaser sur son compte : par exemple, lorsque, dans un parc proche de sa maison, il s’est fait corriger par trois justiciers qui ont manqué le laisser pour mort. Il ne semble pas avoir compris la leçon. Il s’exhibe à bicyclette par tous les temps. Il fréquente le Sporting où il joue au tennis. Il danse, il rit, il a des amis, il adore les enfants et les enfants, pauvres naïfs, lui rendent ses sourires. À la médiathèque, tenue par une dame juive, on a eu l’heureuse idée de refuser ses ouvrages les plus sulfureux et, à son épouse, gentille et gracieuse personne, on a réussi à faire entendre qu’avec un nom comme le sien mieux valait qu’elle se résigne à quitter telle association locale de chant grégorien ou telle œuvre de charité. La communauté juive de la ville est riche et influente. Devant l’ancien Hôtel du Parc où résidait le Maréchal Pétain jusqu’à ce que les Allemands l’y arrêtent, le 20 août 1944, elle a fait dresser une stèle qui indique que, pour certains juifs de France, Vichy a été l’antichambre d’Auschwitz, « camp d’extermination » (sic). Nous voici donc, pour les enfants d’Israël, à « Vichy-Auschwitz » comme le rappelle finement le titre d’un ouvrage de Serge Klarsfeld. À part cette stèle et, au foyer de l’Opéra, une plaque rappelant que, le 10 juillet 1940, quatre-vingts parlementaires ont refusé à Pétain ce qu’on appelle « les pleins pouvoirs », Vichy occulte son récent passé. Cependant, comme il se trouve des touristes, souvent étrangers, qui insistent pour voir ce qu’on voudrait leur cacher, l’Office du tourisme leur prodigue tout de même des visites guidées lors desquelles on leur débite une histoire, strictement orthodoxe, de l’État français.
Vous estimez, me dites-vous, que j’ai organisé et mis en scène ma biographie « comme un scénario parfait ». C’est la partie adverse qui s’est chargée de monter le film de ma vie. Ces gens-là sont des spécialistes du scénario ou de la mise en scène et leur public – « le grand public » – ignore tout des réalités de la vie et des travaux des révisionnistes. Mais prêtons-nous un instant au jeu dont vous me soufflez l’idée. Imaginons le scénario d’un film qui retracerait en quelques épisodes l’histoire d’une partie de mon enfance et de mon adolescence. Il commencerait près de Londres, à Shepperton, le vieil « Hollywood » anglais. J’y vois le jour le 25 janvier 1929. Mon nom est alors celui de ma mère, Aitken, et mes deux prénoms, tels qu’ils figurent à l’état civil, sont, curieusement, « Robert » et « Faurisson ». Mon père est français et catholique ; ma mère est écossaise et protestante. Mon père travaille dans la City, Fenchurch Street, à l’agence de la Compagnie des Messageries maritimes. Je suis confié à mes grands-parents paternels et à mes tantes, qui habitent Saint-Mandé, près de Paris. Mes parents ne se marieront qu’à la naissance de mon frère Philippe, en 1931, à Tamatave (Madagascar). Je prendrai alors le nom de Faurisson et la famille finira, en 1940, par compter sept enfants, dont je serai l’aîné.
XXX : Vous voici donc en train de rédiger votre « rapport de gendarmerie » et, ce faisant, vous savez fort bien créer l’attente de quelque forte ponctuation fournie par des événements imprévus…
Je rejoins mes parents à Saïgon vers 1934. L’année suivante, j’entre dans une école anglaise, de rêve, à Singapour et, l’année d’après, dans une école américaine, crasseuse, à Kobé (Japon). En 1936, retour vers la France. Quatre semaines sur le bel et blanc Aramis. Les escales ont pour noms Shanghaï, Hong Kong, Saïgon, Singapour, Colombo, Djibouti, Port-Saïd, avec arrivée à Marseille. Filles et garçons de la famille ne fréquenteront que des écoles catholiques. Mon grand-père paternel avait dirigé, à Paris, la bibliothèque du cercle des étudiants catholiques de la rue du Luxembourg (aujourd’hui, rue Guynemer) et il avait été fonctionnaire aux Halles de Paris. En 1936, je suis à Chatou (École Notre-Dame). Dans les années suivantes, je serai à Dunkerque (École des Dunes) et à Paris (École de la rue Cassette), en 1939-1940 à Angoulême (Collège Saint-Paul), de 1940 à 1943 à Marseille (École [jésuite] de Provence) et, de nouveau, à Paris, cette fois au Collège Stanislas. Après le baccalauréat (1946), hypocagne et cagne au Lycée Henri IV et, enfin, études de lettres à la Sorbonne.
Retour en arrière : le 8 mai 1945 la guerre a pris fin sur le continent européen. J’ai seize ans. J’avais intensément vécu les péripéties du conflit. Pour ce que j’en voyais, le comportement du soldat allemand était impeccable et les bombardements des Anglo-américains, meurtriers. Il n’empêche : abreuvé aux sources de Radio-Londres, que j’écoutais religieusement avec mon père, je haïssais l’Allemand et j’appelais de mes vœux plus de bombardements encore sur mon propre pays et sur l’Allemagne. Peu après le 22 juin 1942, au collège des jésuites de Marseille, à l’âge de treize ans, j’avais un jour gravé au couteau sur mon pupitre d’écolier : « Mort à Laval » (je ne me le pardonne pas). Sur le lieu de mes vacances, en Charente limousine, dans le village de La Péruse, je ne voyais encore aucun maquisard mais je me représentais les Résistants, communistes ou non, comme d’ardents patriotes.
XXX : On a peine à vous imaginer aussi enthousiaste et impulsif !
Encore aujourd’hui je suis sujet à l’enthousiasme et à l’impulsivité. Arrive le 1er août 1944. J’ai quinze ans et je suis précisément en vacances dans ce coin de Charente limousine qui se trouve être le berceau des Faurisson. C’est là, à mi-distance entre Angoulême et Limoges, que je vois enfin mes premiers Résistants et que j’apprends leurs exploits dans le secteur. J’en tombe de haut. J’ai raconté ailleurs l’épisode et je n’y reviendrai pas ici. Je veux bien croire qu’en d’autres points de France il s’est trouvé dans les rangs de la Résistance de nobles figures mais, là, les deux maquis locaux, l’un communiste et l’autre gaulliste, ont, à l’exception de quelques individus, rivalisé dans la torture, l’assassinat et le vol. L’exécution, par un peloton du « Maquis Bernard », de Françoise Armagnac, encore dans sa robe de mariée, nous frappe tous ; la malheureuse avait été « arrêtée » quasiment à la sortie de la messe de mariage et elle avait été condamnée à mort sur réquisition d’un juge accusateur. Cependant, comme on ne perd généralement pas la foi en un jour, je persiste alors à idéaliser, à défaut du Résistant français, le soldat britannique, américain ou soviétique. Deuxième incident : à Orléans, en septembre 1944, je découvre la sordide réalité de l’armée américaine ou, du moins, de certains de ses représentants. Troisième déconvenue : cette fois-ci avec l’allié soviétique dont la sauvagerie n’est bientôt plus un secret pour personne. En somme, il ne me reste que les Britanniques pour entretenir mes illusions, que je commence à perdre avec l’atroce bombardement de Dresde (13-14 février 1945), suivi du mitraillage systématique des civils, y compris des juifs en liberté, cherchant à fuir la fournaise. En août 1945, je suis à Brighton, où je me rends au cinéma ; le film des actualités nous montre des soldats japonais transformés par un lance-flammes en torches vivantes ; près de moi, j’entends une Anglaise souffler à sa voisine : « And we are British ! » (« Et nous sommes des Britanniques ! », autrement dit : « Et nous nous prenons pour des civilisés ! »).
Mais revenons au 8 mai 1945. J’ai seize ans, je me trouve à Paris où j’habite à proximité du jardin du Luxembourg. Les cloches de la victoire sonnent. Pour mieux les entendre, j’ouvre la fenêtre de la chambre que je partageais avec mon frère cadet. Notre père survient, qui me demande si je suis « heureux ». Je lui réponds oui, mais comme pour me débarrasser d’une question que je juge trop intime et, là, pour la première fois de ma vie, je me prends tout à coup à songer aux Allemands, aux « Boches », aux « Nazis » comme à des êtres de chair et de sang pour qui, à la réflexion, ce jour du 8 mai 1945 doit être bien plus horrible encore que le 11 novembre 1918. C’est, je pense, de ce jour-là que le doute a commencé à me ronger. Reste que, par la suite, « On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans ! » Mes études et les plaisirs de la vie continuent d’accaparer presque toute mon attention. Cependant l’Épuration bat son plein : on fusille tous les jours. Gaullistes et communistes rivalisent d’ardeur dans la répression. Les vainqueurs sont pris d’une frénésie criminelle. Après Hiroshima, Nagasaki, voici, en plein cœur de l’Europe, les nettoyages ethniques, les massacres et déportations systématiques des minorités allemandes dans des proportions et dans des conditions bien plus horribles que celles qu’on peut reprocher aux vaincus. On livre au Moloch soviétique les proies qu’il exige. On ferme les yeux sur les massacres perpétrés par Tito. Ces crimes, qui n’ont plus l’excuse de la guerre, s’accompagnent des mascarades du procès de Nuremberg, du procès de Tokyo et d’un flot de procès identiques. Précisément, un jour de 1949, pour la première fois de ma vie, je me rends au Palais de justice de Paris afin d’y assister au procès d’un milicien. L’affaire se déroule à la XVIIe chambre, là même où, à partir de 1981, je ne cesserai de comparaître à mon tour mais pour délit de révisionnisme. Ma première expérience du fonctionnement de la justice française me bouleverse. Peut-on descendre aussi bas dans l’ignominie ? Le milicien, un ancien cagneux, est condamné à mort (il portera longtemps les fers mais, en fin de compte, sa peine sera commuée).
Les Britanniques, eux aussi, avaient été confrontés à la nécessité, politique sinon morale, de juger tous les « sujets de la reine », qui, dans les Iles anglo-normandes, avaient fort peu résisté et beaucoup collaboré avec l’occupant jusqu’à accepter expulsions ou déportations, y compris de juifs, ordonnées par les Allemands pour des raisons de sécurité ; or le gouvernement britannique avait su résoudre le problème avec intelligence et humanité. En France même, des « juifs bruns » avaient bénéficié du privilège de passer en jugement devant des « tribunaux d’honneur » juifs, qui les avaient, d’ailleurs, tous acquittés en première et en seconde instance. Mais là, aussi bien à Paris que dans le reste de la France, l’appareil judiciaire français se rue dans la servitude. Les condamnations à mort pleuvent. Les exécutions sont fréquentes. Selon le décompte de Marc Olivier Baruch (article « Epuration » du Dictionnaire de Gaulle, Robert Laffont, 2006), de l’automne 1944 à janvier 1946, Charles de Gaulle, à lui seul, refuse sa grâce à 768 condamnés à la peine capitale, ce qui signifie qu’en seize mois il a envoyé au poteau 48 personnes par mois, soit largement plus d’une personne par jour : une routine. L’Épuration poursuivra encore longtemps ses basses œuvres. Elle continuera bien plus tard, sous une autre forme, avec les procès Barbie, Touvier, Bousquet (assassiné tant on a créé une atmosphère de haine autour de sa personne) et Papon. Les lycéens sont conviés, par milliers, à des simulacres de procès où on leur inculque la haine du vaincu ; par ailleurs, à l’école, à l’université ou encore lors de cérémonies ou lors de visites d’anciens camps de concentration, on leur apprend, sous couvert du désir de justice, à se forger des mentalités de justiciers. La chasse aux révisionnistes s’inspire du même esprit. Les procès de révisionnistes sont pareillement truqués. À la « Libération » (sic), les jurés comprenaient obligatoirement des « Résistants », c’est-à-dire qu’on s’assurait par là que dans de tels procès figureraient des hommes et des femmes qui seraient à la fois juges et parties. Aujourd’hui, à la XVIIe chambre, les révisionnistes passent en jugement devant un président (Nicolas Bonnal) et un procureur adjoint (François Cordier) préalablement formés par des cours de Shoah que leur ont dispensés, aux frais du contribuable, le Conseil représentatif des juifs de France (CRIF) et le Centre Simon Wiesenthal de Paris. Ce n’est pas tout : dans un prétoire où l’on n’imaginerait pas qu’un représentant du ministère public aille invoquer Allah ou le dieu des chrétiens, on peut, en revanche, fort bien entendre un substitut (Anne de Fontette), citant l’Ancien Testament, appeler, mot pour mot, la colère de « Yahweh, protecteur de son peuple élu, contre les lèvres fausses [de Faurisson] ». Plus de soixante ans après la fin de la guerre, un peu partout dans le monde, chacals et vautours continuent de traquer ainsi le nazi, même si ce dernier se trouve finir ses jours dans un mouroir. Le vainqueur outrage le vaincu et vient rituellement cracher sur sa tombe. On nous tympanise avec un « devoir de Mémoire », qui n’est en fait que le devoir d’une certaine mémoire. On nous abreuve d’images d’atrocités nazies qui, nous l’avons prouvé, sont, pour la plupart, ou fausses ou fallacieuses (faire prendre des morts pour des tués, etc.). Si un film devait être tourné sur l’ensemble de ma vie, je ne serais pas en peine de fournir, pour toile de fond à mes propos, en grand écran, d’autres images, authentiques celles-là, des atrocités antifascistes, démocratiques ou soviétiques qu’on ne nous montre qu’avec une extrême parcimonie. Là où manqueraient les images, je produirais des preuves, dûment contrôlées. Ces images et ces preuves expliqueraient aux générations actuelles, intoxiquées de propagande, que si, autrefois, dès avant la guerre, tant de jeunes idéalistes (catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, hindous, shintoïstes ou athées) se sont engagés volontairement aux côtés de l’Allemagne ou du Japon, c’est dans un élan sincère et mus par l’indignation devant les horreurs perpétrées par les « Rouges » et leurs alliés anglo-saxons. Dans Le Monde du 24 octobre 2007, sous la plume d’Henri Tincq, dont la vocation semble être pourtant celle de prêcher la bonne parole antifasciste, je lis cet aveu :
Selon les centaines d’études consacrées à la fureur fratricide qui a saisi l’Espagne en 1936, au moins 6 000 prêtres et religieux (dont 13 évêques) ont été massacrés en zone républicaine. Soit 88% du clergé dans le seul diocèse de Barbastro (Aragon) dont l’évêque, Mgr Asensio Barroso, a été émasculé vivant avant d’être assassiné le 9 août 1936. Neuf diocèses ont perdu plus de la moitié de leur clergé. La seule appartenance au clergé était justiciable d’une exécution sommaire. Ceux qui ont pu y échapper se trouvaient en zone nationaliste, où ils avaient pu fuir, se cacher ou bénéficier de protections. À ce martyrologe il faut ajouter les incendies d’églises ou de couvents, les profanations d’autels et de sépultures… Dès septembre 1936, Pie XI avait dénoncé la « haine de Dieu satanique » professée par les républicains. […] Selon les travaux historiques les plus récents, les républicains auraient été responsables de 85 000 exécutions, dont 75 000 pendant l’été 1936. Les nationalistes auraient été à l’origine, eux, de 40 000 exécutions.
Au fond, au-delà des causes économiques ou politiques qui ont provoqué la boucherie de 1939-1945, la folie furieuse des deux parties en présence semble avoir été provoquée par la peur. La peur du bolchevisme a joué un rôle déterminant et, de l’autre côté, la peur du fascisme sous ses différentes formes lui a fait pendant. Mais, je le répète, les crimes du vainqueur ont, dans les grandes largeurs, dépassé ceux du vaincu, ce qui, somme toute, obéit à la loi du genre puisque, toute guerre étant une boucherie, le vainqueur est un bon boucher et le vaincu, un moins bon boucher.
XXX : Eh bien, nous tenons là la matière d’un film apocalyptique ! Votre engagement dans cette controverse sur la Seconde Guerre mondiale n’est-il pas l’aboutissement inéluctable de votre amour passionné de l’épopée, le genre qui peut englober tous les autres, et qui renaît de chaque guerre ? Paradoxalement, cette forme d’amour de la littérature ne vous a-t-il pas conduit à renoncer aux belles-lettres pour partir au combat du révisionnisme historique, laissant derrière vous tout ce que vous aimiez, comme le simple soldat qui obéit parce qu’il a reçu son ordre de mobilisation ? N’y a-t-il pas là comme un prolongement de l’éthique des poètes ? Cela commence par le refus de transiger dans la recherche du mot juste car ce mot-là est nécessaire à l’expression d’un sentiment qui, lui-même, sonnera juste. L’artiste, le violoniste dignes de ce nom ne peuvent produire que de la justesse. La justice parfois se reconnaît dans une expression pleine de justesse. Justice et justesse, toutes deux indissociablement liées, font alors l’unanimité. Quel que soit le niveau de perception propre à chacun, les esprits peuvent ainsi se retrouver à l’unisson. Tout le reste ne serait, comme disait Verlaine, « que littérature » ou bien, en la circonstance, plus exactement, brouhaha, tumulte et futilité.
RF : Sur le premier point, j’ai envie de vous dire : « Subtil et bien vu ! » et sur le second : « Erreur ! ». Vous avez noté qu’en matière de belles-lettres, mon goût de la justesse et ma détestation du faux-semblant avaient toute chance de me conduire aussi, en histoire, à la recherche de l’exactitude et à la dénonciation du mensonge ou de la calomnie. Mais vous faites erreur si vous vous imaginez qu’en me voyant épris, comme vous le dites, à la fois de justesse et de justice, les spectateurs manifesteront unanimement leur approbation. C’est l’artiste et lui seul qui pourrait provoquer cette unanimité parce qu’il a le privilège de s’adresser aux cœurs, aux sensibilités et à la part obscure de chacun de ceux qui voient ou entendent ses œuvres.
XXX : Peut-être un grand réalisateur, prenant votre biographie pour matière première, y parviendra-t-il un jour.
Les malheureux qui me lisent n’ont pas cette chance. Ils sont invités à partager une activité ingrate, dénuée de charme, celle de la réflexion sur des documents ou des arguments, et ce type de réflexion provoquera souvent la discussion plutôt que l’unanimité. Ne rêvons pas ! L’unisson est ici impossible. Cela dit, vous avez raison : en littérature, j’avais contracté l’habitude d’aller scruter tout texte à la loupe ainsi que je l’ai exposé dans un CD audio intitulé Mon révisionnisme littéraire ; aussi, tout naturellement, venant à lire Le Journal d’Anne Frank, je ne pouvais que bondir devant le nombre incroyable d’invraisemblances purement matérielles que j’y rencontrais. Quand on a enseigné à ses étudiants qu’il est interdit de commenter avant de chercher à comprendre, fût-ce dans le cas d’une simple fable de La Fontaine, comment imagine-t-on que j’aurais pu rester indifférent à la somme d’inepties que cherche à nous faire absorber la littérature holocaustique ? Quand l’écolier ou le professeur que j’ai été a passé une partie de sa vie à dénombrer, un à un, les mots dont se compose un texte latin, grec ou français, et cela afin de ne rien omettre ensuite dans une version ou dans un thème, comment croit-on qu’il va plus tard réagir en découvrant, par exemple, au fil de ses diverses lectures sur la Seconde Guerre mondiale qu’on prête aux Allemands la recherche d’ « une solution finale de la question juive » qui aurait consisté en une totale élimination physique alors qu’en réalité le texte allemand d’où provient cette expression de « solution finale » parle d’« une solution finale territoriale de la question juive » (eine territoriale Endlösung der Judenfrage) ? Ici l’escamotage de l’adjectif « territoriale » nous cache que le IIIe Reich aspirait, en fait, pour résoudre un problème historique aussi vieux que le peuple juif lui-même, à une solution qui n’avait rien de criminel et qui n’était pas même d’esprit nécessairement antijuif puisque les sionistes eux-mêmes y songeaient: la création d’un territoire juif à Madagascar, en Ouganda ou ailleurs ; certains «juifs bruns», eux, l’avaient bien compris, qui coopéraient avec les nationaux-socialistes, allant même, pour certains d’entre eux, tels les membres du Groupe Stern (sans oublier celui qui, plus tard, prendra le nom d’Itzhak Shamir), jusqu’à proposer, au début de 1941, une collaboration militaire à l’Allemagne de Hitler contre l’Angleterre de Churchill. De son côté, Serge Klarsfeld triche quand, pour nous faire croire qu’« action spéciale » (Sonderaktion) signifiait « assassinat en chambre à gaz », il supprime froidement un mot allemand signifiant « au dehors » (draussen) ; en effet, cette « action spéciale » dont parle le Dr Johann-Paul Kremer, en service commandé à Auschwitz pendant quelques semaines de 1942, est notée dans le journal de ce dernier comme se passant « au dehors » ou « en plein air » ; il s’agissait là du contrôle en plein air, et non de l’assassinat en abattoirs chimiques souterrains, d’un convoi de déportés à son arrivée au camp. Quand on a développé la pratique de l’écoute des textes, comment pourrait-on se laisser abuser par la déformation systématique du sens d’un document ou d’une photographie ? Errer sur le sens d’un texte littéraire ne tirera peut-être pas trop à conséquence mais se tromper ou tromper son monde sur le sens d’un document, d’un aveu, d’une confession, d’un témoignage, d’une photographie qui vont être invoqués pour pendre un homme ou calomnier toute une nation est une tout autre affaire. À un moment de ma vie, j’ai donc tiré un trait sur le plaisir que j’éprouvais à scruter des textes littéraires et j’ai pensé qu’il était de mon devoir de parer au plus pressé : sauver de la corde ou du déshonneur mes anciens ennemis. « Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle » : c’est ce qu’on m’apprenait à l’école et c’était de Lamartine qui, pas mal crédule, ajoutait : « S’il n’a l’âme et le cœur et la voix de Néron » (or, vous le savez, rien ne prouve que Néron ait incendié Rome ou qu’il ait pris sa lyre et chanté pendant que brûlait Rome).
XXX : « Sauver de la corde ou du déshonneur mes anciens ennemis » peut paraître un projet d’extra-terrestre, sur le terrain des enjeux politiques actuels… Mais d’un autre côté, vous avez démoli sans aucune charité vos ennemis du présent : ceux que vous appelez « les juifs » ; vous ne leur passez rien et c’est vous qui avez fait leur procès rédhibitoire ! Je continue à chercher la grille de lecture qui convient pour mettre dans une perspective cohérente tout le roman que vous nous livrez là. Je dis bien « roman », parce que vous avez construit un héros et des aventures, à partir de la rubrique « faits divers » des journaux et du peu qu’on dit de vous par-ci par-là, sur le mode de l’extravagance ; je dis bien « roman », c’est-à-dire un récit attirant parce que s’y reconnaissent l’acuité de l’observation, ce côté « miroir promené le long de notre chemin » ; nos défenses critiques s’effacent comme sous l’effet d’une hypnose, nous nous absorbons dans une sorte de cinquième dimension, à laquelle nous nous mettons à croire mais sans, pour autant, la confondre avec la réalité où nous vivons. Le document que vous venez de nous bâtir là pourrait entrer dans la catégorie du réalisme critique selon Lukacs, et, pour vous qui aimez les jeux de mots du genre « no holes, no holocaust », je vous assure que vous savez « draw the reader into a rabbit hole of absorption ». Seriez-vous par hasard un écrivain du XIXe siècle ? Dans ce cadre-là, vos commentaires sur les juifs sembleraient tout à fait à leur place entre ceux de Voltaire et de Baudelaire, par exemple… À une époque encore très proche, on disait pis que pendre de la femme (comme Michelet, qui en consommait pourtant beaucoup), des noirs (à peu près tout le monde), des homosexuels (Proust). Et puis les écrivains eux-mêmes ont miné les murailles immunitaires des Européens, et ont élargi leur empire critique. Est-ce que tout ce processus de réhabilitation des damnés, la grande dynamique d’abolition des limites, propre au XXe siècle, et qui inclut les juifs, ne relève pas de ce que vous admirez, l’attitude d’Eschyle relevant le vaincu ?
RF : Commençons par définir ma position sur les juifs. À la fin d’un long entretien qui a eu lieu le 13 décembre 2006 à Téhéran, la question m’a été posée. On m’a demandé si j’étais antisémite. Ma réponse a été :
Vous voulez dire antijuif. Non, je ne me considère pas comme antijuif car je ne souhaite aucun mal aux juifs. Je ne veux pas qu’on touche à un seul cheveu de leurs têtes, ne serait-ce que pour ne pas avoir à les entendre redoubler leurs cris. Ce que je veux, en revanche, c’est qu’ils ne me fassent pas de mal, à moi ; ni aux autres. Je veux que cesse l’assourdissant tamtam de leur propagande holocaustique derrière lequel trop souvent se discerne le roulement de leurs tambours de guerre. Il n’y a pas plus gémissant et belliciste que cette nomenclature juive, sioniste et néo-con, qui ne cesse de réclamer censure, répression, guerre et croisade au nom de « l’Holocauste », c’est-à-dire au nom d’un mensonge particulièrement dégradant.
Mais cette réponse, qui date d’il y a un an, est insuffisante. D’abord entendons-nous sur ce que j’appelle « les juifs ». J’entends essentiellement par là ceux qui, à la tête d’organisations ou d’associations ad hoc, défendent ou prétendent défendre les intérêts juifs, puis toutes ces notabilités juives du monde bancaire, politique, industriel, commercial, éditorial, artistique et médiatique qui occupent une place considérable dans leurs différentes sphères d’activité aussi bien en France qu’à l’étranger. Ils détiennent de tels privilèges que je les appelle « nos nouveaux aristos », des aristos dépourvus de noblesse, des sortes de nouveaux riches si arrogants, si menaçants, si gémissants qu’il se trouve aussi de leurs coreligionnaires pour dénoncer, avec raison, leur nocivité. Je refuse de me soumettre à leur loi et je veux pouvoir, dans mon pays et dans le reste du monde, parler des « juifs » aussi librement qu’on peut parler des « Allemands ». Si je formule une critique à l’endroit des « Allemands », je sais que les tribunaux ne m’en demanderont pas compte ; pourquoi le font-ils, et avec tant de zèle, dès lors qu’on a l’air d’exprimer une critique ou de se permettre une saillie sur le compte du mythe juif de la Shoah ?
Vous m’adressez le reproche suivant : « Vous avez démoli sans aucune charité vos ennemis du présent : ceux que vous appelez ‘les juifs’ ; vous ne leur passez rien et c’est vous qui avez fait leur procès rédhibitoire ! » Je note le point d’exclamation final et je supposerai qu’ici « rédhibitoire » veut dire : implacable et sans appel possible. Vous avez peut-être raison car, si l’on compare mes écrits à ceux de bien d’autres révisionnistes, mes propos sont sévères. On se trouve là, je pense, devant une question de caractère individuel et de comportement personnel. J’ai toujours été sévère – avec une tendance à l’inflexibilité – et, je vous le répète, à la différence de la plupart des gens qu’il m’a été donné de rencontrer en France ou à l’étranger, dans les hautes comme dans les basses sphères, je ne suis pas timide. J’ai même tendance à la hardiesse dans les situations difficiles où il me faut affronter les puissants. Allez savoir pourquoi, les détenteurs de pouvoirs, en quelque domaine que ce soit, me mettent assez facilement en verve ou bien me donnent envie de les rappeler, non sans quelque provocation, à plus de modestie. La puissance du lobby juif est intimidante, agressive, dangereuse pour la paix du monde. Son arrogance est si voyante qu’elle en est comique. Comment pourrait-on résister à l’envie de s’en moquer ? Céline, de ce point de vue, a été admirable de hardiesse, de discernement, de drôlerie. Relisez ses « pamphlets » que, pour ma part, je préfère appeler des satires. Un disque usé jusqu’à la cire veut que Céline ait été génial en toutes ses œuvres sauf dans ces satires où, tout d’un coup, par je ne sais quel phénomène qu’on ne m’a jamais expliqué, il serait tombé en panne de génie. C’est idiot. Au contraire, c’est en rédigeant ses satires qu’il a fait l’apprentissage d’une liberté encore plus débridée dans l’expression écrite. Indigné de voir les juifs appeler à une croisade guerrière contre l’Allemagne, écœuré à la perspective d’une nouvelle et bien plus sanglante boucherie que celle de la Première Guerre mondiale (où il avait été grièvement blessé) et refusant que le nouveau mot d’ordre ne devienne « juivre ou mourir », il a publié, en 1937, Bagatelles pour un massacre [des Aryens] et, en 1938, L’École des cadavres [aryens]. Nécessité faisant loi, c’est dans ces œuvres qu’il a appris à laisser s’exprimer en geysers ses inspirations du moment. C’est là qu’il s’est, dans l’urgence, affranchi pour de bon des convenances du langage académique. C’est là qu’il a laissé exploser aussi bien son génie tragique que son génie comique. Sur le fond, il est pleinement devenu « agonique mais marrant » tandis que, dans son style et dans son emploi de toutes les langues françaises, de la plus gouailleuse à la plus « talon rouge », il s’est fait subtil, raffiné et percutant. Je comprends que les juifs lui en tiennent rigueur car, chemin faisant, il les a ainsi filmés, photographiés, radiographiés, scannérisés. Bref, pour ce qui est des juifs, ces nouveaux aristos tout gonflés de leurs privilèges, je préconiserais à leur endroit l’attitude, classique, du moraliste ou du satiriste, laquelle consiste à châtier les mœurs, mais seulement par la plume et quelquefois en riant. Pourquoi nous refuse-t-on le droit d’adopter une telle attitude et un tel langage ?
Ferais-je du roman ou peut-être même du cinéma ? Est-ce là ce que vous insinuez ? J’ai envie de protester de ma complète bonne foi et de vous dire que mon existence a pris une tournure que je ne souhaitais pas. Ce sont les puissants qui ont décidé de ce qu’allait être ma vie : une existence fort peu enviable parce que j’ai eu l’audace de leur tenir tête. Mais vous êtes fine mouche, et qui pique juste. Vous êtes donc consciente qu’on peut commencer par être sincère et puis se prendre au jeu et jouer la comédie. On l’a dit, l’homme qui est sincèrement en colère est toujours sur le point de faire semblant d’être en colère et l’expression elle-même de « se mettre en colère » est parlante : on se prend tel qu’on est et puis on « se met » en colère comme on se met en scène pour finalement jouer un personnage. Il n’est pas exclu qu’à l’occasion j’aie ainsi pris la posture de l’homme révolté. Mais chez moi, cela n’a, je pense, jamais beaucoup duré. D’une part, je n’aime pas les postures, surtout quand elles sont faciles et avantageuses, et, d’autre part, les épreuves que j’ai eu à traverser ne m’ont pas laissé le loisir de garder la pose.
Je ne me perçois pas en homme du XIXe siècle. Si admirable soit-il, le langage de Lamartine, de Balzac, de Flaubert ou de Zola sent aujourd’hui le musée. Même lorsqu’elle évoque le monde des humbles, la littérature de ces temps lointains a des relents de mœurs bourgeoises et d’intérieur bourgeois. Avec elle on n’est jamais bien loin des atours, de la parure, de la toilette, du corset, du mobilier sous la housse, des volets mi-clos et du clavecin ou du piano de salon. D’une manière générale, je n’éprouve de franche nostalgie pour aucune époque du passé. Je m’accommode du présent, et c’est tout.
Ce que vous me dites de la femme, des noirs, des homosexuels me paraît juste. Sur ces chapitres, les Européens ont reconnu leurs fautes et ils sont allés jusqu’à se doter de lois qui répriment certaines atteintes à la femme, aux noirs et aux homosexuels. Mais à ces trois catégories on en a ajouté une autre : celle des juifs et là, avec le temps, le droit a fini par se transformer en abus. En quoi les juifs sont-ils brimés ? En fait, ils dictent leur loi. Et durement. Il y a près de dix ans, Alain Finkielkraut écrivait déjà :
Ah, qu’il est doux d’être juif en cette fin de XXe siècle ! Nous ne sommes plus les accusés de l’Histoire, nous en sommes les chouchous. L’esprit du monde nous aime, nous honore, nous défend, prend en charge nos intérêts ; il a même besoin de notre imprimatur. Les journalistes dressent des réquisitoires contre tout ce que l’Europe compte encore de collaborateurs ou de nostalgiques de la période nazie. Les Églises se repentent, les États font pénitence, la Suisse ne sait plus où se mettre… (Le Monde, 7 octobre 1998).
Aujourd’hui, A. Finkielkraut ne pourrait que réitérer le constat. Entre-temps, la présidence de la République française est échue à un juif de choc qui, flanqué d’une constellation de fils et de filles d’Israël, clame son amour de l’État hébreu. Encore chaque année, tout le personnel politique français se précipite au dîner du CRIF pour s’y voir distribuer semonces et consignes, bons et mauvais points. Les médias nous enivrent chaque jour, chaque nuit, du récit des étourdissantes vertus du peuple élu et du rappel de ses atroces souffrances. Les juifs constituent la seule communauté qui ait obtenu l’institution d’une loi spéciale pour protéger sa version d’un pan de sa propre histoire. Depuis 1990 la Shoah et la « mémoire juive » sont officiellement «off limits», intouchables, sacro-saintes. Malheur à celui qui ose prétendre que le Tabernacle, censé renfermer l’Indicible, ne contient en fait rien de tel. Pour en venir plus précisément à ce que vous me dites ensuite, il est vrai qu’en bon disciple de Pyrrhon je suis allé dire aux accusateurs : « Montrez-la-moi, votre magique chambre à gaz ! », ou « Show me or draw me a Nazi gas chamber ! » [Montrez-moi ou [à défaut] dessinez-moi une chambre à gaz nazie !]. Je leur disais : « Expliquez-nous comment, chaque jour, vos Sonderkommandos pouvaient pénétrer dans toutes ces chambres à gaz inondées de gaz cyanhydrique pour y manipuler, démêler, extraire à grand ahan des milliers de cadavres hautement cyanurés et donc rendus intouchables sous peine de mort subite, aucun système de ventilation ne permettant d’extraire l’acide cyanhydrique qui s’est accumulé dans une matière vivante. Montrez-nous comment ces Sonderkommandos pouvaient sortir indemnes d’une telle opération pour recommencer le lendemain. » Je leur disais encore : « Voyez ces ruines et montrez-nous ne fût-ce que l’un des quatre orifices par lesquels vous osez prétendre que les Nazis déversaient les granulés de Zyklon B ! », ou « Montrez-nous de quoi étaient faites ces stupéfiantes cheminées de crématoires ! Crachant le feu jour et nuit, comment pouvaient-elles survivre à tant de feux de cheminée répétés quand on sait qu’un seul feu de cheminée entraîne nécessairement de longues réparations ? Comment expliquer que les performances de ces crématoires dépassaient de cent fois celles de nos fours les plus modernes pourtant équipés d’une assistance électronique ? ». « Montrez-nous ces merveilles d’horreurs ! », ou, comme on dit en anglais, « Trêve de discours : apportez le prodigieux pudding, que nous puissions juger par nous-mêmes de sa qualité ! ». Devant l’incapacité des affirmationnistes de l’« Holocauste » à mettre le pudding sur la table, je me suis permis de conclure : « No holes, no “Holocaust” » (Pas d’orifices [pas de trous], pas d’« Holocauste »). J’ai voulu dire par là : si, à Auschwitz, capitale de «l’Holocauste», vous ne trouvez pas la moindre trace de l’un de ces prétendus orifices de versement du poison, c’est que de tels orifices n’ont jamais existé ; le crime n’a donc pas même pu connaître un commencement d’exécution. Il fait beau voir comme, depuis plus de trente ans, Élie Wiesel et ses pareils se tortillent en tous sens et cherchent, en vain, à sortir des magiques chambres à gaz d’Auschwitz et de leurs introuvables trous.
Vous employez une expression anglaise qui signifie qu’avec mon histoire d’introuvable trou j’ai tiré ou attiré mon adversaire vers un « trou de lapin » (cuniculus) qui l’aspirera tout entier. Jugez-vous le procédé cruel ou perfide ? Croyez-vous que je vais plaindre ces gens qui du formidable mensonge de la Shoah ont fait une arme de destruction massive ? Sans une telle imposture, jamais la conquête de la Palestine n’aurait été concevable. Sans elle, pas de politique raciste, colonialiste et conquérante. Pas de colonies indéfiniment extensibles. Pas de mur tellement plus monstrueux que celui qu’on a appelé « le mur de Berlin ». Pas de milliards venus à flots de partout : d’abord d’Allemagne, véritable vache à traire, mais aussi de toute une série de pays européens, des États-Unis, des banques suisses, des compagnies d’assurances. Pas de musées de « l’Holocauste », avec, à la clé, de juteuses escroqueries, des chantages sans fin ; pas de guerres ou de menaces de guerre sous le prétexte d’empêcher de nouveaux « holocaustes », pas de chasses ouvertes aux «nazis», de livres saisis et brûlés, de révisionnistes jetés en prison dans des conditions abominables, dignes de Guantánamo ; pour ne prendre que son exemple, mon ami Ernst Zündel, qui va de prison en prison au Canada, aux États-Unis et en Allemagne, a été détenu, près de deux années durant, dans un cachot à Toronto, par la grâce du juge Pierre Blais ; privé de table, de chaise et même d’oreiller, il a été soumis à la faim, au froid, aux fouilles anales répétées et à la bave de chiens surexcités. Pour atteindre un tel résultat, les lobbies n’ont eu nul besoin de je ne sais quel complot. Ils ont simplement exercé l’implacable loi du plus fort, du plus riche, du plus influent, du plus inhumain. Ils n’ont, sur le plan officiel ou institutionnel, rencontré aucune opposition dans le monde occidental. Au contraire, nos belles consciences, nos professionnels des droits de l’homme ont fait chorus. Tout récemment, le révisionniste Vincent Reynouard, père de sept enfants, autrefois chassé de l’enseignement où il était adoré de ses élèves, réduit au chômage et vivant à l’étranger dans les conditions les plus précaires s’est vu condamner par le tribunal de Saverne à un an de prison ferme, à 10 000 euros d’amende et à 3 300 euros de dommages-intérêts ; ajoutons que le président du tribunal lui avait refusé le droit de présenter sa défense sur le fond. L’association « Liberté pour l’histoire » (Pierre Nora, Françoise Chandernagor, Grégoire Kauffmann) a été alertée du cas. Or elle n’a pas élevé la moindre protestation. Elle affecte de combattre toutes les lois mémorielles à commencer par la loi antirévisionniste qui protège la Shoah de toute contestation mais, en réalité, – un document vient de nous le révéler, – « Liberté pour l’histoire » recommande à ses membres de prendre la défense de la loi Fabius-Gayssot et d’empêcher le vote d’autres lois mémorielles (en faveur des Arméniens, des noirs, des Vendéens, …) ; autrement dit, sous couvert de défense générale des droits de l’homme, nos pharisiens défendent en réalité un privilège strictement juif.
XXX : J’ai l’impression que vous n’avez pas compris à quoi je pensais en écrivant : «Je vous assure que vous savez “draw the reader into a rabbit hole of absorption” ». Vous avez ajouté un développement qui confirme votre capacité à enfoncer vos adversaires, pourquoi pas, mais je parlais de votre pouvoir d’hypnose sur vos lecteurs, ce qui relève du romancier, et le rabbit hole, c’est celui d’Alice au pays des merveilles, qui la fait entrer dans un autre monde, monde à l’envers, monde qui donne les clés du monde dit réel, et qui est d’ailleurs terrifiant parce que le pouvoir n’y rencontre pas d’obstacle. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes plus captivant que les « vrais » historiens, ceux qui rédigent des sommes ! Et c’est probablement ce qui vous a rendu si dangereux, du point de vue de vos ennemis. C’est une preuve indirecte que vous êtes bien, quelque part, comme on dit, un créateur redoutable, irrésistible.
RF : Je n’avais pas saisi votre allusion à Alice’s Adventures in Wonderland, un récit que je n’ai complètement lu ni en anglais ni en français. Je vous présente mes excuses pour la confusion. En révisionniste, je rectifie donc le tir et, séance tenante, je vais traiter de la question que vous me posez.
Je suppose que pendant des années vous avez suivi de près la polémique. Vous avez pu observer mes adversaires. Vous avez lu leurs écrits. Vous avez assisté à certains des procès qu’ils m’intentaient ou que je leur intentais. Vous avez donc eu tout loisir de constater à quel point ces gens ont dû changer leur musique. Au début, ils ont voulu me répliquer sur le plan de la raison comme dans tout débat historique. Puis, progressivement, ils ont perdu pied. Leur désarroi est devenu patent. Les Poliakov et les Vidal-Naquet se sont ridiculisés. Peut-être me jugerez-vous présomptueux mais je tiens qu’il y a vingt-huit ans j’ai, sur le plan de l’argumentation, anéanti mes adversaires, et cela d’un coup, d’un seul. Dans la livraison du Monde du 29 décembre 1978 et dans celle du 16 janvier 1979, j’ai démontré la totale impossibilité physique de l’existence des prétendues « chambres à gaz » nazies. J’ai prouvé que, techniquement, le formidable meurtre de masse imputé à l’Allemagne était impossible. Ou alors, s’il était possible techniquement, il fallait me l’expliquer. Pendant plus d’un mois, j’ai attendu leur explication, qui m’est enfin parvenue, le 21 février 1979, sous la forme d’un manifeste, publié dans Le Monde et intitulé Une déclaration d’historiens. Trente-quatre universitaires ou historiens signaient ladite déclaration. Parmi les signataires figurait le plus prestigieux des historiens au monde : Fernand Braudel. On remarquait également les noms de Philippe Ariès, Pierre Chaunu, François Furet, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie, Pierre Vidal-Naquet et Léon Poliakov. Que me répondait ce beau monde ? Il me faisait savoir qu’il n’avait pas de réponse. En propres termes, il décrétait : « Il ne faut pas se demander comment, techniquement, un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible techniquement puisqu’il a eu lieu. » C’était là signer en fanfare un acte de capitulation. Nous sommes en 2007. Jamais depuis 1979, c’est-à-dire en vingt-huit ans, je n’ai reçu d’autre réponse. Par la suite, mes adversaires avaient tenté des parades à la manière du couple Klarsfeld, engageant à leur service le malheureux Jean-Claude Pressac, lequel a fini par les abandonner et capituler en rase campagne. Au palais de justice de Paris, un avocat, Bernard Jouanneau, a multiplié les subterfuges jusqu’à tenter de substituer de faux procès à la place des vrais, ce qui semble avoir consterné jusqu’aux présidents des tribunaux ou des cours devant lesquels il plaidait. Pendant ce temps, la bibliographie holocaustique a enflé dans des proportions vertigineuses mais, plus elle a accumulé d’études, plus elle a, par le fait, étalé son impuissance à répondre aux arguments des révisionnistes. Comme je vous l’ai dit, le Number One des historiens orthodoxes, Raul Hilberg, a fini par chercher refuge dans une sorte d’histoire irrationnelle sinon cabalistique ou métaphysique. Du coup, on peut avoir l’impression que les révisionnistes sont dotés de bien d’autres moyens que ceux de la pure logique. Effectivement, dérisoires en nombre et pitoyables en moyens, comment peuvent-ils ainsi tenir tête à une aussi puissante coalition d’intérêts ? On en vient ici à votre observation : au palais de justice, le révisionniste semble doté d’un pouvoir d’hypnose ; du moins est-ce l’impression qu’il donne là où il peut affronter son adversaire physiquement et face à face, c’est-à-dire au prétoire. Lors de procès en cascade, les représentants du ministère public et les avocats de la LICRA, du MRAP, de la Ligue des droits de l’homme, de SOS-Racisme ou du sieur Badinter semblent frappés d’une incapacité croissante. Ils sentent la partie leur échapper. Les magistrats qui président nos tribunaux ou nos cours ont beau alors recourir aux tentatives d’intimidation, le révisionniste qui ne se laisse pas faire poursuit sa course. Pour reprendre vos propres expressions, ce dernier s’apparente alors à celui qui, par un récit apparemment dégagé des contingences purement historiques, décrit un monde inattendu « qui donne les clés du monde réel ». Il crée ce monde d’une manière spontanée, franche, irrésistible. Il est possible qu’il captive. Comme dans les expériences que décrit Proust, celui qui prête une oreille attentive à la démonstration du révisionniste voit peu à peu se déployer sous ses yeux un paysage harmonieux ; il se dit qu’il aurait dû d’emblée percevoir cette harmonie ; il était passé devant ce paysage sans même jamais le voir. Il marchait en automate, perdu dans ses pensées qui n’étaient peuplées que d’extravagances et de visions cauchemardesques quand, tout à coup, par chance, un rai de lumière a dissipé ces fantasmagories et l’a ramené à la réalité. Le révisionniste ne possède pas la baguette magique de Lewis Carroll, de Marcel Proust, de tel romancier ou de tel artiste mais il a ramené au jour un monde enfoui sous des strates d’immondices. Pour faire bonne mesure, ajoutons que le révisionniste, qui n’a pourtant rien d’un évangéliste, apparaît, de surcroît, comme le porteur d’une bonne nouvelle. Il appelle son auditoire à sortir d’une vision infernale et névrotique de l’histoire. Il lui annonce que l’humanité, pourtant capable des crimes les plus révoltants, n’a tout de même pas perpétré cet « holocauste » qui, pour une nation européenne comme l’Allemagne essentiellement faite de chrétiens, aurait, dit-on, consisté à enfourner dans d’immenses abattoirs chimiques de pauvres victimes sans défense, et cela, jour après jour et année après année ; pour finir, d’après l’accusation, cet « Holocauste », avec sa majuscule, se serait produit dans l’indifférence générale, tous les gouvernements de la terre se moquant, paraît-il, qu’en plein XXe siècle Satan fût revenu sur terre afin d’y procéder, selon une politique concertée, à l’abattage systématique de millions d’hommes, de femmes et d’enfants. Sur tous les tons on nous a seriné que la patrie de Goethe et de Beethoven avait commis un crime sans précédent ; on a disserté sur le caractère déconcertant d’un tel contraste ; on en a tiré des conséquences morales, politiques et philosophiques à portée économico-financière, mais voilà que tout cela se révèle faux et que le prétendu contraste n’existe tout simplement pas. Précisément parce qu’elle était la patrie de Goethe et de Beethoven, l’Allemagne n’avait commis ni pu commettre pareille monstruosité. Quel soulagement que de l’apprendre mais aussi quelle angoisse n’éprouve-t-on pas en découvrant la somme de mensonges qu’il a fallu accumuler pour nous faire croire le contraire !
Un révisionniste n’est en soi ni plus ouvert ni plus clairvoyant que le commun des mortels. Simplement, il a, un beau jour, appliqué à un sujet historique donné un principe qui s’enseigne partout mais qu’on ne met guère en pratique dès lors qu’il y a un extrême danger à le faire : le principe de la table rase. Qui s’avise d’apprendre doit commencer par désapprendre. Il s’efforcera d’oublier ce qu’il croit savoir. Partant d’un pas aussi résolu, le révisionniste conséquent n’aura besoin ni de tricher ni de mentir. Il lui suffira d’être exact, c’est-à-dire de ne puiser désormais que dans la réalité des seuls faits vérifiables. Dans l’édifice qu’il construira, tout viendra alors s’agencer normalement et ce que vous appelez « la stricte vérité des faits avérés » finira par composer un ensemble cohérent. Celui pour qui deux et deux font quatre peut avancer d’un pas tranquille ; en revanche, ceux qui, tordant les faits et les chiffres, veulent nous donner à croire qu’à un moment exceptionnel de l’histoire des hommes deux et deux ont soudainement fait six (ou six millions), ceux-là s’engagent dans une voie périlleuse. Pour les besoins de leur démonstration, il leur faudra multiplier les falsifications et donc les risques de voir démasquer leur entreprise. C’est ce qui est arrivé à nos gardiens de l’orthodoxie shoatique dont nous avons, nous autres révisionnistes, dévoilé tant de manipulations et de fabrications de textes et tant de malhonnêtetés en tout genre.
XXX : Vous voulez donc à nouveau revendiquer votre statut d’historien qui devrait observer une stricte fidélité aux faits avérés. Vous tenez à revenir sur le terrain où vos ennemis vous rétorquent que vous êtes un pseudo-historien et un menteur. Soit! L’Espagne vient de produire un texte constitutionnel[4] qui consacre votre activité comme celle d’un historien, qui la situe dans le domaine de la science, et qui, comme vous, met la science au fondement d’une société libre et démocratique ; le domaine de la science doit être plus libre encore, dit ce texte, que d’autres domaines d’expression. Apparemment, ces juristes continuent de se fonder sur l’Évangile où il est dit : « La vérité vous rendra libres » (Jean, 8, 32) ; leur foi dans la valeur libératrice de la connaissance va loin, puisqu’ils ne retiennent pas l’argument qu’une thèse comme la vôtre, qui incrimine un certain nombre d’autorités juives, puisse comporter en soi de danger pour les juifs en général. Non, tout bien considéré, le tribunal constitutionnel espagnol ne croit pas que : « la conduite sanctionnée consistant à diffuser des opinions qui nient le génocide soit en vérité propre à créer une attitude d’hostilité envers le collectif affecté. ». Il y a là un acte de confiance dans l’humanité et le texte est superbement quichottesque. Nous voilà donc revenus sur le terrain de la création de vérité par les artistes, dont vous êtes. On pourrait vous en féliciter et vous remercier, vous qui avez tant argué, d’avoir été pour votre temps une sorte d’argonaute sans peur et sans reproche ; ceux qui n’ont pas la parole vous sauront gré d’avoir ainsi nargué une insupportable police de la pensée que vient, à sa façon, de condamner le Tribunal constitutionnel espagnol.
RF : Il est exact qu’à Madrid, le 7 novembre 2007, le Tribunal constitutionnel a décidé que l’équivalent de notre loi Fabius-Gayssot était contraire à la constitution espagnole. Il l’a fait au moment où allait se décider le sort de Pedro Varela, condamné à cinq ans de prison ferme essentiellement pour publication et diffusion d’œuvres à caractère révisionniste. Sur le moment, cette décision du Tribunal constitutionnel m’a d’autant plus surpris que l’Espagne venait de livrer honteusement à l’Autriche le révisionniste autrichien Gerd Honsik ; depuis quinze ans, ce dernier vivait du côté de Malaga en réfugié politique ; après son extradition vers l’Autriche, ordonnée par les autorités espagnoles, un tribunal de Vienne vient de le condamner à dix-huit mois de prison ferme. Ma surprise n’a fait que croître à la lecture du long texte où les magistrats espagnols, se livrant à une analyse fouillée du droit à la liberté de recherche, font montre d’une finesse et d’une audace qui ne se rencontrent guère chez les magistrats de bien d’autres pays. Vous avez raison de parler d’« un texte superbement quichottesque ». Cervantès n’aurait pas mieux fait. Mais qui sait si, dans un proche avenir, une loi européenne ne permettra pas aux autorités politiques espagnoles de réintroduire dans leur code pénal le délit de révisionnisme ? Rappelez-vous la victoire remportée par Ernst Zündel, le 27 août 1992, quand, au terme d’un combat judiciaire de neuf ans, il avait obtenu que la cour suprême du Canada, pays où il résidait, déclarât contraire à sa constitution la loi qui avait permis à des associations juives de le poursuivre, de le persécuter et de le faire condamner à la prison. Décidés à obtenir néanmoins un jour la condamnation de leur bête noire, ces associations ont par la suite mené campagne pour l’instauration au Canada de tribunaux « spéciaux » appelés « tribunaux des commissions des droits de l’homme». Les parlementaires se sont empressés de leur donner satisfaction. À la différence des tribunaux ordinaires, constitués d’un jury et d’un président censé être impartial, ces tribunaux spéciaux ne sont dotés d’aucun jury et leurs juges sont recrutés d’après leur « sensitivity » à ce qu’il est convenu d’entendre par « racisme », « antisémitisme » et « droits de l’homme ». Mieux : alors que normalement tout tribunal considère que l’accusé a le droit de faire valoir pour sa défense que ce qu’il a dit ou écrit correspond à une vérité vérifiable, le « tribunal spécial » canadien, après vous avoir fait prêter serment de « dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité », vous notifie qu’en fait la vérité ne l’intéresse guère. Les juges vous le déclarent tout de go : « Ici vérité n’est pas défense » (Here truth is no defence). Le seul point qui importe à ces juges de particulière « sensitivity » est de savoir si, et dans quelle mesure, ce que vous avez dit ou écrit cause, ou peut causer, du tort à « un segment déterminé de la société canadienne ». Ces étranges juges sans jury recueillent dans le secret des dépositions de témoins dont les noms ne seront pas révélés et qui ne pourront être interrogés par la défense. Disposant en quelque sorte d’un thermomètre mental, ils se donnent pour tâche d’évaluer le degré de fièvre qu’un écrit révisionniste provoquera chez un lecteur judéo-canadien. Je crains que les organisations juives espagnoles et internationales ne mènent le sabbat pour obtenir le contournement de la décision « quichottesque » du 7 novembre 2007. En France, la répression judiciaire du révisionnisme va s’aggraver encore en 2008 et les juges de Paris et de province vont probablement vous étonner par leur cynisme, notamment dans l’affaire de Georges Theil et dans celle de l’héroïque Vincent Reynouard (jeune père de sept enfants).
À ce que je vois, vous comprenez le sens de mon combat. Souffrez que je vous en fasse la confidence : tout à fait au début, quand j’ai accepté le principe de cet entretien, je n’étais pas sûr d’un tel degré de compréhension de votre part. Par la suite, dans vos questions, qui me sont parvenues au fur et à mesure de mes réponses, j’ai craint d’avoir à me justifier laborieusement : je vous sais gré de m’avoir épargné cette peine. Enfin je vous suis reconnaissant de m’avoir, par des remarques inattendues, ouvert la voie à quelques nouvelles réflexions sur l’exaltante et angoissante aventure intellectuelle qu’est décidément le révisionnisme historique.
XXX : En ce qui me concerne, oui, votre combat me semble avoir toute sa place et je suis déçue qu’en France il ne se soit pas trouvé avant moi plus de gens pour avoir la curiosité de chercher en quoi votre passion pour l’exactitude en histoire est liée à votre passion pour les lettres et en reste dépendante. Je suis beaucoup plus jeune que vous ; j’arrive donc après la bataille et vous êtes pour moi une donnée parmi d’autres ; vous faites partie du paysage, en quelque sorte. Vous en êtes même, du fait de la persécution, une sorte de centre aveuglant, qui écrase et qui réduit à peu de chose bien des rivaux dans vos domaines d’intérêt ; du fait de votre existence, ces rivaux apparaissent comme fades, pleutres, quelconques. Je ne dirais pourtant pas que je vous approuve totalement, car j’estime que vous avez – certes sans le vouloir – retardé l’apparition de penseurs d’origine juive assez courageux pour prendre le taureau par les cornes et accepter ce qu’il y a de sain et d’indispensable dans votre rigueur d’archéologue. Vous avez poussé « les juifs » à s’enfoncer dans leurs vieilles habitudes, à revenir à leur ancienne image, rebutante. Votre insolence a provoqué une telle animosité que vos fils spirituels se sont trouvés bâillonnés, condamnés d’avance si bien que le malentendu n’a fait que croître. Mais laissons cela pour un livre, qui s’intitulerait « Les ironies de l’histoire contemporaine » ou « Les facéties macabres du destin ». Espérons que le portrait de vous que nous avons ensemble mis au jour dans cet entretien aidera les honnêtes gens à découvrir une nouvelle lecture de notre époque. J’ai tenté de vous arracher à vos sujets habituels de réflexion, de vous mettre en vacances, de vous ramener au monde des belles-lettres, de la contemplation poétique et de la beauté intemporelle sous toutes ses faces, mais, en fin de compte, vous serez revenu à ce qui, pour vous, est au centre de la maladie mentale de notre temps, et vous vous serez retrouvé dans l’univers du tribunal de l’histoire. Vous poursuivez encore aujourd’hui la course sans fin où vous vous étiez lancé quand, en 1980, vous aviez publié votre Mémoire en défense contre ceux qui m’accusent de falsifier l’histoire. Je me refuse à débattre de vos arguments et à juger de leur valeur. Je constate que vous êtes un roc de conviction et que vous avez édifié au milieu de l’histoire de la pensée française un bloc de marbre ; ceux qui vous dénient le droit de vous exprimer, ceux qui vous nient ou vous renient, ceux-là, rien ne les sauvera de l’oubli ou du mépris. Dieu fasse que les lecteurs de notre échange trouvent ici de nouveaux terrains de rencontre et que ne s’aggravent plus les rancoeurs !
RF : En guise de conclusion personnelle, permettez-moi, je vous prie, quelques autres confidences : la première portera sur mon « apostolat » révisionniste, la deuxième sur la contribution du révisionnisme à la libération des peuples opprimés et la troisième sur une déclaration que j’entends faire à mon prochain procès.
C’est en quelque sorte par devoir de conscience que, dans mes travaux, j’accorde la priorité au révisionnisme historique mais, par goût, ma préférence va au révisionnisme littéraire. Réviser l’histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale, c’est avoir à se plonger, d’une part, dans les horreurs réelles de la guerre et, d’autre part, dans les abjections qu’une certaine propagande leur a surajoutées. Tout au contraire, réviser l’étude d’œuvres littéraires, c’est, la plupart du temps, évoluer dans le monde de la beauté, celui, précisément, des belles-lettres. Peut-être le savez-vous, c’est Descartes en personne qui a écrit : « La poésie a des délicatesses et des douceurs très ravissantes ». La phrase se lit dans son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Me pliant à la discipline enseignée par Descartes (« Je réputais pour faux tout ce qui n’était que vraisemblable »), j’ai cherché à être exact dans la science historique. Auparavant, j’avais voulu être exact dans l’étude d’œuvres littéraires et en particulier dans l’analyse de textes poétiques, à telle enseigne, d’ailleurs, que j’avais mis en chantier un ouvrage intitulé Poésie et précision. Le sort a voulu que je « m’opère vivant de la poésie ». Ce n’est pas là le seul sacrifice que j’aie dû consentir à la cause du révisionnisme historique, une cause que j’ai embrassée, vous l’aurez compris, à mon corps défendant.
La déréliction du peuple palestinien est un crève-cœur. Surtout depuis 1948, la création, par la violence guerrière, de l’État sioniste témoigne d’un esprit de domination coloniale qui est d’un autre temps. Dans le monde occidental, nos télévisions, au lieu d’évoquer « l’Holocauste », devraient chaque jour nous rappeler qu’il existe en terre de Palestine un vaste camp, celui de Gaza, où se concentrent les derniers résistants à l’oppression ; il y existe également des « colonies » où s’installent des voleurs de terres, un apartheid plus humiliant que celui de l’Afrique du Sud, un mur bien plus monstrueux que celui de Berlin, des dizaines de milliers de prisonniers et du million de Palestiniens traités, sur leur propre terre, en sous-hommes ; et je ne parle pas des millions de Palestiniens qui ont dû s’exiler à travers le monde et auxquels le colonisateur refuse le droit au retour. Bardée d’armes nucléaires, militarisée comme aucune autre communauté au monde, méprisant souverainement les décisions de l’ONU, inondée d’argent qu’elle extorque aux grandes puissances, l’entité sioniste exerce sa tyrannie au moyen du plus fabuleux mensonge de notre temps, celui de « l’Holocauste ». Et l’on attendrait de moi que je détourne mon regard de ce crime permanent et de cette imposture ? Il n’en est pas question. Je garde présente à l’esprit la constatation faite en 1979 par l’universitaire australien W. D. Rubinstein : « Si l’Holocauste venait à apparaître comme une imposture, l’arme n° 1 de l’arsenal de la propagande d’Israël disparaîtrait. » Mon révisionnisme est la seule contribution que je puisse apporter à ce peuple en détresse. (Pour ne rien vous cacher, j’ai aussi cherché à venir en aide aux Palestiniens par d’autres moyens, y compris les plus dérisoires. Je ne citerai qu’un exemple : j’ai versé mon obole, relativement importante au vu de mes propres ressources, à une association appelée « Les amis de Jayyous » et dirigée par un couple de Français désireux de venir en aide à un village palestinien de ce nom. Peine perdue : l’argent m’a été retourné ; ces Français-là ne voulaient rien me devoir).
La prochaine fois que je me trouverai devant un tribunal, je me fendrai d’une déclaration dont je tiens à vous donner la primeur, en substance. C’est par la grâce de Jacques Chirac que je passerai, une fois de plus, à la XVIIe chambre. «Supermenteur» (c’est le sobriquet dont l’avait affublé une émission satirique) avait, en décembre 2006, demandé l’ouverture d’une enquête judiciaire au sujet de ma participation à la conférence de Téhéran. Une fois de plus, « Supermenteur » se portait ainsi, toute honte bue, au secours du « Supermensonge » de «l’Holocauste». Il lui fallait un certain aplomb pour faire grief à un citoyen britannique et français d’avoir tenu, en anglais, dans un pays étranger, l’Iran, des propos qui, pour commencer, n’enfreignaient aucune loi de ce pays. Il ne serait pas venu à l’esprit des autorités britanniques de me poursuivre en justice pour un tel motif, mais apparemment la République française est prête à régenter le monde entier. À mon procès, je n’aurai malheureusement plus l’assistance de mon fidèle avocat, Éric Delcroix, qui vient de prendre sa retraite. Ni lui, ni moi nous ne lui trouvons de successeur. Les chers confrères veulent bien à la rigueur me défendre mais à la condition que je ne défie (ou ne nargue ?) aucune autorité du lobby. Je n’irai pas demander au très prochain bâtonnier de me désigner un avocat d’office : ainsi que je vous l’ai dit, il porte le beau nom de Christian Charrière-Bournazel mais – j’ai omis de vous le préciser jusqu’à présent – il ne manque aucune occasion de clamer que mes écrits ne sont que de l’ordure, de la boue, ajoutant que, lorsqu’il lui faut plaider contre moi, il se tient pour « un éboueur sacré » (sic).
À mes juges, je dirai que, dans le prétoire, ils sont tout et que je ne suis rien et que, d’évidence, lorsque le prévenu est un révisionniste, il n’y a plus ni foi, ni droit, ni loi. L’expérience, en effet, m’a appris que, lorsque je suis l’objet d’une agression physique, fût-elle particulièrement grave, la police judiciaire ne trouve jamais les agresseurs et que, si je suis la victime d’une indéniable diffamation, les tribunaux prononceront à tout coup que j’ai été diffamé… mais « de bonne foi » (pour le dernier exemple en date d’une telle diffamation, voyez le cas de Robert Badinter). Je sais que si, à l’occasion, des magistrats déclarent que mon travail est exceptionnellement sérieux, ils en concluront néanmoins… que j’en suis d’autant plus dangereux. Je sais que les témoins de la partie adverse peuvent proférer sous serment les plus éhontés mensonges jusque sur le compte de ma carrière universitaire et qu’ils ne seront jamais poursuivis et condamnés pour faux témoignage. Mais j’ai la conviction que mes recherches historiques honorent mes deux patries : la Grande-Bretagne, qui me laisse m’exprimer, et la France, qui s’acharne à vouloir me bâillonner. Enfin, d’une manière plus générale, l’ensemble des auteurs révisionnistes a honoré la science historique et continuera de l’honorer. En revanche, les magistrats qui croient devoir châtier les révisionnistes pour leurs travaux et leurs découvertes se déshonorent et se condamnent eux-mêmes. Le profane s’imagine volontiers que le magistrat est contraint d’appliquer la loi. C’est inexact. De toute loi, le magistrat peut, à volonté, décréter qu’elle ne peut pas s’appliquer en la circonstance, par exemple pour tel motif de fond ou de forme invoqué par la défense. S’il estime qu’elle s’applique, il peut en faire une application extensive ou restrictive. En dernier recours, il pourra prononcer une condamnation qui, dans les faits, sera proche de la relaxe. En France, le cas s’en est déjà trouvé et des magistrats ont su ainsi marquer leur désaccord avec la répression légale du révisionnisme. Et puis, Éric Delcroix en a souvent fait la remarque, un juge peut aujourd’hui refuser d’appliquer une loi ; depuis le Nouveau Code pénal de 1993, ce juge-là n’est plus passible du crime de forfaiture.
De toute façon, comme par le passé, sans doute perdrai-je mes procès mais je gagnerai ma cause, celle du révisionnisme historique et je persisterai à mettre mes pas dans ceux de Jean Norton Cru, de Maurice Bardèche et de Paul Rassinier.
Jean Norton Cru (1879-1949), né d’un père pasteur protestant languedocien et d’une mère anglaise, a consacré l’essentiel de sa carrière à l’enseignement de la littérature française au collège de Williamstown, dans le Massachusetts ; de 1914 à 1918 il a combattu dans les rangs de l’armée française ; en 1929, il a publié Témoins et Du témoignage, deux œuvres courageuses, sagaces, précises, rédigées en une langue élégante et sobre.
Maurice Bardèche (1907-1998) a enseigné la littérature française à La Sorbonne et à l’Université de Lille ; il a été bouleversé par les horreurs de l’Épuration et, en particulier, par l’assassinat judiciaire de son beau-frère, Robert Brasillach, fusillé le 6 février 1945 ; théoricien du fascisme « républicain », il est connu en particulier pour ses ouvrages sur Balzac, Stendhal, Proust et Céline, pour son Histoire de la guerre d’Espagne et son Histoire du cinéma (deux livres publiés avant la guerre en collaboration avec R. Brasillach) et, surtout, pour Nuremberg ou la Terre promise (1948) et Nuremberg II ou les Faux-Monnayeurs (1950), deux études charpentées, à l’argumentation serrée, à la documentation choisie, au style soutenu ; il sera chassé de l’enseignement public et condamné à la prison.
Paul Rassinier (1906-1967), d’abord communiste, puis socialiste et pacifiste, était instituteur. Cofondateur d’un réseau de la Résistance, il a été arrêté par les Allemands et déporté à Buchenwald et à Dora. De retour en France dans un déplorable état de santé, il a constaté en lisant les témoignages sur les camps de concentration allemands un amas d’exagérations et de mensonges. Il a voulu en faire état dans Le Mensonge d’Ulysse (1950) ainsi que dans Ulysse trahi par les siens (1961) et il a poursuivi dans quelques autres ouvrages toute une étude de la propagande des vainqueurs sur le compte des vaincus. Auteur d’écrits littéraires et historiques, l’humble instituteur a su en remontrer aux plus grands historiens de son temps. Il est aujourd’hui lourdement calomnié sans plus pouvoir répondre à ses détracteurs. – Permettez-moi de dédier notre entretien à sa mémoire et à celle de son épouse. C’est à cette dernière que je dois de posséder dans ma bibliothèque les quarante et un volumes de la version française du procès de Nuremberg, remarquablement annotés, à l’encre bleue, par Paul Rassinier.
F I N
Notes
[1] Julius Streicher (1885-1946), fils d’instituteur et lui-même instituteur, a eu durant la Première Guerre mondiale une conduite particulièrement valeureuse. En 1922 il adhère au Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP). En 1923 il fonde l’hebdomadaire Der Stürmer (« L’Avant »). La même année, Hitler le charge d’organiser à Munich la « marche de la Feldherrnhalle » : la tentative de putsch échouera. En 1933 il dirige le « Comité central de défense contre la propagande juive avec ses récits d’atrocités pour inciter au boycott [de la nouvelle Allemagne] » (Zentralkommittee zur Abwehr der jüdischen Greuel- und Boykotthetze) et, en riposte au boycott exercé par les juifs de l’étranger contre son pays, il appelle ses compatriotes à boycotter les juifs allemands. Il est nommé Gauleiter de Franconie, mais tombe en disgrâce dès 1940 sur la foi d’accusations qui lui vaudront de passer devant un tribunal d’honneur pour « escapades sexuelles » (Robert Wistrich) ; il ne sera pas condamné mais l’affaire lui causera un tel dommage que, pendant toute la durée de la guerre, il en sera réduit à publier son hebdomadaire, dont la diffusion va diminuer de plus de la moitié. Der Stürmer, que Hitler lui-même aurait, dit-on, apprécié, avait mauvaise réputation auprès de beaucoup de nationaux-socialistes qui lui reprochaient la crudité de ses campagnes et de ses caricatures antijuives. Comparées à ce qui, dans le camp opposé, se publiait contre les « Nazis », ces campagnes et ces caricatures étaient pourtant de bonne guerre. Elles n’ont jamais appelé à la violence physique contre les juifs ni, à plus forte raison, à leur élimination physique. Au procès de Nuremberg, J. Streicher a, comme les autres accusés, exprimé sa stupéfaction face à l’accusation selon laquelle le Troisième Reich avait, paraît-il, suivi une politique d’élimination physique des juifs, décidée par Hitler. Le 29 avril 1946, soit près de six mois après le début du procès, il a eu le courage de déclarer qu’il ne croyait pas à ce massacre de cinq millions de juifs (chiffre alors brandi par l’accusation) ; il a ajouté : « Du point de vue technique, je considère la chose comme impossible. Je n’y crois pas. Je n’en ai jusqu’ici aucune preuve. » Mais quand, quatre mois plus tard, la parole lui a été laissée pour une très brève déclaration finale, il a cru devoir imputer à Hitler et à Himmler ce gigantesque crime dont, avec le peuple allemand ainsi déshonoré, il n’avait jamais soupçonné l’existence. Condamné à mort pour avoir, par ses écrits, contribué à l’extermination des juifs, il a été pendu ou, plutôt, semble-t-il, longuement étranglé. Son cadavre a été placé dans un cercueil sur lequel on a, par dérision, inscrit le nom d’« Abraham Goldberg ». Il a été incinéré et ses restes, comme ceux des autres exécutés, ont été jetés aux quatre vents au-dessus d’un petit affluent de l’Isar, près de Munich. L’Inquisition ne procédait pas autrement avec les restes des hérétiques brûlés au bûcher.
[2] Joseph Delteil (1894-1978) est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, dont Sur le fleuve Amour (1923), Choléra (1923), Saint Don Juan (1930), Jésus II (1947) et François d’Assise (1949). Il est surtout connu pour sa Jeanne d’Arc qui, en 1925, obtint le prix Fémina et lui valut d’être répudié par les surréalistes. Voici quelques extraits du livre (Librairie Grasset, Les Cahiers verts publiés sous la direction de Daniel Halévy) :
- « Je dédie ce livre d’amour aux âmes simples, aux cœurs fous, aux enfants, aux vierges, aux anges… ».
- « Jeanne vint au monde à cheval, sous un chou qui était un chêne » (premiers mots du chapitre premier, intitulé « Bébé »).
- « Jeanne naît dans un cri d’oiseau. La vie la reçoit sur une nappe blanche » (p. 3).
- « Jeanne est du côté de Pascal, du côté de Danton, du côté de Nietzsche. Jeanne d’Arc fait ses batailles comme Joseph Delteil fait ses romans : Va, va, va ! » (p. 180).
- « Soudain sur une borne milliaire, elle lut : DOMRÉMY, 120 kilomètres » (p. 188).
- « [À Rouen, le bourreau] attisa la braise, y jeta ce cœur. En vain. Le cœur de Jeanne est incombustible. Le bourreau, honteux, s’acharnait. Il l’arrosait d’huile, de soufre. En vain ! Ce cœur restait frais et rose. Alors, affolé, le bourreau, en courant, alla le jeter dans la Seine. – La foule s’en allait, soufflante, à longues enjambées. On fuyait ce lieu honteux. Soldats et prêtres couraient en débandade. Les moines s’éloignaient en faisant des signes de croix. Le cardinal d’Angleterre [le prince cardinal de Winchester] déguerpissait à cheval, criant rouge à travers la ville : “Nous sommes tous foutus, nous avons brûlé une Sainte !” » (derniers mots de la dernière page).
[3] Cette formulation pour écoliers trouve sa source au premier livre des Géorgiques de Virgile, où se lit en fait : « Labor omnia vicit / Improbus » ; l’emplacement de l’adjectif est ici on ne peut plus explicite ; quant à « vicit », il joue le rôle d’un « parfait d’habitude », à traduire en français par le présent. En tête de nos copies, l’adage était surmonté des lettres « AMDG », initiales d’« Ad majorem Dei gloriam » ce qui signifie : « Pour la plus grande gloire de Dieu », mais, le texte latin portant « majorem » et non « maximam », la traduction adéquate serait plutôt : « Pour accroître la gloire de Dieu » car, ce dernier étant tenu pour le Créateur par excellence, quiconque entend œuvrer dans son esprit doit se fixer pour tâche d’accroître la gloire de Dieu par son propre travail.
[4] Cette décision de la plus haute juridiction espagnole est consultable à https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6202.