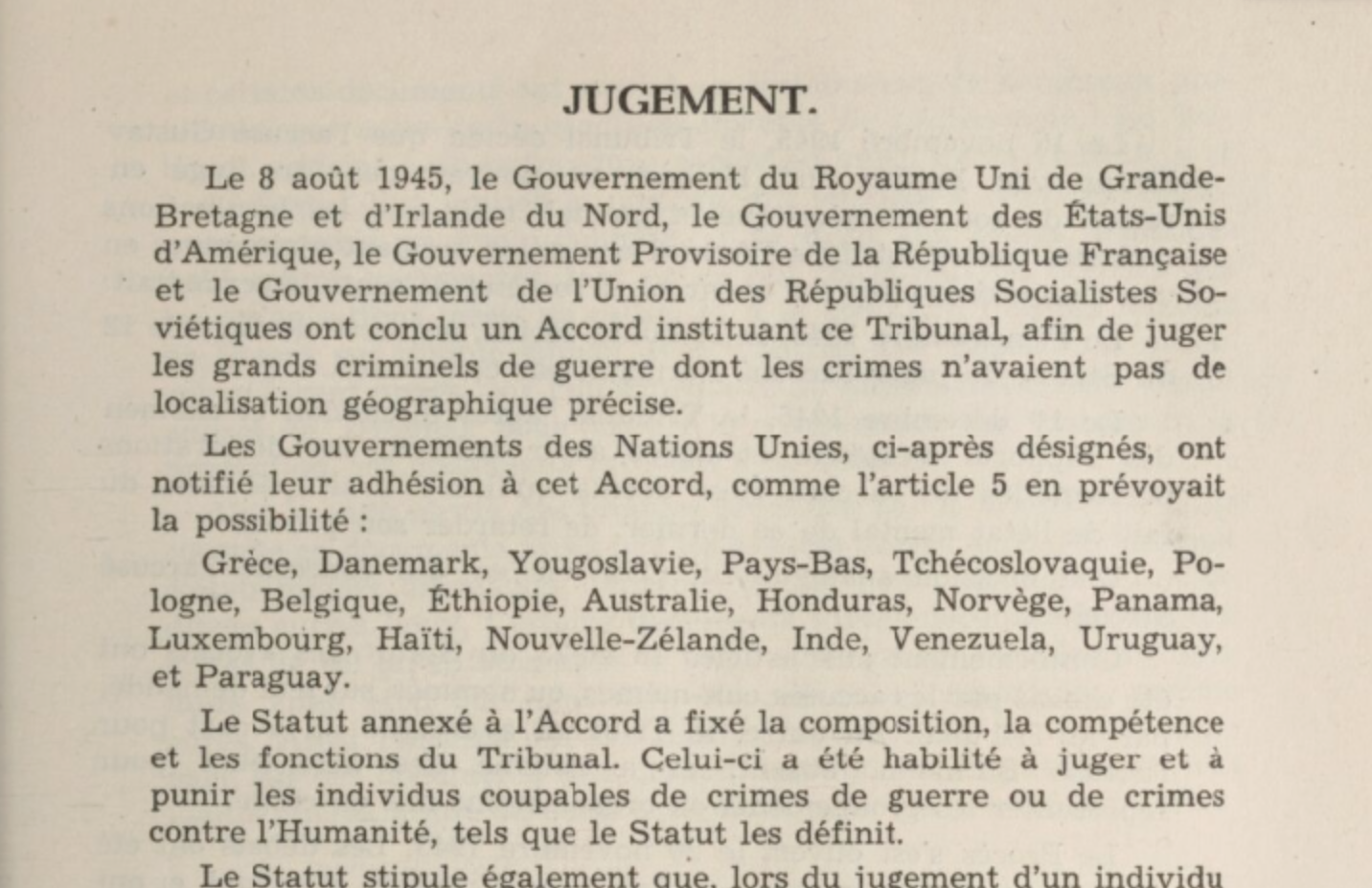Contestations du jugement de Nuremberg par les historiens orthodoxes
La loi Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990 interdit la contestation de l’existence des « crimes contre l’humanité », tels que définis et punis, juste après la guerre, par le Tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg. Des vainqueurs jugeant des vaincus ont, sans aucun recours à des historiens, déclaré conformes à la vérité historique un certain nombre d’affirmations non démontrées. Nous sommes libres de contester ces affirmations sans preuve, telles qu’elle figurent dans le texte du jugement à l’exception toutefois de l’une d’entre elles, et une seule : celle qui se trouve concerner les juifs avec leur prétendue extermination et leurs prétendues chambres à gaz. Comme ce sujet-là occupe, en deux fragments distincts, 3 pages ½, soit 2% des 187 pages de la version française du jugement, on s’étonne du traitement de faveur qui fait qu’environ 98% du jugement sont contestables et que seuls environ 2% du même jugement sont, en 1990, devenus incontestables sous peine de prison, d’amende et de peines diverses. L’histoire des hommes est tissée de milliards d’événements sur la nature de chacun desquels nous sommes libres, en France, de publier le résultat de nos recherches. Bizarrement, un seul sujet est à jamais interdit de véritable recherche et de contestation : cette extermination des juifs avec ses chambres à gaz.
En quinze années (1991-2005) d’application de la loi Fabius-Gayssot, les magistrats français ont, pour leur honneur, manifesté de plus en plus de répugnance à obéir aux injonctions du législateur socialo-communiste de 1990. Cela se comprend quand on sait que, depuis 1951, les historiens qui soutiennent la thèse du génocide et des chambres à gaz ont, à leur corps défendant, révisé les vérités, c’est-à-dire les mensonges, du tribunal de Nuremberg. Même s’ils cherchent à les noyer dans un flot de considérations rituelles et orthodoxes, les admissions, les concessions et parfois même les redditions ou capitulations de ces historiens conventionnels donnent raison aux révisionnistes. L’article 21 du statut du TMI disposait : « Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. » Aujourd’hui, les faits tenus pour acquis par ce tribunal offrent le spectacle d’un champ de ruines. On peut en juger par la lecture des quelques révisions déchirantes qui suivent. Ne sont pas ici pris en considération les innombrables faux dont on a fait usage devant ce tribunal qui, dans l’article 19 de son statut précisait : « Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves » : faux savon juif, faux abat-jours de peaux humaines, fausse tête réduite, cheveux, chaussures, lunettes de récupération présentés comme cheveux, chaussures, lunettes de gazés, cadavres de morts présentés comme cadavres de tués, cadavres de victimes de bombardements anglo-américains présentés comme cadavres de victimes des Allemands, présentation en chambres à gaz d’exécution de locaux qui n’étaient en réalité qu’une salle de bains ou un garage ou un dépositoire de morgue ou une unité de désinfection/désinfestation (Entwesung/Entläusung), faux documents comme le factum Hitler m’a dit attribué à Hermann Rauschning (ce faux a été considérablement utilisé par les ministères publics soviétique et britannique), innombrables faux témoignages oraux ou écrits, chiffres délirants, etc. À titre d’exemples, voici quinze spécimens de ces contestations émanant de sources purement exterminationnistes ou affirmationnistes.
1) En 1951 Léon Poliakov écrit au sujet de la «campagne d’extermination des juifs» : « Aucun document n’est resté, n’a peut-être jamais existé » (Bréviaire de la haine, Calmann-Lévy, Paris 1974 [1951], p. 171).
Remarque : de quel droit interdire la contestation d’une histoire qui ne repose sur aucun document ?
2) En 1960 Martin Broszat, membre de l’Institut d’histoire contemporaine de Munich, écrit : Ni à Dachau, ni à Bergen-Belsen, ni à Buchenwald, des juifs ou d’autres détenus n’ont été gazés (Die Zeit, 19 août 1960, p. 16). Or, au procès de Nuremberg, un film a montré la prétendue chambre à gaz de Dachau et nombreux sont les témoignages de prétendus gazages homicides dans les trois camps susmentionnés. À Dachau, une pancarte indique en cinq langues que « la chambre à gaz » n’a jamais servi.

Il est impossible de savoir sur quels critères on a décidé à cette époque de réviser ainsi l’histoire de ces camps et de ne pas réviser, sur ce point précis des chambres à gaz, l’histoire des autres camps.
Remarque : de quel droit interdire la contestation d’une histoire aussi fluctuante et arbitraire ?
3) En 1968 Olga Wormser-Migot, dans sa thèse sur Le Système concentrationnaire nazi, 1933-1945 (Presses universitaires de France, Paris 1968), consacre tout un développement à ce qu’elle appelle « Le problème des chambres à gaz » (p. 541-544). Elle exprime son scepticisme sur la valeur de célèbres témoignages attestant de l’existence de chambres à gaz dans des camps comme ceux de Mauthausen ou de Ravensbrück. Sur Auschwitz-I, elle est formelle : ce camp où, aujourd’hui encore, les touristes visitent une chambre à gaz était « sans chambre à gaz » (p. 157).
Remarque : vu que les témoignages sur d’autres camps ne diffèrent pas des témoignages sur ces trois camps, de quel droit interdire, depuis 1990, une contestation qui était encore permise en 1968 ?
4) En 1979 trente-quatre historiens français signent une longue déclaration commune en réponse aux arguments techniques de Robert Faurisson démontrant que l’existence et le fonctionnement des chambres à gaz nazies se heurtent à des impossibilités matérielles radicales (impossibilité, notamment, de pénétrer « en fumant et en mangeant » dans un local saturé d’acide cyanhydrique pour y toucher, manipuler et en extraire à grand ahan des milliers de cadavres imprégnés d’acide cyanhydrique). Rédigée par Léon Poliakov et Pierre Vidal-Naquet, cette déclaration conclut : « Il ne faut pas se demander comment, techniquement, un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible techniquement puisqu’il a eu lieu » (Le Monde, 21 février 1979, p. 23).
Remarque : si trente-quatre historiens se trouvent incapables d’expliquer comment un crime de cette dimension a été perpétré, pourquoi n’aurait-on pas le droit de contester la réalité même de ce crime ?
5) En 1982 Raul Hilberg, revenant complètement sur sa thèse de 1961, affirme que le processus de « destruction des juifs d’Europe » s’est finalement déroulé sans plan, sans organisation, sans centralisation, sans projet, sans budget, mais grâce à « une incroyable rencontre des esprits, une transmission de pensée consensuelle au sein d’une vaste bureaucratie », la bureaucratie allemande (an incredible meeting of minds, a consensus mind reading by a far-flung bureaucracy) (Newsday, Long Island, New York, 23 février 1983, p. II/3). Cette explication, R. Hilberg la confirmera sous serment au procès Zündel de 1985 à Toronto, le 16 janvier 1985 (transcription verbatim, p. 848) ; puis, il la confirmera de nouveau mais avec d’autres mots dans la version profondément révisée de son ouvrage The Destruction of the European Jews, Holmes & Meier, New York 1985, p. 53, 55, 62 ; en français, La Destruction des juifs d’Europe, Fayard, Paris 1988, p. 51, 53, 60).
Remarques : de quel droit interdire la contestation de ce que l’historien Number One du génocide des juifs juge lui-même « incroyable » ? Faut-il croire à l’incroyable ? Faut-il croire à la transmission de pensée, en particulier au sein d’un vaste appareil bureaucratique et, plus particulièrement encore, au sein de la bureaucratie du IIIe Reich ? En quoi le processus décrit par ce prestigieux historien diffère-t-il de l’opération du Saint-Esprit ?
6) Toujours en 1982 une association est fondée à Paris pour l’étude des assassinats par gaz sous le régime national-socialiste (ASSAG) « en vue de rechercher et contrôler les éléments apportant la preuve de l’utilisation des gaz toxiques par les responsables du régime national-socialiste en Europe pour tuer les personnes de différentes nationalités, contribuer à la publication de ces éléments de preuve, prendre à cet effet tous les contacts utiles au plan national et international ». L’article 2 des statuts dispose : « La durée de l’Association est limitée à la réalisation de son objet énoncé à l’article 1. » Or cette association fondée, le 21 avril 1982, par quatorze personnes, dont Germaine Tillion, Georges Wellers, Geneviève Anthonioz née de Gaulle, Me Bernard Jouanneau et Pierre Vidal-Naquet, n’a, en près d’un quart de siècle, jamais rien publié et, à ce jour de 2005, elle existe encore. Pour le cas où l’on soutiendrait à tort qu’elle a produit un livre intitulé Chambres à gaz, secret d’État, il conviendrait de rappeler qu’il s’agit là en fait de la traduction en français d’un ouvrage publié en allemand par Eugen Kogon, Hermann Langbein et Adalbert Rückerl et où figurent quelques contributions de quelques membres de l’ASSAG (Éditions de Minuit, Paris 1984). À lui seul, le titre de l’ouvrage donne une idée du contenu : au lieu de preuves, appuyées de photographies de chambres à gaz, de dessins, de croquis, de rapports d’expertises sur l’arme du crime, le lecteur ne trouve que des spéculations à partir de ce qui est appelé « éléments de preuves » (et non «preuves»), et cela parce que, nous dit-on, ces chambres à gaz auraient constitué le plus grand secret possible, un « secret d’État ».
Remarque : de quel droit interdire la contestation des « éléments de preuves » (pas même des preuves) qu’apporterait une association qui, du seul fait de son existence encore aujourd’hui en 2005, n’a toujours pas réalisé, et pour cause, l’objet pour lequel elle a été fondée, il y a près d’un quart de siècle ?
7) Le 26 avril 1983 prend fin en appel le long procès intenté en 1979, notamment par des organisations juives, à Robert Faurisson pour dommage à autrui par falsification de l’histoire. Ce jour-là, la première chambre de la cour d’appel civile, section A (président Grégoire), prononce qu’on ne peut déceler dans les travaux du professeur sur les chambres à gaz aucune trace de légèreté, aucune trace de négligence, aucune trace d’ignorance délibérée, ni aucune trace de mensonge et que, par voie de conséquence, « la valeur des conclusions défendues par M. Faurisson [sur les chambres à gaz] relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public.»
Remarque : comment des juges pourraient-ils, en conscience, châtier ceux qui aujourd’hui reprennent à leur compte la contestation du professeur sur « le problème des chambres à gaz » (expression utilisée par la cour)?
8) Toujours en 1983 Simone Veil déclare au sujet des chambres à gaz : « Au cours d’un procès intenté à Faurisson pour avoir nié l’existence des chambres à gaz, ceux qui intentent le procès sont contraints d’apporter la preuve formelle de la réalité des chambres à gaz. Or chacun sait que les nazis ont détruit ces chambres à gaz et supprimé systématiquement tous les témoins » (France-Soir Magazine, 7 mai 1983, p. 47).
Remarques : s’il n’y a ni arme du crime, ni témoignages, n’a-t-on pas le droit de contester la réalité de ce crime ? Que dire des locaux présentés à des millions de visiteurs abusés comme étant des chambres à gaz ? Que penser des personnages qui se présentent en témoins ou en miraculés des chambres à gaz ?
9) En 1986 Michel de Boüard, ancien résistant déporté, professeur d’histoire, doyen de la faculté des lettres de l’université de Caen, membre de l’Institut de France, responsable, au sein du Comité d’histoire de la deuxième guerre mondiale, de la commission d’histoire de la déportation, déclare qu’en fin de compte « le dossier est pourri ». Il précise que le dossier de l’histoire du système concentrationnaire allemand est « pourri » par, selon ses propres mots, « énormément d’affabulations, d’inexactitudes obstinément répétées, notamment sur le plan numérique, d’amalgames, de généralisations ». Faisant allusion aux études des révisionnistes, il ajoute qu’il y a « d’autre part, des études critiques très serrées pour démontrer l’inanité de ces exagérations » (Ouest-France, 2-3 août 1986, p. 6).
Remarque : si un dossier est « pourri », n’a-t-on pas le droit et même le devoir de le contester ?
10) En 1988 Arno Mayer écrit à propos des chambres à gaz nazies : « Les sources pour l’étude des chambres à gaz sont à la fois rares et douteuses » (Sources for the study of the gas chambers are at once rare and unreliable) (The “Final Solution” in History, Pantheon Books, New York 1988, p. 362 ; en français, La « solution finale » dans l’histoire, préface de Pierre Vidal-Naquet, La Découverte, Paris 1990, p. 406).
Remarques : de quel droit interdire la contestation de sources historiques d’une telle rareté ? L’historien doit-il se fier à ce qui est douteux ?
11) En 1989 Philippe Burrin, posant en principe et sans le démontrer que chambres à gaz et génocide ont existé, tente de déterminer à quelle date et par qui la décision a été prise d’exterminer physiquement les juifs d’Europe. Il n’y parvient pas plus que tous ses confrères « intentionnalistes » ou « fonctionnalistes » (Hitler et les juifs / Genèse d’un génocide, Seuil, Paris 1989). Il constate l’absence de traces et ce qu’il appelle « l’effacement obstiné de la trace d’un passage d’homme » (p. 9). Il déplore « les grandes lacunes de la documentation. Il ne subsiste aucun document portant un ordre d’extermination signé de Hitler. […] Selon toute vraisemblance, les ordres furent donnés verbalement. […] les traces sont ici non seulement peu nombreuses et éparses, mais difficiles d’interprétation» (p. 13).
Remarque : si l’historien ne peut produire aucun document en ce sens, signé de Hitler ou d’un autre, mais seulement ce qu’il appelle des « traces », au demeurant peu nombreuses, éparses et difficiles d’interprétation, de quel droit interdire la contestation de la thèse générale que cet historien persiste à défendre ?
12) En 1992 Yehuda Bauer, professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem, déclare lors d’une conférence internationale qui s’est tenue à Londres sur le génocide des juifs : « Le public répète encore, jour après jour, la sotte histoire (the silly story) qui veut que ce soit à Wannsee que l’extermination des juifs ait été décidée » (communiqué de la Jewish Telegraphic Agency reproduit dans le Canadian Jewish News, 30 janvier 1992).
Remarque : outre le fait qu’une lecture attentive du « procès-verbal » de la réunion de Berlin-Wannsee du 20 janvier 1942 prouve que les Allemands envisageaient une « solution finale territoriale [eine territoriale Endlösung] de la question juive », débouchant sur un « renouveau juif » dans un territoire à déterminer, la déclaration bien tardive de Yehuda Bauer ne confirme-t-elle pas qu’il fallait contester ce point majeur de la version officielle du génocide juif ? L’extermination des juifs n’a été décidée ni à Wannsee ni ailleurs ; l’expression de « camps d’extermination » n’est qu’une invention de la propagande de guerre américaine et des exemples prouvent que, pendant la guerre, l’assassinat d’un seul juif ou d’une seule juive exposait son auteur, qu’il fût civil ou militaire, membre ou non de la SS, à passer en conseil de guerre de l’armée allemande et à être fusillé (en soixante ans, jamais un seul historien orthodoxe n’a fourni une explication à ce genre de faits).
13) En 1995 l’historien Éric Conan, co-auteur avec Henry Rousso de Vichy, un passé qui ne passe pas, (Gallimard, Paris 2001 [1994, 1996]) écrit que Faurisson avait finalement eu raison de certifier, à la fin des années 1970, que la chambre à gaz visitée à Auschwitz par des millions de touristes était entièrement fausse. Selon É. Conan : « Tout y est faux […]. À la fin des années 70, Robert Faurisson exploita d’autant mieux ces falsifications que les responsables du musée rechignaient alors à les reconnaître. » E. Conan poursuit : « [Des personnes], comme Théo Klein, [préfèrent qu’on laisse la chambre à gaz] en l’état mais en expliquant au public le travestissement : “l’Histoire est ce qu’elle est ; il suffit de la dire, même lorsqu’elle n’est pas simple, plutôt que de rajouter l’artifice à l’artifice” ». É. Conan rapporte ensuite un propos stupéfiant de la sous-directrice du Musée national d’Auschwitz, qui, elle, ne se résout pas à expliquer au public le travestissement. Il écrit : «Krystyna Oleksy […] ne s’y résout pas : “Pour l’instant, on la laisse en l’état [cette pièce] et on ne précise rien au visiteur. C’est trop compliqué. On verra plus tard” » (Auschwitz : la mémoire du mal, L’Express, 19-25 janvier 1995, p. 68).
Remarque : ce propos d’une responsable polonaise ne signifie-t-il pas : on a menti, on ment et, jusqu’à nouvel ordre, on continuera de mentir ? Dans toute enquête au sujet des chambres à gaz, ne convient-il pas de mettre en doute leur existence, de se méfier et donc de contester ce qui nous est montré ou dit à leur sujet par des autorités réputées dignes de confiance ? Il est à noter qu’en 2001 le caractère fallacieux de cette chambre à gaz Potemkine sera enfin reconnu dans un livret accompagnant deux CD-Rom et intitulé : Le Négationnisme. Rédigé par Jean-Marc Turine et Valérie Igounet, ce livret est préfacé par Simone Veil (Radio-France – INA, Vincennes, Frémeaux et Associés, 2001).
14) En 1996 Jacques Baynac, historien de gauche et résolument antirévisionniste dès 1978, admet, toute réflexion faite, qu’il n’y a pas de preuves de l’existence des chambres à gaz nazies. On ne peut, écrit-il, que constater « l’absence de documents, de traces ou d’autres preuves matérielles» (Le Nouveau Quotidien, Lausanne, 2 septembre 1996, p. 16, et 3 septembre 1996, p. 14).
Remarque : En somme, J. Baynac dit : « Il n’y a pas de preuves mais je crois », tandis qu’un révisionniste pense : « Il n’y a pas de preuves, donc je refuse de croire et je conteste ». Va-t-on punir quelqu’un parce qu’il n’a pas la foi ?
15) En 2000, à la fin de son Histoire du négationnisme en France (Gallimard, Paris), Valérie Igounet publie un long texte de Jean-Claude Pressac où ce dernier, reprenant le mot du professeur Michel de Boüard, déclare que le dossier du système concentrationnaire est « pourri », et ce de façon irrémédiable. Il écrit : « Peut-on redresser la barre ? » et il répond : « Il est trop tard ». Il ajoute : « La forme actuelle, pourtant triomphante, de la présentation de l’univers des camps est condamnée ». Il termine en estimant que tout ce qu’on a ainsi inventé autour de trop réelles souffrances est promis « aux poubelles de l’histoire » (p. 651-652). En 1993-1994 ce protégé de Serge Klarsfeld et de Michael Berenbaum avait été célébré dans le monde entier comme un extraordinaire chercheur qui, dans son livre sur Les Crématoires d’Auschwitz, la machinerie du meurtre de masse (CNRS éditions, Paris 1993), avait, paraît-il, terrassé l’hydre du révisionnisme. Ici, dans le livre de V. Igounet, on le voit signer sa capitulation.
Remarque : si un dossier est irrémédiablement pourri et voué aux poubelles de l’histoire, comment peut-on attendre des juges qu’ils en punissent la contestation ?
J’ai été maintes fois condamné en justice pour contestation de la thèse officielle. Je l’ai été avant et après la promulgation de la loi Fabius-Gayssot. Je ne saurais dire à combien de reprises je me suis ainsi retrouvé devant les juges de Paris. En revanche, le temps passant, plus je récidivais, plus les condamnations devenaient légères ; parfois même le juge d’instruction décidait d’un non-lieu ou bien le tribunal ou la cour, d’une relaxe. À telle enseigne que, lorsque, en 1999, j’ai publié en quatre volumes un ouvrage de plus de 2000 pages intitulé Écrits révisionnistes (1974-1998), j’ai été poursuivi – sans succès – pour n’avoir pas déposé d’exemplaire au Dépôt légal du ministère de l’Intérieur mais le contenu même de l’ouvrage ne m’a valu aucune poursuite. Dans les années suivantes, je n’ai été poursuivi pour aucune de mes publications révisionnistes. Toutefois, curieusement, la chasse vient de rouvrir sur plainte du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui m’a dénoncé pour avoir accordé au téléphone une interview révisionniste à une télévision iranienne.
G. Wellers et P. Vidal-Naquet ont été indignés par l’arrêt du 26 avril 1983. Le premier a écrit : « La cour a reconnu que [Faurisson] s’était bien documenté. Ce qui est faux. C’est étonnant que la cour ait marché » (Le Droit de vivre, juin-juillet 1987, p. 13). Le second a écrit que la cour de Paris « a reconnu le sérieux du travail de Faurisson, ce qui est un comble, et ne l’a, en somme, condamné que pour avoir agi avec malveillance en résumant ses thèses en slogans » (Les Assassins de la mémoire, La Découverte, Paris 1987, p. 182). En 1986, réunis autour du grand rabbin Sirat, ils ont préconisé l’instauration d’une loi spécifiquement antirévisionniste (Bulletin quotidien de l’Agence télégraphique juive, 2 juin 1986, p. 1, 3). Le socialiste Laurent Fabius et le communiste Jean-Claude Gayssot combleront leurs vœux avec la création d’une loi conçue pour bâillonner les révisionnistes et ligoter les juges.
Mais le droit à la recherche historique n’a que faire de liens et de bâillons.
1er octobre 2005
Additif, en date du 3 juillet 2006, pour mon procès du 11 juillet à la XVIIe chambre du tribunal correctionnel de Paris.
Je suis prévenu d’avoir enfreint la loi Fabius-Gayssot lors d’un entretien téléphonique accordé, le 3 février 2005, à la station iranienne de radio-télévision Sahar. Cette station étant, paraît-il, satellitaire, mes propos ont été entendus en France. Le Conseil supérieur de l’audio-visuel (CSA), présidé par M. Dominique Baudis, a capté un fragment de ces propos et en a saisi la justice française.
Je possède la nationalité britannique (je suis né près de Londres d’une mère écossaise) et je possède également la nationalité française (mon père était français). À partir de la fin des années 1990, j’ai accordé de nombreux entretiens à des journalistes ou à des universitaires iraniens, soit en France, soit en Grande-Bretagne, soit en Iran. Ces entretiens se sont déroulés soit en anglais, soit en français, lors de rencontres en tête-à-tête ou par téléphone ou par la voie électronique. Je suis loin d’avoir tenu la comptabilité de ces divers entretiens. En conséquence, je ne saurais dire si l’entretien qu’on me reproche a vraiment eu lieu à la date du 3 février 2005 ou auparavant et j’ignore si je l’ai accordé de France ou de Grande-Bretagne – le fait qu’il soit en langue française ne signifiant rien en l’espèce.
Supposons d’abord que je me sois exprimé de France. Il faudrait alors comprendre qu’un citoyen français ne peut plus parler librement, de son domicile, au téléphone, à un journaliste étranger. Si ce journaliste se trouve être citoyen d’un pays où l’on a le droit de contester « l’Holocauste » des juifs, de quel droit la France le censure-t-elle ? Par ailleurs, je ne pouvais savoir 1) que mon interlocuteur appartenait à une chaîne de télévision satellitaire et que mes propos seraient entendus en France ; 2) que nous sommes revenus en France à une pratique du temps de guerre où l’on censure par tout moyen adéquat la radio « ennemie » ; 3) que mes propos, destinés, dans mon esprit, à être traduits en persan (d’où le soin que j’ai pris d’épeler certains noms), allaient être diffusés en français.
Supposons ensuite que je me sois exprimé de Grande-Bretagne. En ce cas, la France se mêlerait tout simplement de ce qui ne la regarde pas.
Mais venons-en à la substance même de mes propos.
Notons d’abord que nous ne possédons pas ici l’intégralité de ma déclaration. Le texte de mes propos, tel que l’a produit le brigadier-chef Emmanuel Bert, commence de façon saugrenue par les mots suivants : « pondre à vos deux questions » et il se termine sur une phrase incompréhensible et inachevée. Or, pour juger de cet entretien, il est indispensable de savoir, par exemple, si je ne l’ai pas fait précéder de la mise en garde dont je suis coutumier et qui consiste à dire en substance : « Attention ! Sur le sujet des chambres à gaz nazies et du génocide des juifs, ce que je vais vous dire ne reflète pas nécessairement ce que je pense aujourd’hui. Simplement, je vais vous rappeler, en usant du présent historique, l’histoire de ce qu’ont été jusqu’ici les découvertes et les aléas de l’enquête révisionniste. »
Ma propre enquête s’est assez vite portée, dès 1975, sur le camp d’Auschwitz, c’est-à-dire sur le point central de l’accusation lancée contre l’Allemagne. J’ai voulu aller voir sur place le local présenté à des millions de visiteurs comme ayant été, paraît-il, une arme de destruction massive appelée « chambre à gaz ». J’ai découvert et j’ai prouvé à la face du monde qu’il s’agissait en fait d’une abominable supercherie. Dans mon entretien, tel qu’il a été reproduit par le brigadier-chef susnommé, la place que j’accorde à cette chambre à gaz emblématique est si large qu’elle en devient essentielle. Je crois donc nécessaire de porter à l’attention du tribunal l’intégralité ce qu’en a dit Éric Conan, en 1995, dans L’Express (voy., ci-dessus, le point 13). Les soulignages sont de mon fait.
Intégralité de ce qu’Éric Conan a dit, en 1995, de la « chambre à gaz » d’Auschwitz I
Autre sujet délicat : que faire des falsifications léguées par la gestion communiste ? Dans les années 50 et 60, plusieurs bâtiments, qui avaient disparu ou changé d’affectation, furent reconstruits avec de grosses erreurs, et présentés comme authentiques. Certains, trop « neufs », ont été fermés au public. Sans parler de chambres à gaz d’épouillage, présentées parfois comme des chambres à gaz homicides. Ces aberrations ont beaucoup servi aux négationnistes, qui en ont tiré l’essentiel de leurs affabulations. L’exemple du crématoire I, le seul d’Auschwitz I, est significatif. Dans sa morgue fut installée la première chambre à gaz. Elle fonctionna peu de temps, au début de 1942 : l’isolement de la zone, qu’impliquaient les gazages, perturbait l’activité du camp. Il fut donc décidé, à la fin d’avril 1942, de transférer ces gazages mortels à Birkenau où ils furent pratiqués, sur des victimes essentiellement juives, à une échelle industrielle. Le crématoire I fut, par la suite, transformé en abri antiaérien, avec salle d’opération. En 1948, lors de la création du musée, le crématoire I fut reconstitué dans un état d’origine supposé. Tout y est faux : les dimensions de la chambre à gaz, l’emplacement des portes, les ouvertures pour le versement du Zyklon B, les fours, rebâtis selon les souvenirs de quelques survivants, la hauteur de la cheminée. À la fin des années 70, Robert Faurisson exploita d’autant mieux ces falsifications que les responsables du musée rechignaient alors à les reconnaître. Un négationniste américain [David Cole, juif] vient de tourner un film vidéo dans la chambre à gaz (toujours présentée comme authentique) : on l’y voit interpeller les visiteurs avec ses « révélations ». Jean-Claude Pressac, l’un des premiers à établir exactement l’histoire de cette chambre à gaz et de ses modifications pendant et après la guerre, propose de la restaurer dans son état de 1942, en se fondant sur des plans allemands qu’il vient de retrouver dans les archives soviétiques. D’autres, comme Théo Klein, préfèrent la laisser en l’état, mais en expliquant au public le travestissement : « l’Histoire est ce qu’elle est ; il suffit de la dire, même lorsqu’elle n’est pas simple, plutôt que de rajouter l’artifice à l’artifice. » Krystyna Oleksy, dont le bureau directorial, qui occupe l’ancien hôpital des SS, donne directement sur le crématoire I, ne s’y résout pas : « Pour l’instant on la laisse en l’état et on ne précise rien au visiteur. C’est trop compliqué. On verra plus tard. » (Éric Conan, Auschwitz : la mémoire du mal, L’Express, 19-25 janvier 1995, pages 54-69 ; p. 68).
Dans sa longue étude É. Conan a voulu montrer combien il y a loin de «la mémoire» à l’histoire. Il l’a fait sans remettre en cause le dogme de « l’Holocauste » ; il est même allé jusqu’à dire sa croyance en l’existence de l’arme de destruction massive appelée « chambre à gaz » et il a posé comme exactes et démontrées des assertions qui n’ont pas le moindre fondement scientifique. Néanmoins il a eu le courage de dénoncer de graves mensonges dont celui de la « chambre à gaz » emblématique qu’on présente aujourd’hui aux visiteurs d’Auschwitz. Et il ose admettre que, dès la fin des années 1970, j’ai eu raison sur le sujet. En 2005 je lui ai demandé si son étude avait suscité des rectifications ou des protestations, en particulier de la part des autorités du Musée national d’Auschwitz et de Krystyna Oleksy. Sa réponse a été: « Aucune. »
Sur le même sujet, en 2001, intégralité d’un livret de CD-Rom
préfacé par Simone Veil
En 2001, dans un livret de CD consacré au « négationnisme » et préfacé par Simone Veil, on peut lire sur le même sujet :
La motivation [Robert Faurisson] l’a : l’amour exclusif de la vérité, telle serait l’une de ses obsessions. Universitaire, Robert Faurisson ne cessera d’utiliser cette caution scientifique, gage soi-disant de respectabilité. Il lit Maurice Bardèche. Il découvre Paul Rassinier. Il « décortique » Rimbaud, Lautréamont et Apollinaire. Homme brillant et cultivé, il n’en est pas moins un provocateur. Pendant les années soixante-dix, Robert Faurisson travaille. Il ébauche sa méthode historico-littéraire. Il se rend aux archives d’Auschwitz. Sa négation va s’y construire. Elle repose sur un fait réel : la chambre à gaz du camp d’Auschwitz I est une « reconstitution », puisqu’elle a servi d’entrepôt pour les médicaments des S.S. et d’abri antiaérien après la mise en service des chambres à gaz d’Auschwitz II-Birkenau ; ce qu’il a pu voir (et ce que l’on peut encore voir) est une chambre à gaz supposée. C’est indéniable. Il n’empêche que pour Robert Faurisson, il s’agit d’une supercherie dont les Juifs sont les auteurs (Le Négationnisme (1948-2000), Entretiens diffusés sur France Culture sous la direction de Jean-Marc Turine. Livret par Valérie Igounet et Jean-Marc Turine préfacé par Simone Veil, Frémeaux et associés, Vincennes 2001, 48 pages ; p. 27-28).
Conclusion sur le droit à la recherche et sur le droit à l’exactitude
Je n’ai pas l’outrecuidance de prétendre que j’aspire à la vérité ; j’aspire seulement à cette forme de vérité vérifiable qui s’appelle l’exactitude.
Je n’invoque pas le droit, passablement illusoire et vague, qu’on appelle le droit à la liberté d’expression ; j’invoque simplement le droit à la liberté de recherche.
Nul ne devrait me contester ces deux droits, qui sont bien modestes, à la recherche et à l’exactitude.
Il ne saurait, en tout cas, exister aucune bonne raison d’interdire la recherche historique et l’exactitude.
La loi Fabius-Gayssot constitue donc une voie de fait. D’où la répugnance manifeste de tant de magistrats à l’appliquer dans son étendue.
DONT ACTE
11 juillet 2006
Éric Delcroix, Avocat Robert Faurisson