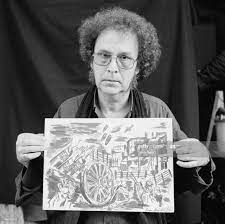L’imposture Wilkomirski restera impunie
Appelé à connaître un succès mondial et à recueillir un flot d’hommages avant de sombrer quelques années plus tard dans le discrédit général, un petit livre portant le titre de Bruchstücke aus einer Kindheit 1939-1948 paraissait à la fin de l’année 1995, sous le nom de Binjamin Wilkomirski, au Jüdischer Verlag de Francfort, maison d’édition dépendant du prestigieux éditeur Suhrkampf. Par la suite, l’ouvrage allait être traduit en une douzaine de langues. La traduction française, due à Léa Marcou, paraissait en janvier 1997 aux éditions Calmann-Lévy sous le titre de Fragments / Une enfance 1939-1948.
En quatrième de couverture on pouvait lire :
Binjamin Wilkomirski ne connaît pas sa date de naissance, ignore ses origines précises et n’a plus aucun parent. – Il est tout jeune encore lorsque les rafles de Juifs s’intensifient en Pologne. Son père est assassiné sous ses yeux, on l’arrache à sa famille et il est déporté, à quatre ans, au camp d’extermination de Majdanek. « Mes premiers souvenirs ressemblent à un champ de ruines parsemé d’images et d’événements isolés. Des tessons de mémoire aux contours durs, aiguisés, qu’aujourd’hui encore je ne peux toucher sans m’y blesser. Souvent dans un désordre chaotique et, pour la plupart, impossibles à classer par ordre chronologique. Des fragments qui résistent obstinément au souci d’ordre de l’adulte que je suis devenu et échappent aux lois de la logique. » Ce sont ces fragments que restitue ici l’auteur à travers le regard de l’enfant qu’il fut. – Un livre inoubliable, chef-d’œuvre d’écriture et d’émotion. – Binjamin Wilkomirski vit aujourd’hui en Suisse. Il est fabricant d’instruments de musique et clarinettiste.
Un produit de basse fabrication
En réalité, cet opuscule de 150 petites pages est un chef-d’œuvre de non-écriture et d’absence d’émotion. Il s’agit d’un produit de basse fabrication dont l’auteur nous joue tout au plus du pipeau. Loin d’y découvrir des « tessons de mémoire aux contours durs, aiguisés », le lecteur n’y rencontre que du mou, de l’inconsistant, de l’indéfini (dans le temps et dans l’espace), du confus, du flou, du fumeux, de la vapeur, du brouillard, du gris. L’action stagne. Les dialogues sonnent creux. Le ton est faux : les cris que pousse constamment le héros ainsi que ses paniques et ses colères surviennent la plupart du temps sans rime ni raison.
Si tout est dans le vague, c’est à dessein. Manifestement l’auteur a évité de fournir des précisions sur les lieux, sur les temps ou sur les personnages parce qu’il craignait de se couper. Il prétend avoir été interné à Majdanek mais il se garde de décrire le camp, sinon en le dotant d’une colline qui, dans la réalité, n’a jamais existé. Il donne ensuite à entendre qu’il s’est trouvé à Auschwitz mais il n’écrit pas le nom d’Auschwitz si bien qu’on ne pourra lui reprocher d’avoir commis telle erreur au sujet de ce camp. À de rares exceptions près, les personnages n’ont pas vraiment d’uniformes, de grades, de langues, d’emplois précis ni même, et c’est un comble, de traits véritablement distinctifs ; ils ne sont que fantômes ou croquemitaines de carton-pâte. Les paysages parcourus sont de partout et de nulle part. Cette attention à gommer tout détail compromettant est caractéristique du menteur ou du faussaire. Elle exclut la bonne foi. Prétendre que l’auteur a fini par croire à son propre récit serait une erreur. Notre escroc est constamment sur le qui-vive. Il se surveille comme le font les menteurs. Il ne divague pas, ni ne cède à l’illusion. Il fabrique, il forge son récit pièce à pièce et phrase à phrase, laborieusement.
À titre d’exemples, écoutons-le évoquer « l’Uniforme » (pour parler d’un gardien), «la Grande Baraque», « les femmes-uniformes gris de Pologne », « le Nouveau », «la silhouette» (il nourrit une affection particulière pour ce mot), « des formes grises », «une Blockowa», « une auxiliaire SS en gris », « un uniforme noir », « les contours noirs des uniformes », « un brun-vert ». Et puis voici encore « une Uniforme » (en parlant d’une gardienne, p. 68), « le botté » (p. 73), « des êtres gris, en loques, des adultes sans forme définie » (p. 82). À un moment donné, l’auteur dit avoir fait partie d’un transport mais, sur le moyen de locomotion, il écrit : « Je ne sais même pas s’il s’agissait d’un camion ou d’un wagon de chemin de fer » (p. 86) ; ce faisant, il se prémunit contre tout risque de placer une ligne de chemin de fer là où en réalité il n’en a peut-être jamais existé pendant la guerre. À la même page, il ajoute : «Seule la fin du voyage m’est restée en mémoire, et même cela de façon lacunaire, confuse, par fragments d’images difficiles à ordonner : trop de pièces manquent au puzzle ». Remarquons, en passant, qu’il est piquant d’entendre le faussaire à l’œuvre nous parler ici de « pièces » d’un « puzzle ». Il veut bien nous confier : « Tout était confus, flou » (p. 95), ce qui est le moins qu’on puisse dire. Il aperçoit « des femmes qui émergeaient parfois de la semi-obscurité telles des ombres » (p. 103). Ailleurs il écrit: « Était-ce une fille ou un garçon ? » et, pour une fois, il s’apprête à nous donner un nom mais il n’en fera rien ; nous n’aurons droit qu’à un prénom, et encore: «On l’appelait Kobo, Kola ou Kala, je ne sais plus très bien» (p. 103). Pour l’auteur, « Ici tout se noie dans une nébuleuse pénombre » (p. 111) tandis que là il n’y avait plus que « des images embrumées » (p. 109) ; en réalité, ce n’est pas seulement «ici» ou « là » mais partout dans le récit qu’on ne rencontre que du nébuleux, de la pénombre ou de la brume.
Toujours à titre d’exemple, prélevons un alinéa parmi cent autres, qui nous offrira un spécimen de cette littérature à l’huile de coude :
La ville, les gens, les autres enfants me terrifiaient. Des questions de plus en plus torturantes s’enchevêtraient dans ma cervelle, la rongeaient comme de l’acide. Parfois, elles me submergeaient l’esprit comme d’une coulée de plomb fondu. J’étais incapable de les exprimer, elles me collaient la gorge et la bouche, tandis que mon cœur battait la chamade puis menaçait de s’arrêter. Mais pas un mot ne sortait de ma bouche, ce qui me privait de tout espoir de réponse (p. 112).
Cent cinquante pages d’un tel verbiage traduit de l’allemand auraient dû donner l’éveil aux plus crédules. Tout le monde aurait dû se rendre compte que B. Wilkomirski appartient à la catégorie des faux témoins qui, n’ayant rien à rapporter d’une expérience vécue, en sont réduits à constituer un puzzle avec des clichés de bazar, des stéréotypes, du kitsch et du sentiment préfabriqué.
Grand-guignolesque
Tout aussi factice est le récit des atrocités dont l’auteur pimente son récit prétendument autobiographique. Dans son livre, les méchants passent le plus clair de leur temps à se saisir sournoisement d’enfants pour les projeter à travers une fenêtre contre un mur, à leur fracasser le crâne, à leur percer le front d’une boule, à les enterrer vivants dans la boue, à les jeter dans le feu, à en faire du «combustible» (sic) ou, plus simplement, à les soulever du sol par les oreilles, à les enfermer dans des niches pleines de vermine, à les faire marcher dans les excréments jusqu’aux genoux, à enfoncer des bâtonnets de verre «dans les quéquettes des jeunes garçons» (p. 60). Dans un amas de cadavres l’on voit gonfler puis s’ouvrir le ventre d’une femme ; notre homme en atteste :
L’abdomen se déchire et un énorme rat, tout brillant, barbouillé de sang, dévale le monceau de cadavres. D’autres rats effrayés surgissent de l’enchevêtrement de corps et prennent le large. – Je l’ai vu, je l’ai vu ! Les femmes mortes accouchent de rats ! – Les rats ! L’ennemi mortel des petits enfants du camp. Les rats nous attaquent nuit après nuit, dont les morsures nous infligent des blessures affreusement douloureuses, inguérissables, des blessures que rien ne peut cicatriser et qui font pourrir vifs les enfants ! (p. 84).
Après la guerre, devenu, dans l’opulente Helvétie, le pensionnaire d’un home d’enfants, il a, paraît-il, conservé toutes ses peurs. Pour nous en convaincre, il nous cite trois exemples de hantises qui l’empêchent, paraît-il, de percevoir la simple et inoffensive réalité. Il évoque successivement d’abord une image de Guillaume Tell, puis le spectacle d’enfants s’exerçant au tir dans un stand de foire et, enfin, la vue d’une paire de jeunes skieurs qu’emporte la perche d’une remontée mécanique. Or ne voilà-t-il pas qu’en Guillaume Tell il croit voir un SS qui met un enfant en joue pour le tuer afin de lui dérober et de lui manger sa pomme (p. 128) ? Au stand de tir, il s’imagine que des enfants-soldats cherchent à tuer la tenancière du stand, cible qu’heureusement ils manquent (p. 133). Quant au remonte-pente, rien qu’à son bruit, il ne peut être que « la machine de mort » tandis que le directeur du home d’enfants est à coup sûr « le bourreau » qui, assisté d’un aide, fixe des enfants deux par deux à un câble afin que ceux-ci soient emportés et disparaissent, par-delà le sommet de la montagne, dans « un gigantesque trou noir » (p. 138-139). À elles seules, ces laborieuses inepties auraient dû inciter tout éditeur à refuser le manuscrit. Mais, dans la littérature holocaustique, ces inventions constituent la loi du genre et c’est précisément à la vue de pareilles âneries qu’un éditeur, habitué aux récits de la mythologie concentrationnaire, se dira : « C’est bien cela. Nous y sommes. Ce témoignage est dans la norme. Il porte le signe de l’authenticité de l’Holocauste. » Tant il est vrai qu’accoutumé à une nourriture frelatée on n’en veut plus d’autre.
Un best-seller juif
En dépit de son atroce qualité littéraire et de ses inventions dignes du Grand-Guignol, le livre allait, en effet, rapidement devenir un best-seller.
À sa parution, le gotha de la Shoah tombe en pâmoison. Il suffoque d’admiration devant la force du témoignage et le talent de l’auteur. Lea Balint, spécialiste israélienne des enfants de la Shoah, Lawrence Langer, Daniel Jonah Goldhagen, Blake Eskin, s’en font les champions avec Wolfgang Benz, directeur, à Berlin, du Centre de recherche sur l’antisémitisme, et, en France, Annette Wieviorka. Du New York Times au Nouvel Observateur, du Daily Telegraph et du Guardian au Monde, les médias frémissent de bonheur. Aux États-Unis, le livre est promu par l’Holocaust Memorial Museum de Washington et il est couronné par le National Jewish Book Award for Autobiography tandis que l’Association des bibliothèques américaines l’inscrit en 1997 sur la liste des « Best Books for Young Adults ». En Grande-Bretagne, il reçoit le prix littéraire du Jewish Quarterly et, en France, le prix Mémoire de la Shoah. Le témoignage oral de B. Wilkomirski est précieusement recueilli par la Shoah-Foundation de Steven Spielberg, fondation destinée à recueillir en vidéo 50 000 témoignages dans près de cinquante pays afin de prouver à l’univers que les révisionnistes sont des faussaires de l’histoire. B. Wilkomirski multiplie les déplacements et les conférences, en particulier dans les écoles. Il amasse une fortune. Premier miracle : il retrouve son père en Israël ; il s’agit d’un survivant de Majdanek portant le nom de Jaacov Morroco ; sous l’œil des caméras le père et le fils se tombent en pleurant dans les bras l’un de l’autre. Second miracle : une Californienne disant s’appeler Laura Grabowski et se présentant en rescapée d’Auschwitz prétend l’avoir connu dans ce camp : les retrouvailles, là encore, se font, en présence des caméras, à l’aéroport de Los Angeles. Laura Grabowski l’accueille à bras ouverts et à grands cris : « He’s my Binji ! » (C’est mon Binji !). Pour sa part, elle exhibe des cicatrices dues aux expériences médicales de Mengele. Elle est musicienne. Notre clarinettiste et sa compagne partent en tournées de conférences et de concerts. Ils se rendent en pèlerinage à Auschwitz. Et là, sur place, toujours devant les caméras, notre héros révèle que Mengele lui avait infligé des expériences médicales pour changer en bleu le marron de ses yeux, épisode dont il n’avait pas soufflé mot dans son livre. Survient un incident qui aurait dû donner l’éveil : alors qu’on lui demande de décrire Mengele, B. Wilkomirski s’y refuse («L’enfant des camps de la mort : vérité ou mensonges ?», documentaire pour la télévision britannique de Christopher Oliglati, 1999).
L’imposture dévoilée
Très tôt, dès 1995, un journaliste suisse, Hanno Helbling, chef du service culturel de la Neue Zürcher Zeitung, avait mis en garde l’éditeur allemand Suhrkampf contre la supercherie. Mais H. Helbling, n’ayant pas la chance d’être juif, avait été éconduit comme un vulgaire révisionniste. Il faudra attendre qu’intervienne, dans l’hebdomadaire suisse Die Weltwoche (27 août et 3 septembre 1998), un juif du nom de Daniel Ganzfried, né en Israël et vivant en Suisse, pour que se mette en marche le processus qui aboutira à une série de révélations sur l’identité véritable de l’imposteur. Évidemment tout le crédit de la découverte ira au juif et non au «révisionniste» H. Helbling, dont le nom sera vite oublié.
On apprend alors que, de son vrai nom, Binjamin Wilkomirski s’appelait, en fait, Bruno Grosjean. Enfant naturel, né le 12 février 1941 à Bienne (canton de Berne), il est confié par sa mère, Yvonne Berthe Grosjean, à un orphelinat. Adopté par un couple de Zurichois aisés, les Doesseker, il prend le nom de Bruno Doesseker. Sa mère meurt en 1981 et il en reçoit le maigre héritage. Il n’a jamais été juif. Sa naissance à Riga est une pure invention. Il a passé toute son enfance en Suisse et non à Majdanek, à Auschwitz ou en tel autre point de Lettonie, de Pologne ou d’Allemagne. Il n’a jamais vécu dans un orphelinat de Cracovie. Une analyse génétique prouve qu’il est dépourvu de tout lien de parenté avec Jaacov Morroco. Il n’a connu Riga, Auschwitz ou Cracovie qu’en touriste et bien après la guerre.
Laura Grabowski, elle, est ce qu’on appelle un escroc en jupon. De son vrai nom elle s’appelle Laura Rose Wilson ; elle est née aux États-Unis de parents chrétiens à Auburn, dans l’état de Washington. Dix ans auparavant, sous le pseudonyme de Lauren Stratford, elle avait signé un livre où elle se présentait en victime de rituels sataniques et elle exhibait alors des cicatrices, les mêmes cicatrices que, plus tard, elle allait attribuer aux expériences de Mengele.
L’imposteur commence par se débattre contre les accusations. Il mêle protestations, menaces et gémissements. À défaut de son vrai père, on a retrouvé son vrai oncle, lequel accepte de se prêter à un test génétique mais l’imposteur, lui, s’y refuse. Des témoignages commencent à se faire jour de personnes qui l’ont bien connu ; il en ressort que, dès sa jeunesse, Bruno avait une forte propension au mensonge. On apprend qu’un psychothérapeute juif, Elitsur Bernstein, a participé à l’entreprise du faussaire ; spécialiste des souvenirs enfouis, il avait aidé le clarinettiste à «reconstituer» son identité de Binjamin Wilkomirski, prétendument né à Riga, puis placé dans un orphelinat de Cracovie et déporté dans des camps de concentration nazis. Des juifs commencent à prendre leurs distances d’avec ce goy qui a joué au juif et dont l’imposture, devenue trop voyante, risque de causer du tort à la communauté. Raul Hilberg et Yehuda Bauer expriment leur scepticisme. Des juives comme Judith Shulevitz, au Canada, ou Deborah Dwork et Deborah Lipstadt, aux États-Unis, persistent à défendre l’imposteur ou son œuvre ; selon elles il importe, somme toute, assez peu que le récit soit authentique ou non et il faut surtout prendre garde à ne pas jouer le jeu des révisionnistes. En 1999 Elena Lappin, juive d’origine russe, a consacré à l’affaire une étude, The Man with Two Heads, qui sera traduite et publiée en 2000 aux éditions de L’Olivier (PDG : Olivier Cohen) sous le titre de L’Homme qui avait deux têtes. Cette fois-ci, l’explication est simple : pour E. Lappin l’auteur est sincère car il possède une personnalité double. Jorge Semprun n’est pas loin d’exprimer le même avis (Journal du dimanche, 6 février 2000, p. 27) ; il en profite pour faire l’apologie de la fiction qui, dit-il, doit de plus en plus « prendre le relais » de l’histoire ; il déclare textuellement : « Cela s’est déjà passé au cinéma. Spielberg, Benigni ont dépassé la réalité par la fiction, et on voit bien que ça fonctionne. » Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer la contribution involontaire de l’auteur à l’essor du révisionnisme. Isabelle Rüf écrit : «Une telle imposture rend suspects les récits véridiques et conforte les négationnistes qui pullulent sur Internet. De plus, Wilkomirski donne du juif “post-Holocauste” l’image convenue et kitsch qui convient à la classe dont l’auteur est issu: geignard, larmoyant, brisé à jamais » (Le Temps [Genève], 21 février 2000, p. 19).
La justice helvétique décide d’épargner le « possible » mythomane
Les uns après les autres les éditeurs retirent, en tout ou en partie, le livre du circuit commercial. La justice zurichoise entre en scène. Plainte a été déposée pour fraude. En avril 2000 une perquisition au domicile de l’intéressé a lieu. Mais, le 12 décembre 2002, une dépêche d’agence l’annonce, la jugesse d’instruction a décidé le «classement de l’enquête sur l’auteur de faux mémoires sur Auschwitz». Voici le texte de l’Agence télégraphique suisse :
Zurich – Il ne s’agit pas d’un imposteur mais d’un mythomane : Bruno Doesseker, alias Benjamin Wilkomirski, auteur du livre Fragments, censé raconter les souvenirs d’un enfant juif survivant du camp d’Auschwitz, mais en réalité un faux, ne sera pas jugé pour escroquerie ni pour concurrence déloyale. La justice zurichoise vient de classer l’enquête qui avait été ouverte à ce sujet. Les recherches ont montré qu’aucun élément concret ne permettait de penser que l’auteur du livre ait voulu cacher sa véritable identité « de manière frauduleuse », écrit aujourd’hui le juge d’instruction Lucienne Fauquex qui, le 23 octobre dernier, avait décidé le non-lieu. Bien qu’il soit démontré que le livre contient des affirmations fausses, il n’existe pas de preuves que son auteur ait menti, a déclaré le juge d’enquête à l’ATS. Il est possible que Doesseker/Wilkomirski ait été réellement convaincu de sa version des faits, mais ce point ne relève pas de l’enquête, a ajouté Mme Fauqueux.
Cette décision de justice aurait dû soulever un flot de commentaires ; or elle paraît avoir été suivie d’un silence total. Aujourd’hui l’affaire Wilkomirski semble terminée au soulagement, n’en doutons pas, de beaucoup.
Quand « Vérité n’est pas défense »
En matière de mensonge holocaustique la justice helvétique, on le voit, ne raisonne pas autrement que la justice française, allemande, autrichienne, néerlandaise, canadienne ou australienne. Elle cautionne le mensonge commis de bonne foi ou même le mensonge possiblement commis de bonne foi. Au Canada, par exemple, les organisations juives, échaudées par les succès révisionnistes devant les tribunaux réguliers, ont obtenu la création de tribunaux spéciaux appelés « tribunaux de commissions des droits de l’homme ». Devant ces tribunaux dépourvus de jury, « Truth is no defence » (Vérité n’est pas défense). Le prévenu n’y a pas le droit de se défendre en faisant valoir que, s’il s’est permis telle affirmation qu’on lui reproche, c’est parce que, pour lui, cette affirmation est vraie. Si jamais il s’y risque, le même tribunal, qui vient pourtant de lui faire prêter serment de « dire la vérité, toute la vérité et seulement la vérité », lui opposera la nouvelle formule sacramentelle selon laquelle, pour lui, « Truth is no defence ». Ce tribunal-là ne s’intéresse, en effet, qu’au point de savoir si ce qu’a affirmé le prévenu cause ou non au plaignant un quelconque dommage, fût-il psychologique. Le juge se fait souvent alors peseur d’âme et d’intentions, ce qui ouvre la voie à l’arbitraire. On comprendra dès lors qu’un plaignant juif aura toujours beau jeu de faire valoir devant ces tribunaux que, par exemple, la contestation révisionniste de l’existence des chambres à gaz nazies lui enlève le sommeil et lui cause des dommages psychiques. En épargnant B. Wilkomirski la justice helvétique n’a donc fait que suivre le mouvement ; en matière d’« Holocauste » elle ne manque d’ailleurs jamais de protéger le mensonge.
Loin du roi des imposteurs, Élie Wiesel
La mythomanie est une tendance maladive à dire des mensonges, à fabuler, à simuler. Elle peut aider à duper, escroquer ou voler. Elle permet quelquefois d’atteindre à la gloire ou d’édifier une fortune. Grosjean-Doesseker-Wilkomirski a ainsi connu la fortune et la gloire, suivies, dans son cas, de la déchéance. Son statut de non-juif a fini par le desservir mais, d’un autre côté, il s’est tiré d’affaire à bon compte car il a bénéficié des privilèges qu’on ne manque pas d’accorder aux chantres de la mythologie juive. Au bénéfice du doute une jugesse d’instruction lui a permis de conserver l’argent qu’il s’était acquis malhonnêtement.
Sur le plan des inventions absurdes, de la niaiserie sentimentale et de la pauvreté de l’expression littéraire, Bruno Grosjean est allé aussi loin que l’auteur du Journal d’Anne Frank et, comme ce dernier, il a fini par être démasqué. Cependant Otto Heinrich Frank, lui, n’a eu qu’à peine le temps de connaître la honte et puis, il faut bien le dire, les juifs, après sa mort, survenue en 1980, ont mené un tel tapage et orchestré une telle campagne de désinformation que le grand public a été tenu dans l’ignorance du dévoilement de la supercherie. Le Journal d’Anne Frank poursuit donc imperturbablement sa brillante et fructueuse carrière.
Sur le plan du faux témoignage, Élie Wiesel, lui, poursuit également sa course, loin en tête des faux témoins d’Auschwitz, loin devant Martin Gray, Filip Müller, Rudolf Vrba, Mel Mermelstein, Abraham Bomba, Fania Fénelon et la foule considérable des autres mythomanes de « l’Holocauste ». Il n’est pas dit qu’un jour sa gloire et sa fortune de Prix Nobel de la Paix n’égaleront pas celles des Rothschild.
Pour l’instant, dans son domaine, É. Wiesel reste le roi des imposteurs et, à côté de lui, convenons-en, le goy Bruno Grosjean fait bien pâle figure.
22 décembre 2002