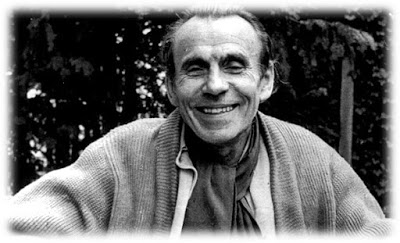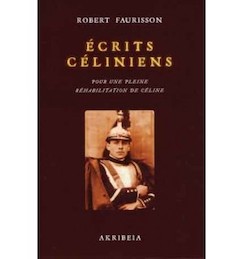Pour une pleine réhabilitation de Céline (texte inachevé)
Étude extraite de Écrits céliniens, Akribeia, 2019, 192 pages ; 20 euros
Il se colporte de graves erreurs sur le compte de Louis-Ferdinand Céline et, en particulier, sur ce qu’on appelle ses « pamphlets », que, pour ma part, je nomme des « satires ».[1]
La première erreur, soigneusement entretenue par certains, consiste à prétendre que la raison principale pour laquelle Céline a rédigé ces satires est sa haine des juifs en tant que tels. En réalité, son principal motif a été sa peur et son horreur de la guerre et, s’il s’en est pris aux juifs, c’est essentiellement parce qu’à la veille de la guerre il a tenu ces derniers, dans leur ensemble, pour les plus farouches bellicistes du temps. Selon lui, les juifs, dans leur haine d’Adolf Hitler, aspiraient à une croisade guerrière contre l’Allemagne ; tel était en particulier le cas des juifs aux États-Unis, en Angleterre, en Union soviétique et en France. En 1937-1938, comme beaucoup, il sentait venir la guerre, il s’en alarmait, il sonnait le tocsin. Il redoutait une boucherie qui, à son avis, serait, pour les Européens, y compris pour les prolétaires russes, bien pire que celle de 1914-1918. Il adjurait ses contemporains de raison garder et de rester sourds aux appels à la croisade.
La deuxième erreur porte sur le titre même de ses deux principales satires : Bagatelles pour un massacre (1937) et L’École des cadavres (1938). À force de s’entendre répéter que, dans ces deux ouvrages, Céline exprimait sa haine des juifs, bien des lecteurs se sont imaginé que le massacre et les cadavres en question ne pouvaient être que ceux des juifs. En réalité, ce massacre et ces cadavres, nous dit expressément Céline, seront ceux d’Aryens. Sous ce terme d’«Aryens», l’auteur désigne ceux qu’il lui arrive aussi d’appeler des « indigènes », des « autochtones », des « Blancs » ou des « goïm » (pluriel du mot hébreu « goy », le mot de « goïm », sous différentes orthographes françaises, désigne les « non-juifs » ou les « Gentils »). Céline, en somme, n’a pas écrit Bagatelles pour un massacre [des Juifs] mais Bagatelles pour un massacre [des Aryens] ; il n’a pas non plus écrit L’École des cadavres [juifs] mais L’École des cadavres [aryens].
La troisième erreur est la plus grave. Elle revient à prétendre que, de toute façon, avant ou pendant la guerre, soit dans ses satires, soit ailleurs, Céline a préconisé une politique visant à éliminer physiquement les juifs. En réalité, il a souhaité qu’à défaut de la Palestine, dont, à l’époque, bien des juifs ne semblaient plus vouloir à cause de l’opposition des Palestiniens et des Anglais, les juifs n’avaient qu’à s’établir n’importe où hors d’Europe.
En conclusion, les satires de Céline sont fondamentalement l’œuvre d’un pacifiste et, accessoirement, celle d’un antisémite (pour être plus exact d’un antijuif) aspirant à voir les juifs quitter le continent européen.
Parmi les spécialistes de Céline il en est qui, s’imposant une sorte de censure, n’ont lu ses satires que de façon superficielle et ont été ainsi amenés à commettre tout ou partie des trois erreurs qu’on vient de voir. Il est d’autres spécialistes qui exigent et obtiennent la censure ; lors d’un récent colloque dont je parlerai ci-dessous, j’ai croisé ce type de censeurs qui, par le tapage et l’intimidation, sont parvenus à me faire retirer la parole quand ils ont pressenti ce que je m’apprêtais à dire sur le sujet.
Les satires de Céline sont au nombre de quatre : Mea culpa (1937 [en fait, 28 décembre 1936], 21 petites pages de texte), Bagatelles pour un massacre (28 décembre 1937, 374 grandes pages de texte), L’École des cadavres (annoncé par l’éditeur le 24 novembre 1938, 305 grandes pages de texte) et Les Beaux Draps (25 février 1941, 222 pages de texte). Quelquefois, par commodité de langage, Céline usait du mot de « pamphlets », mais on notera qu’il lui arrivait aussi d’en parler comme de « [s]es poèmes ». Bien qu’ils soient en prose, ces écrits, de nature le plus souvent lyrique, pourraient effectivement être tenus pour des « poèmes satiriques » et s’inscrire dans la grande tradition de la Satire Ménippée, des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné ou des Châtiments de Victor Hugo. Personnellement, je réserve l’appellation de « pamphlet » ou de « libelle » à une œuvre brève, ramassée, percutante, ne traitant que d’un sujet restreint ; tel est le cas de l’éblouissante lettre que Céline adressait à Jean-Paul Sartre sous le titre de : « À l’agité du bocal ».
Depuis la « Libération » de la France en 1944, seul Mea culpa a été réédité ; de retour d’URSS, l’auteur y dénonce l’imposture du « communisme matérialiste » (p. 16) et ne mentionne qu’à peine les juifs (p. 10, 27). Les trois autres satires continuent de faire peur. Leur réédition susciterait la colère des organisations et de certaines sommités juives. En particulier, Bagatelles et L’École contiennent de véritables diatribes contre les juifs tandis que, dans Les Beaux Draps, ouvrage publié au début de l’Occupation, l’auteur persiste dans ses attaques mais retient nettement ses coups ; cette soudaine retenue plaide tellement en faveur de Céline que, parmi ses accusateurs, il en est peut-être bien qui sont opposés à une publication des Beaux Draps parce que l’œuvre en question, si elle était à nouveau publiée, infligerait un démenti public à leur thèse du « fort méchant » antisémite. Le désastre militaire que prévoyait l’auteur s’est effectivement produit ; le pays se retrouve dans de « beaux draps » et, du coup, les juifs ont bonne mine ! Le « fort méchant » homme serait fondé, les nouvelles lois l’y autorisant, à redoubler ses coups contre les juifs, ces fauteurs de guerre ; or il les atténue considérablement. Certes, comme la guerre n’a pas cessé pour autant, il lui faut bien poursuivre son combat mais il y met sensiblement moins de virulence.
Aujourd’hui, ces satires ne sont accessibles que dans des éditions anciennes qui s’achètent au marché noir ou dans des éditions pirates quand elles ne se lisent pas tout simplement sur la Toile.
Un demi-siècle après la mort de l’auteur, survenue le 1er juillet 1961, ces satires, qui forment un ensemble de plus de 900 pages, sont plus que jamais indispensables pour la compréhension à la fois des idées et de l’art de Céline. Oublions pour un instant les autorités morales, les directeurs de conscience et les belles âmes qui nous alertent à propos du danger persistant que présenteraient en particulier Bagatelles et L’École, deux œuvres qui sont, aujourd’hui, septuagénaires mais qui, ayant conservé toute leur vigueur et leur justesse, sentent encore le soufre. Quant à leur auteur, ne cédons pas à la facilité qui consiste à partager un homme en deux et à croire que, sous le grand écrivain et sous ses habits de lumière, Céline posséderait d’inavouables attributs qu’il nous faudrait voiler. N’allons justement pas le voiler, l’amputer, le châtrer ou le couper en deux ! Évitons le ridicule qu’il y aurait à soutenir en quelque sorte que, génial partout ailleurs, Céline aurait été sujet à une totale et subite panne de génie au moment de rédiger ces satires. On va le constater : loin d’être subitement devenu aveugle, il a conservé toute sa perspicacité ; loin de s’être laissé aveugler par la haine, il a voulu se porter au secours d’une humanité prête à cette forme de suicide collectif qu’est une guerre mondiale. En outre, du point de vue de son art, c’est dans Bagatelles et dans L’École qu’il va commencer à prendre son véritable essor parce que, sous le coup de la panique et de l’indignation que suscite en lui la perspective d’une horrible boucherie, il va se libérer de bien des contraintes littéraires et, pour la première fois, il laissera s’exprimer son génie dans toute sa force.
Serge Klarsfeld, aujourd’hui chasseur de nazis valétudinaires, fait partie des castrateurs ; pour lui, Céline serait un parfait salaud en raison de ses « immondes écrits antisémites » (Le Monde, 23-24 janvier 2011, p. 21). Pour Henri Godard, spécialiste de Céline, ce dernier « émerge comme un des grands créateurs de son temps […] mais il est aussi l’auteur de pages d’un insupportable antisémitisme […]. C’est un écrivain à deux faces » (Le Monde, 25 janvier 2011, p. 19). À en croire Bruno Frappat, journaliste catholique pour qui on peut supposer que « Dieu est amour », Céline serait d’abord « un pur salaud dont une partie des écrits demeure tellement ignoble qu’elle est introuvable aujourd’hui, non publiée, indisponible sauf à fouiller dans de très vieilles bibliothèques » ; puis, [Céline] serait aussi un très grand écrivain mais « un sale bonhomme » doté d’une langue « de vipère » ; enfin, il serait « un féroce, un méchant atrabilaire, un fou hystérique, un délateur, un assassin verbal » ; une partie de son œuvre serait « immense, géniale » tandis que l’autre partie serait d’un « petit, minable, pauvre type pour tout dire » (« Dignité, indignité », La Croix, 29-30 janvier 2011, p. 24). B. Frappat, déjà en 1987, sur le même ton, condamnait fort dévotement « les révisionnistes, les exclueurs de tout poil, les fortes têtes du mensonge et de la falsification, les gangsters de l’histoire » (Le Monde, 5-6 juillet 1987, p. 31).
S. Klarsfeld est dans son rôle. Il tient le fouet et il en use. Volontiers il prône la violence et, s’il le faut, l’élimination physique. Parmi les dix agressions physiques que m’ont valu mes écrits sur le «génocide des juifs» et les « chambres à gaz nazies », en voici une qui a été approuvée par S. Klarsfeld. Le 16 septembre 1989, trois jeunes juifs venus de Paris m’ont tendu un guet-apens à proximité de mon domicile (non sans la complicité d’un jeune juif, qui, déjà deux ans auparavant, m’avait sérieusement blessé). Sans l’intervention d’un solide gaillard qui, plus tard, découvrant mon nom, allait déclarer à la police qu’il regrettait de s’être porté à mon secours, j’aurais perdu la vie. Mais enfin, grâce à lui, mes « assassins mous » avaient dû prendre la fuite. Au sujet de cette agression S. Klarsfeld confiait alors à Radio J : « C’est quelque chose, je dirais, de regrettable, peut-être, mais de normal et de naturel ». Quant à son épouse Beate, elle s’étonnait : « Quoi de plus normal ? » (Le Monde, 19 septembre). Pour sa part, La Lettre télégraphique juive du 18 septembre titrait : « Faurisson victime de ses provocations ». Les juifs ont, il faut le dire, une longue et riche tradition de l’assassinat au service des causes qui leur sont chères ; sur le sujet, on lira, par exemple, l’ouvrage de Nachman Ben Yehuda, Political Assassinations by Jews. A Rhetorical Device for Justice ([Un moyen d’expression au service de la justice], State University of New York Press, Albany 1993, XX-527 p.).
B. Godard est sincère. Mais sa défense, un peu trop facile, risque de ne pas convaincre. Quelles que puissent être ses contradictions, un écrivain n’est qu’un homme et un homme n’a qu’une face.C’est cette face unique qu’il nous faut scruter. C’est cet homme dans son intégrité et dans son intégralité qu’il nous faut examiner.
Quant à B. Frappat, il n’est pas exclu qu’il donne dans la surenchère pour avoir montré en 1978-1979, au sein du journal Le Monde, quelque compréhension à l’égard du révisionniste que j’étais et qui, à l’époque, était devenu l’objet d’une véritable chasse à l’homme.
Avant tout, l’horreur de la guerre
Si l’on se donne la peine de les examiner sans en omettre l’ensemble des 900 pages que constituent les satires, les écrits de Céline sont là qui nous permettent de voir leur auteur de pied en cap dans sa diversité, sa richesse, son unité. Céline est fondamentalement une sorte de Chouan (très attaché à la Bretagne), généreux, chimérique, avec une once d’anarcho-communisme (mais un «communisme Labiche», joyeux, à la française, sorte d’idéal pour « rêveur bardique »). En 1914 le cuirassier Louis-Ferdinand Destouches a, jusque dans sa chair, connu les horreurs de la guerre ; par la suite, à juste titre, il en viendra à dénoncer non seulement la guerre elle-même mais aussi les bobards qui nécessairement la précèdent, puis cette propagande à base de récits d’atrocités fictives qui accompagnent et suivent les boucheries à répétition. Dans les années 1930 il se promet de tout faire, de tout dire, quoi qu’il doive lui en coûter personnellement, pour que ses frères humains, s’avisant à temps de ces abominations et de ces mensonges, ne s’y laissent pas prendre une nouvelle fois. Certes ses opinions sont celles d’un pacifiste et d’un racialiste ; elles sont aussi celles d’un antijuif ou, comme on dit, d’un « antisémite », mais non dans le sens criminel qu’on donne aujourd’hui à ces termes. Loin d’avoir souhaité une élimination physique des juifs, il a été antijuif comme l’ont été tant de ses contemporains, qu’ils fussent de droite comme Maurras ou de gauche comme Jaurès, mais, à sa manière, dans son style et avec cette force et ce génie qui jamais ne le quitteront plus. Je reviendrai là-dessus.
Sorti grièvement blessé de « la Grande Guerre », il se sent pris d’une juste colère lorsque, dans les années 1930, il pressent qu’un nouveau massacre se prépare à l’échelle du monde.
Les juifs, eux – du moins ceux qui, tel Bernard Lecache, se font les porte-parole les plus tonitruants de la communauté juive, – veulent la guerre. Ils réclament à hauts cris la croisade, la guerre sainte contre Hitler. Céline voit qu’ils ne sont pas les seuls à s’enivrer de ces incitations au massacre ; en France, ne se rencontre-t-il pas aussi quelques inconscients pour « se saouler à l’eau de la Marne » et qui rêvent d’en découdre une fois de plus avec le Boche ? Mais ces « tartarins de nécropoles » ne sont quasiment rien ; ils n’ont ni le poids ni les moyens des organisations juives avec leurs ramifications à l’étranger qui permettent d’entretenir le feu sacré de la haine, en particulier depuis Londres et New York. Les juifs seront donc la cible principale que s’est choisie Céline parce que les représentants des organisations juives sont les plus riches et les plus puissants, les plus doués et les plus résolus des bellicistes de leur temps, et cela non seulement en France mais aussi sur le plan international.
Voyage au bout de la nuit (octobre 1932)
Comment s’y est-on laissé prendre ? Comment des intellectuels ont-ils pu, à la parution du roman et dans les quelques années qui ont suivi, cataloguer Céline à gauche ? L’épigraphe de Voyage au bout de la nuit était parlante. « Littré le dit, qui ne se trompe jamais », une épigraphe est « une courte citation qu’on met en tête d’un ouvrage ou d’un chapitre, pour en indiquer l’esprit ». Or, voici ce que découvrait le lecteur à l’ouverture même du livre :
Notre vie est un voyage
Dans l’hiver et dans la Nuit,
Nous cherchons notre passage
Dans le ciel où rien ne luit.
Chanson des Gardes Suisses / 1793.
Peu nous importe ici la date ou les circonstances où a été écrite cette chanson. Rappelons simplement que c’est surtout au palais des Tuileries, le 10 août 1792, que les Gardes suisses ont été massacrés par les émeutiers mais, jusqu’à la fin de septembre, on tuera ou guillotinera d’autres Gardes suisses qui, eux, ont été faits prisonniers. En 1793 (date ici indiquée par Céline), le roi et la reine, à la défense desquels ils s’étaient voués, seront guillotinés. Ayant décidément tout perdu, les vaincus entrent alors dans une nuit au bout de laquelle il n’y aura plus pour eux que… la nuit. Tel sera aussi le sort des Chouans, ces « pays » ou compatriotes du Breton de cœur qu’est Louis-Ferdinand Destouches. Le 1er décembre 1945 il écrira de son exil au Danemark, au docteur Alexandre Gentil à propos de Chateaubriand : « Je suis plongé dans les mémoires d’outre-tombe que mon avocat m’a prêtés. Je peux les relire sans cesse. Ils me parlent de cette Bretagne où j’ai tout laissé, où je retournerai mourir si l’on me laisse. Je ne suis qu’un breton de Paris. Je souffre de la nostalgie des cavaliers bretons que j’ai bien connu [sic] au 12e cuirassier puisqu’ils formaient le régiment. Nous demeurions à St Malo sous le grand Bé dans l’ombre de Châteaubriant [sic]. Le vicomte, qui a profité après tout des derniers beaux éclats français [,] après lui la grandeur s’est éteinte. Il n’y eut plus que haines et rabacheries d’envies » (Revue des Deux Mondes, décembre 2011, p. 32). « Les jeux sont faits ! depuis 93 ! […] la merde 93 » (L’École des cadavres, p. 41, 153).
L’éblouissant discours qu’il place dans la bouche de Princhard [dans Voyage au bout de la nuit] est sans équivoque. Certes ce professeur quelque peu « cabotin » « avait le vice des intellectuels, il était futile ». Mais il n’empêche que sa philippique contre l’esprit révolutionnaire est manifestement nourrie des convictions de Céline. Pour lui, la seule vraie conquête des « premiers couillons voteurs drapeautiques », enivrés de Diderot, de Voltaire, de Carnot, de Danton, de Dumouriez a été le droit de se battre et de se faire tuer gratuitement : « Le soldat gratuit ça c’était du nouveau… » Par la suite, « tout le monde s’en est bien trouvé. Bismarck, les deux Napoléon, Barrès aussi bien que la cavalière Elsa [de Pierre Mac Orlan, en 1921]. La religion drapeautique remplaça promptement la céleste, vieux nuage déjà dégonflé par la Réforme et condensé depuis longtemps en tirelires épiscopales ». Quant aux mensonges dont l’homme est capable, en particulier pour faire croire à l’exceptionnelle inhumanité de l’ennemi, Céline, en révisionniste d’avant la lettre, a su les évoquer ou les décrire avec la verve du désespoir : « On mentait avec rage au-delà de l’imaginaire, bien au-delà du ridicule et de l’absurde, dans les journaux, sur les affiches, à pied, à cheval, en voiture. Tout le monde s’y était mis. C’est à qui mentirait plus énormément que l’autre. Bientôt, il n’y eut plus de vérité dans la ville. […] Le délire de mentir et de croire s’attrape comme la gale ».
À défaut de passer en revue tous ses écrits pour voir s’il est ce parfait salaud qui contrasterait si fort avec l’écrivain génial, limitons-nous à ses quatre satires.
Dans les 21 petites pages de Mea culpa, où, à la suite de son séjour en Union soviétique, il dénonce l’imposture du communisme moscoutaire, on ne trouve que deux courts passages où il soit question des juifs : 1) « Se faire voir aux côtés du peuple, par les temps qui courent, c’est prendre une “assurance-nougat”. Pourvu qu’on se sente un peu juif ça devient une “assurance-vie”. Tout cela est fort compréhensible » (p. 10) ; 2) « On deviendra “totalitaires !” Avec les juifs, sans les juifs. Tout ça n’a pas d’importance ! » Ces allusions probables à Léon Blum, à ses nombreux collaborateurs juifs et sans doute aussi à Georges Mandel (Jeroboam Rothschild) n’avaient, à l’époque, pas grande portée et, vu la liberté de langage dont on usait alors aussi bien à gauche qu’à droite, elles ne pouvaient guère tirer à conséquence. Pourtant, à en croire l’intéressé, le modeste opuscule allait déclencher la fureur de nombre de juifs établis en Palestine :
À la suite de Mea Culpa il m’est arrivé de Palestine tellement de lettres en quelques courriers, que ma concierge s’en est émue. Elle m’a demandé ce qu’elle devait faire. Les Juifs ils m’écrivaient en masse, de Tel-Aviv et d’ailleurs. Et puis alors sur un ton ! dans les furies d’une de ces rages ! à en consumer les enveloppes ! Ils se poussaient au rouge-blanc, les énergumènes ! Ah ! les petits Passionnistes !… (Et voilà) Ah ! ils les aiment eux, les Soviets ! Ça je peux vous l’affirmer ! Si les chrétiens aimaient leur Pape avec cette ferveur effrayante, le Pape il ferait explosion, il pourrait jamais résister » (Bagatelles pour un massacre, p. 76).
Point important et qu’on nous cache : Céline n’a rien de spécial contre les juifs mais c’est contre « le racisme juif » qu’il se révolte. Il revient souvent sur sa détestation du « racisme » tel qu’il se manifeste chez les juifs, à ses yeux un « racisme implacable [avec] son pouvoir inouï de mensonge, absolument spontané, monstrueux de culot » (p. 127), son orgueil insensé, le recours à la violence et cette façon de s’emplir les poches et de conquérir les bonnes places tout en geignant. Pour commencer, il nous le dit en toutes lettres :
Je n’ai rien de spécial contre les Juifs en tant que juifs, je veux dire simplement truands comme tout le monde, bipèdes à la quête de leur soupe… Ils me gênent pas du tout. Un Juif ça vaut peut-être un Breton, sur le tas, à égalité, un Auvergnat, un franc-canaque, un « enfant de Marie »… C’est possible… Mais c’est contre le racisme juif que je me révolte, que je suis méchant, que je bouille, ça jusqu’au tréfonds de mon bénouze !… Je vocifère ! Je tonitrue ! Ils hurlent bien eux aux racistes ! Ils arrêtent jamais ! aux abominables pogroms ! aux persécutions séculaires ! C’est leur alibi gigantesque ! C’est la grande tarte à leur crème ! On me retirera pas du tronc qu’ils ont dû drôlement les chercher les persécutions ! foutre bite ! Si j’en crois mes propres carreaux ! S’ils avaient moins fait les zouaves sur toute l’étendue de la planète, s’ils avaient moins fait chier l’homme ils auraient peut-être pas dérouillé !… Ceux qui les ont un peu pendus ils devaient bien avoir des raisons… On avait dû les mettre en garde ces youtres ! User, lasser bien des patiences… ça vient pas tout seul un pogrom !… C’est un grand succès dans son genre un pogrom, une éclosion de quelque chose… C’est pas bien humainement croyable que les autres ils soient tous uniquement fumiers… Ça serait trop joli… (p. 72).
Le vocabulaire et la verve du satiriste mis à part, on retrouve dans ces lignes l’une des pensées directrices de l’érudit juif français Bernard Lazare (1865-1903). Il faudrait avoir la franchise de l’admettre et, lorsque des universitaires, obéissant à une manie qui leur est chère, se mettent en quête des « influences » que subirait tel auteur, ne devraient-ils pas tous, quand il s’agit de Céline, nous parler de « l’influence possible de Bernard Lazare, le défenseur du capitaine Dreyfus sur l’auteur de Bagatelles pour un massacre » ?
Céline insiste sur le fait qu’il n’est ni réactionnaire ni fasciste mais communiste dans l’âme : « […] je suis pas réactionnaire ! pas pour un poil ! pas une minute ! pas fasciste […] je répète et tout de suite !… Moi je me sens communiste sans un atome d’arrière-pensée » (p. 80-81).
Ce que, par une formule d’ironie antiphrastique, Céline appelle des « bagatelles » ne sont des riens qu’en comparaison du gigantesque massacre à venir ; ces « Petits Riens » sont dotés de majuscules (p. 27) car il s’agit, dans la préparation d’un ballet comme dans celle d’une guerre, de ces détails prémonitoires qui ont leur importance. Il nous prédit une fantastique tuerie des Blancs par les Blancs. Il nous décrit une France « vouée à la destruction, au massacre enthousiaste par les Juifs » et promise à « l’immense tuerie prochaine ». Selon lui, les Français vont se ruer à l’abattoir grâce, en particulier, aux moyens de « la grande propagande juive “au martyr juif” pour la cause jamais complètement, suffisamment couronnée, triomphante d’Israël ». Le Français aura droit à « tous les jeux d’orgue sursoufflés de l’éternelle jérémiade juive […]. Le coup du Juif “traqué”, “martyr”, prend encore toujours, immanquablement sur ce con de cocu d’Aryen […] ; le “Chaplinisme” le fait toujours mouiller […]. Le récit de ces “horreurs” le trouve sans méfiance, sans résistance, sans scepticisme. Il avale tout. Les malheurs juifs font partie de la légende… la seule légende d’ailleurs à laquelle croit encore l’Aryen […] L’agresseur hurle qu’on l’égorge ! Le truc est vieux comme Moïse » (p. 131-133). « Je ne veux pas faire la guerre pour Hitler, moi je le dis, mais je veux pas la faire contre lui, pour les Juifs… On a beau me salader à bloc, c’est bien les Juifs et eux seulement, qui nous poussent aux mitrailleuses… Il aime pas les Juifs Hitler, moi non plus ! » (p. 317).
Céline, par moments, semble posséder le don de prophétie. Convaincu que les pousse-au-crime se sortiront fort bien de la guerre, il écrit : « Quand ça deviendra trop compliqué, Thorez s’en ira au Caucase, Blum à Washington […] » (p. 316). Or le responsable des communistes français, Maurice Thorez, en octobre 1939, désertera pour se rendre avec son épouse en Union soviétique et, lorsque les Allemands approcheront de Moscou, le couple trouvera refuge à Oufa dans l’Oural. Céline l’appelle « Cadum », le voit à la merci des juifs et se moque de sa « bonne grosse tronche » en couverture de sa biographie. Savait-il que le fameux bébé qui avait servi de modèle au « Bébé Cadum » était juif et que Fils du peuple était l’œuvre, en réalité, de Jean Fréville (de son vrai nom Eugène Schkaff, fils d’un financier juif russe) ainsi que d’un André Vierzboloviez ? Quant à Léon Blum, il n’a pu se réfugier à Washington mais, malgré les vicissitudes du procès de Riom, il a été en mesure, lors de son interrogatoire par le président du tribunal, de démontrer que son gouvernement avait, plus que tout autre, financièrement contribué au renforcement de l’armée française. Par ailleurs, comme on le sait, le procès a tourné court. Interné successivement au château de Chazeron, au château de Bourassol, au fort du Portalet, il a bénéficié durant sa détention de conditions privilégiées. Certes, il a été déporté en Allemagne mais, là encore, il a eu droit à un traitement spécial (« Sonderbehandlung ») : il a été interné près de Buchenwald dans une maison particulière avec, pour le servir, un valet de chambre allemand prénommé Joachim. Il y disposait du téléphone et de la radio. Il entretenait une abondante correspondance, y compris avec Churchill et Roosevelt ! Jeanne Levilliers Torres Reichenbach allait recevoir la permission de le rejoindre dans cette maison et de l’épouser en justes noces israélites. Tout cela peut se vérifier notamment dans L’Œuvre de Léon Blum (Mémoires. La Prison et le procès. À l’Echelle humaine. 1940-1945), Albin Michel, Paris, 1955, p. 520-521, ou dans un article d’Agnès Bensimon, « Léon Blum, juif malgré lui » (Tribune juive, 6 février 1987, p. 16). Céline, pour sa part, connaîtra au Danemark juste après la guerre d’éprouvantes conditions de détention (des médecins danois en ont témoigné) et il écrira au substitut Jean Seltensperger : « En ce temps-là [durant l’Occupation] M. Blum partait en “Captivity-Party” se marier en Allemagne » (lettre du 25 juin 1949 in L’Année Céline 1997, Du Lérot éditions, Tusson 1998, p. 32).
Dans l’histoire de l’art et du style de Céline, Bagatelles pour un massacre marque une étape si importante que certains parmi les céliniens sont impardonnables d’afficher leur indifférence, leur colère ou leur mépris face à une œuvre de ce calibre. En son temps, après la tourmente révolutionnaire, Victor Hugo, autre satiriste, s’était insurgé contre « le bon usage » que continuaient de respecter ceux qui se piquaient alors de bien écrire ; il avait ressenti le besoin de renouveler l’expression littéraire ; il l’avait fait non en barbare inculte et destructeur mais, au contraire, comme un esprit délié qui, nourri de culture classique, savait toutes les ressources de notre langue. Céline, en son propre temps, fait de même. Il est aujourd’hui admis qu’il a renouvelé notre langue et qu’il lui a redonné vie. Mais comment l’a-t-il fait ? Quel a été son cheminement ? Quelles ont été les étapes de cette transformation ? Voyage au bout de la nuit ne marque que la première étape de son aventure littéraire parce que l’œuvre, malgré ses audaces, reste encore de facture relativement classique. Mort à crédit marque la deuxième étape ; l’auteur s’y émancipe franchement et donne forme à un nouveau langage. À mon avis, Bagatelles pour un massacre marque la troisième étape : prenant définitivement son envol vers les sommets de son art, Céline y devient célinien au plein sens du terme. Il lui a poussé des ailes. Son vocabulaire s’enrichit de multiples trouvailles ; sa syntaxe se débride ; son style gagne en vigueur et en hardiesses ; le souffle du lyrisme, tout au long des 97 fragments du livre, emporte tout sur son passage. Il y a beau temps que la langue française n’avait connu pareil bain de jouvence. Mais, se demandera-t-on, d’où cette énergie soudaine et cette éruption proviennent-elles sinon d’un irrésistible besoin d’alerter au plus vite ses contemporains quand, à l’horizon, s’annonce la pire des tempêtes ? La force de l’ouvrage réside dans l’adéquation parfaite d’un fond fait de révolte et d’une forme d’inspiration révolutionnaire : dans le fond, l’auteur se révolte contre le conformisme du Français que les puissants du jour mènent si aisément à l’abattoir, et, dans la forme, il entreprend une révolution du langage ; jugeant que nos « grands auteurs » du temps parlent et écrivent un français « mort », il va revivifier notre langue. Refusant tout conformisme, il sera seul et dans ses idées et dans son style. Dans les deux cas, il sera contre la mort et pour la vie.
À cor et à cri le voici qui tente d’éveiller un peuple inconscient du danger et, l’angoisse au cœur, il montre à ses compatriotes d’où va venir l’ouragan ; il était donc par avance exclu qu’il pût le faire dans le style convenu du rhéteur, du penseur ou du moraliste. Par moments il nous fera entendre les accents du prophète cependant qu’au peuple il tendra à parler son langage mais avec un art consommé dans le choix des idées, des mots et du rythme. Sa fureur, son angoisse et l’urgence de la situation lui dictent d’apparentes vaticinations. Trait étrange de ce prophète-là : il parsème sa mercuriale d’inventions comiques, lesquelles présentent l’avantage de détendre une atmosphère qui sans cela deviendrait oppressante et, à la longue, irrespirable.
À ceux qui sont tentés de partir pour la plus sanglante des croisades, il fait entendre « cette grande musique, tantôt symphonique, tantôt rigodon… plus tard Carmagnole » (p. 260). Déjà se perçoivent ici les accents aussi bien de Féerie pour une autre fois (1952) avec l’évocation des horreurs de l’Épuration, que de cette épopée que sera la trilogie allemande (D’un château l’autre, Nord et Rigodon) publiée de 1957 à 1961, année de la mort de l’auteur. L’épopée est un privilège des vaincus, frappés qu’ils sont par les dieux ; le vainqueur n’a droit qu’au péan de l’autosatisfaction. C’est dans cette épopée en trois temps, allemande ou continentale, que le cavalier Destouches parviendra à la pointe extrême de son destin, de son combat et de son art. En ce sens, du point de vue de l’inspiration comme du point de vue de l’art, Bagatelles pour un massacre [des Aryens] est un prélude à la trilogie allemande : « la race blanche est morte à Stalingrad », dira-t‑il plus tard ; l’Allemagne, « notre mère à tous » (la formule est de Nerval), sera phosphorisée, ses citadins en seront réduits à l’état de troglodytes, ses filles et ses femmes serviront aux journées franches des vainqueurs. Dès 1937 Céline prédit la Sainte Alliance des États-Unis et de l’Union soviétique ! Pour lui, cette alliance n’est pas contre nature. Le communisme russe est juif à la fois dans sa naissance et en son essence tandis qu’à Washington règne l’oligarchie juive du capital. Mongols et juifs mettront le monde en feu. Le feu de leur idéologie matérialiste commune alimentera la fournaise à venir : ainsi se produira « la surfusion des pyrites dans la prochaine Bacchanale ! L’Idéo-fournaise Mongo-youtre 1940 ! » (p. 274). Bien sûr, les juifs ne manqueront pas de gémir sur leur « martyre » : « C’est un bidon phénoménal ce grand martyre de la race juive » (p. 73).
Dans l’éblouissant premier alinéa du livre Céline brode non sur la conviction qu’il est « raffiné » (car quelle chochotte en ce cas !) mais sur l’impression que, tout bien réfléchi, il est peut-être « un raffiné » : « Moi, votre serviteur, je crois bien que moi, je suis un raffiné ! Tel quel ! Authentiquement raffiné. » Le ton est alors celui d’une gouaille typiquement française. Il n’y a pas d’humour dans ses écrits mais de la gouaille. Ses subtilités, qui ne sont pas de la préciosité mais témoignent d’une rare maîtrise de la langue, présentent un inconvénient : le profane risque de ne pas les saisir ; il percevra le son fondamental des textes mais les harmoniques pourront lui en échapper. Céline lui apparaîtra sinistre alors qu’il est « agonique mais marrant » (Féerie pour une autre fois, p. 102) et on peut le croire quand il s’autorise à dire : « Gaîté, ma force » (Ibid., p. 131). Il joue et il surjoue. Il feint le délire. C’est dans ces instants lyriques que les esprits graves ne le suivent plus. Faute d’avoir noté que, loin de délirer, l’auteur a pris son envol vers un autre monde, plus léger ou plus aérien que le leur, voici que ces lourdauds s’engoncent encore plus dans leur gravité. Ces gens-là pensent qu’il est des sujets trop sérieux pour qu’on en traite ainsi avec d’apparents excès aussi bien dans la pensée que dans le langage. Ils ont devant eux un écrivain capable à la fois de « mettre sa peau sur la table » et de revivifier notre langue, mais parce qu’ils ne le voient pas tel qu’il est, ils portent condamnation. C’est à ces pieds-plats parmi ses semblables que songera Céline quand, s’imaginant outre-tombe, il dira des hommes qu’il vient de quitter : « Ils étaient lourds ! »
L’École des cadavres
L’École des cadavres est la continuation ou la reprise de Bagatelles pour un massacre. Environ neuf mois après la parution de cette nouvelle mise en garde contre l’acceptation de la guerre, l’humanité, en septembre 1939, accouchera d’une monstruosité comme elle n’en a pas connu depuis qu’il y a des hommes et qui tuent. En six ans, des dizaines de millions de soldats et de civils vont connaître ce que Céline leur avait prédit. On va, par centaines de milliers, phosphoriser les civils allemands et, pour faire bonne mesure, infliger aux civils japonais le feu nucléaire. Le 3 septembre 1939, comme l’avait prédit Céline, la Grande-Bretagne boute le feu au monde en déclarant la guerre à l’Allemagne ; elle est suivie par la France qui, le même jour, quelques heures plus tard, « entrera en guerre » contre l’Allemagne (sans véritable consultation du Parlement sur une « déclaration de guerre », c’est-à-dire en violant la Constitution qui était la sienne). Motif principal : Adolf Hitler a envahi la Pologne le 1er septembre. Or son allié d’alors, Joseph Staline, obligé d’attendre deux semaines encore pour en finir avec des divisions japonaises à sa frontière en Mandchourie, envahira la Pologne à son tour le 17 septembre 1939, et cela en dépit du traité de non-agression qui lie l’Union soviétique et la Pologne. Non seulement on ne lui déclarera pas la guerre mais, en 1945, en accord avec les États-Unis et l’Angleterre, on lui livrera en quelque sorte cette même Pologne et d’autres nations européennes encore. Les Soviétiques camperont à Vienne et occuperont leur part d’une Autriche démembrée. Des atrocités sans nom vont émailler cette « Seconde Guerre mondiale ». Je songe ici aux atrocités réelles ; je ne parle pas de celles qui seront tardivement forgées par la propagande de guerre, en particulier au sujet d’un « génocide des juifs » et de « chambres à gaz » ou de « camions à gaz » homicides ; je ne parle pas non plus d’autres inventions comme la liquidation systématique des juifs par l’électricité, par la vapeur d’eau, par le feu des fournaises ou par la chaux vive ni de leur transformation en savon. Cette propagande-là n’a pas pris fin avec la guerre ; au contraire, elle n’a vraiment commencé qu’à partir de 1945-1946 lors du premier grand procès-spectacle des vaincus, un procès instruit et conduit par leurs vainqueurs, à Nuremberg, où, conformément aux articles 19 et 21 du statut de ce tribunal – en réalité interallié et non international – l’accusation et les juges cyniquement se dispenseront d’avance de fournir des preuves (« Le Tribunal ne sera pas lié par les règles relatives à l’administration des preuves […]. Il n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique mais les tiendra pour acquis […] »). Les vainqueurs auront recours à la rétroactivité des lois, à la responsabilité collective et aucun appel ne pourra être interjeté. « Nuremberg ou les Faux Monnayeurs », « Nuremberg ou le modèle du procès joué d’avance », « Nuremberg ou la vengeance de Yahwé » ! L’auteur de L’École des cadavres a vu venir la catastrophe avec, d’une part, ses horreurs vraies et, d’autre part, le « phénoménal bidon » de tant de bobards de guerre. D’autres que lui, bien sûr, avaient senti qu’approchait la grande tuerie mais il a peut-être été le seul à pressentir à la fois la guerre elle-même et l’extraordinaire étendue des mensonges qui l’accompagneraient et la suivraient. L’École des cadavres est peut-être le seul écrit de tous les temps où un homme crie avec une telle intensité à l’imminence d’un désastre planétaire avec les accents d’un condamné à mort lisant dans le ciel et dans les hommes que tout est perdu : il sait qu’on ne croira pas un mot de ses avertissements. Le Français ira à la guerre. Sorti de « l’École » où il aura, perinde ac cadaver, appris à écouter ses maîtres juifs, il fera un cadavre au plein sens du mot : « Allons tout de suite au fond des choses. Les Démocraties veulent la guerre. Les Démocraties auront la guerre finalement. » Par « Démocraties », il faut ici entendre les « masses aryennes domestiquées, rançonnées, vinaigrées, divisées, muflisées, ahuries par les Juifs au saccage, hypnotisées, dépersonnalisées, dressées aux haines absurdes, fratricides » (p. 25). « Et cinquante millions de cadavres aryens en perspective. […] Une boucherie punitive dont on parlera dévotieusement, admirativement, extatiquement, dans les chaumières aryennes pendant 20 siècles encore […]. [À la fin] Tous amochés, tous saignés, alors le Juif sera tranquille pour préparer la prochaine » (p. 28-29). « France crétine on vous arrangera aux petits obus » (p. 39). Aujourd’hui, en 2011, on nous entretient de ce que la propagande du IIIe Reich a pu débiter de récits vengeurs sur le compte des juifs, en particulier après l’assassinat à Paris en novembre 1938, par un jeune juif, du conseiller de légation vom Rath, mais Céline, qui lisait la presse américaine, savait que les diatribes de Julius Streicher, qui n’a jamais appelé à la mort des juifs[2], n’étaient que fadaises en comparaison de ce que les juifs américains lançaient contre Hitler et l’Allemagne :
Tout ce que peuvent tempêter, raffuter, tambouriner les hitlériens d’Allemagne contre les Juifs, les francs-maçons, ne dépasse pas le ton du ronchonnage, de la bougonnerie bonhomme en comparaison, des trombes, tourmentes, cyclones d’insultes, défis, vitupérances, malédictions, folles virulences, à l’adresse de Rome, Berlin, Franco, du Japon, dont toute l’Amérique littéralement vrombit, rafale, déferle à longueur de jour et de nuit. – C’est aux États-Unis que l’on observe au mieux, que l’on goûte, toute la panique du Juif, la folle angoisse qui l’étrangle, camouflée arrogance, à la moindre évocation d’une possibilité d’un règlement de compte général, mondial. Ils en perlent, ils en tétanisent, ils s’en désossent de terreur, comme sur la chaise d’exécution. « La guerre contre Hitler ! » Et tout de suite ! Ralliement, mot d’ordre, magie précipitative, évangélisation de toute la juiverie américaine, fantastiquement démocrate (p. 50).
Céline en était convaincu, c’est à Londres, c’est dans la City juive, que la décision serait prise de choisir entre la paix et la guerre : « Tous les déclics, de la Guerre, de la Paix, sont à Londres » (p. 65). Il prédisait : « La guerre pour nous, n’importe quelle guerre, malheureuse ou victorieuse, c’est tout pareil, c’est du suicide » (p. 80). « Nous irons à la guerre des Juifs. Nous ne sommes plus bons qu’à mourir » (p. 82). « Il règne sur tout ce pays, au tréfonds de toute cette viande muselée, un sentiment de gentillesse sacrificielle, de soumission aux pires boucheries, de fatalisme aux abattoirs, extraordinairement dégueulasse » (p. 89). La guerre à venir fera des « dizaines de millions » de morts » (p. 110). Qu’on me permette ici une question en passant : Céline mis à part, combien de personnes ont bien pu, avant 1939, avancer cette estimation, qui, folle en apparence, allait pourtant se vérifier ? Le paradoxe avec Céline est qu’il faut parfois le prendre au mot quand il bouffonne. Il exagère manifestement mais, avec le temps, beaucoup de ce qu’il écrit va se révéler exact.
Le « communisme authentique » pourrait sauver les hommes mais, malheureusement, « le communisme est avant tout vocation poétique. Sans poésie, sans ferveur altruiste brûlante, purifiante, le communisme n’est qu’une farce, le dépotoir de toutes les rages, de toutes les rancunes plébéiennes […]. On ne devient pas communiste. Il faut naître communiste, ou renoncer à le devenir jamais. Le communisme est une qualité d’âme » (p. 130-131). « Le Communisme sans poète, à la juive, à la scientifique, à la raison raisonnante, matérialiste, marxiste, à l’administrative, au mufle, au peigne-cul, au 600 kilos par phrase n’est plus qu’un très emmerdant procédé de tyrannie prosaïque, absolument sans essor, une imposture juive satrapique, absolument atroce, immangeable, inhumaine, une très dégueulasse forcerie d’esclaves, une infernale gageure, un remède pire que le mal » (p. 132-133). Hitler lui paraît le véritable ennemi du capitalisme, le véritable ami du peuple. Il a plus fait que l’URSS pour l’ouvrier. Il a plus fait pour le petit commerçant que Thorez. Il nous préserve de la Guerre. Il est « un bon éleveur de peuples. Il est du côté de la Vie. Il est soucieux de la vie des peuples, et même de la nôtre. C’est un Aryen » (p. 140). « Je me sens très ami d’Hitler, très ami de tous les Allemands, je trouve que ce sont des frères, qu’ils ont bien raison d’être racistes ». « Ça me ferait énormément de peine si jamais ils étaient battus » (p. 198). La seule solution serait une alliance « à chaux et à sable » avec nos frères allemands ; « la haine contre les Allemands, c’est une haine contre nature. C’est une inversion. C’est notre poison, et mortel. On nous l’injecte tous les jours, à doses de plus en plus tragiques » ; « ensemble on commandera l’Europe. Ça vaut bien la peine qu’on essaye » ; pris de peur, les Juifs, auxquels on aura juste un petit peu flambé le bout des arpions, « seront partis !… pour toujours !… » (p. 283-284). « Qu’avons-nous à perdre dans une alliance franco-allemande ? Les Juifs » (p. 292). Les Anglais, en cas de guerre, laisseront les Français se faire tuer et les « épauleront […] par l’aviation, la Navy » (p. 151). « Thé et mon droit », dira le gentleman (p. 171). Quant aux Russes ou Ukrainiens (autres « indigènes », victimes de Kaganovitch et ses semblables), « c’est vraiment presque impossible de se faire une petite idée, de concevoir même faiblement le degré de haine recuite où sont parvenues les masses russes vis-à-vis des Juifs. Ressentiment très explicable. Les Juifs ont assassiné plus de trente millions d’Aryens russes. La furie antisémite des Russes ne demande que la plus furtive occasion pour se donner libre cours, pour étonner le monde » (p. 185). « Racisme d’abord ! Racisme avant tout ! […] [Les Juifs] doivent foutre le camp » (p. 215). « Le monde antique, dont l’esprit était intensément cosmopolite », haïssait le Juif. « Ce qui prouve que nos très antiques ancêtres étaient beaucoup moins cons que nous. Ils avaient tout compris, tout de suite, admirablement » (p. 231). Le Maréchal Pétain – celui des années 1930 – se trompe d’adversaire : « Vous faites erreur, Monsieur le Maréchal ! L’ennemi est au Nord ! Ce n’est pas Berlin ! C’est Londres ! La Cité ! Les casemates-tout-en-or ! La Banque d’Angleterre avec ses laquais “framboise” ! Voilà l’ennemi héréditaire ! » (p. 289). La seule victoire qui pouvait nous intéresser « [était] le sac de la Banque d’Angleterre et des Juifs de Londres » (p. 290). Céline n’entretient aucune illusion sur la puissance militaire de la France, un pays qui a été saigné à blanc par la Première Guerre mondiale. Nous ne faisons plus peur à personne. La seule question : qui va prendre possession de morceaux de la France et « défranciser l’Algérie » ? « La France, chef-lieu le Vésinet » (p. 294). Soit dit en passant, c’est au Vésinet, ville résidentielle de la banlieue ouest de Paris, que, battant en retraite, le général à titre provisoire Charles de Gaulle installera son état-major en mai 1940. Le sort en est jeté : les hommes « fonceront toujours aux tueries, par torrents de viandes somnambules, aux charniers, de plus en plus colossaux, plantureux ». Feux grégeois, mitrailleries, fournaises, bengalades, pyrogénies hallucinantes. « L’école mirifique ! – Tout le monde sera reçu » (p. 296). Ladite école est L’École des cadavres. Le corps même du livre s’achève sur une réponse à ses calomniateurs : « De tous les côtés l’on m’annonce que j’ai touché des sommes formidables d’Hitler. C’est le canard classique, si j’ose dire. Je m’en fous énormément que l’on m’accuse des pires horreurs. J’ai l’habitude. C’est la bêtise de la supposition qui me blesse. Je me sens tout déprécié. Vous êtes trop cons, suppositeurs, pour inventer autre chose ? » Il répond qu’il est très riche, qu’il n’a besoin de personne, qu’il est peut-être « l’homme le moins achetable du monde », que sa mère continue de travailler à 71 ans et que, pour sa part, dit-il, « à 71 ans j’emmerderai encore les juifs, et les maçons, et les éditeurs, et Hitler par-dessus le marché, s’il me provoque ». « […] Et puis je vais encore vous dire une bonne chose. Les véritables fructueuses affaires se font à gauche, pas à droite. – C’est même curieux, à ce propos, l’Italie, l’Allemagne, voilà les deux seuls pays qui m’envoyent jamais un croc pour mes traductions. Ils traduisent et puis c’est marre » (p. 298-300). Après la guerre, Jean-Paul Sartre relancera le canard ; mal lui en prendra ; la riposte fusera avec le factum le plus percutant de toute la production célinienne : la lettre « À l’agité du bocal » (novembre 1947). Tous les titres de Céline sont recherchés et parfois énigmatiques : cet « agité » est, dans son bocal de laboratoire, le translucide ver solitaire, le ténia : « Tu me sors de l’entre-fesses pour me salir au dehors ». Céline a « fait » « Jean-Baptiste » Sartre (ce «puceau de l’horreur comme on l’est de la volupté», aurait-il pu dire). Sans formes et sans couleurs, dépourvu de style, le délateur n’est « ni dansant, ni flûtant ». Comme Céline l’écrira ailleurs, Sartre et ses existentialistes ne sont que de tristes « existenglaireux ». « Toujours au lycée, ce J.-B. S. ! »
« La France est bourrique [délatrice], c’est plein la Commandatur [sic, à la française] des personnes qui viennent dénoncer » (première page, numérotée 9). « Moi j’ai fait la retraite comme bien d’autres, j’ai pourchassé l’Armée Française de Bezons jusqu’à la Rochelle, j’ai jamais pu la rattraper » (p. 11). « Nous voici en draps fort douteux » (p. 19). La colère de Céline laisse place à la désillusion. Il pense que les événements ne lui ont que trop donné raison. L’armée française a été mise en déroute avec ses « Bruges Bayonne l’échalote ! “maillots-cacas” » (Féerie pour une autre fois, p. 52) ; entendez par là que, dans leur course éperdue de Bruges à Bayonne, les soldats français, pris de peur et de débâcle intestinale, souillant leurs uniformes et les yeux fixés au « trou » de celui qui les précède, obtiendront le maillot couleur caca de la déroute. Mais, en ce début de 1941, dans Paris occupé par l’armée allemande, il y a plus de juifs que jamais dans les rues, dans la presse, au barreau, en Sorbonne, en médecine, au théâtre, à l’Opéra, au Français [la Comédie française], dans l’industrie et les banques (p. 44). Le slogan qu’on nous impose est « Juivre ou mourir » (p. 57). « L’ouvrier si il s’en fout d’être aryen pur ! […] Les juifs responsables de la guerre ? Voilà encore une autre salade ! [pense Prolo] » (p. 72-73). « Le monde est matérialiste, le plus menu peuple compris » (p. 87). Chez les « damnés de la Terre » comme chez les bourgeois, règne « l’idéal “boa” des digestions de quinze jours […], l’enfer médiocre, l’enfer sans flamme. Y a des guerres qu’arrivent heureusement, de plus en plus longues. C’est fatal. – La terre se réchauffe » (p. 89). Le communisme à la Lénine ne saurait apporter de solution. « Lénine, Warburg [la banque], Trotzky, Rothschild [la banque encore] ils pensent tout semblable sur tout ça. Pas un prépuce de différence c’est le marxisme 100 pour cent » (p. 103). Les pages consacrées à la Banque juive américaine qui avait financé Lénine sont désopilantes (p. 103-111). Pour ce qui est des juifs qui vivent en France, « je les expédierais tous là-bas, moi, à Saint-Domingue, Caraïbes, ça serait un bon climat pour eux, ils verraient aux Îles ce que ça donne, le communisme entre cousins, puisqu’ils veulent plus de la Palestine » (p. 113).
« Gentille gaîté » française, c’est à elle qu’il aspire, « gaîté d’abord ! Gaîté c’est tout ! Je veux des chants et des danses » (p. 128). « Gaîté seulement nous sauvera, non point l’usine, ni plan de ceci, ni cela… », « Ah ! retrouvons notre gaîté ! où se cache-t-elle ? Dessous les sous ! Ah ! l’univers sera surpris lorsqu’il apprendra que Français partagent pécune », « Harpagon pendu ! », « Tant qu’on a pas ouvert Pognon, on a rien fait de sérieux […] » (p. 131-134). Et c’est ici que Céline présente avec allégresse et brio son programme dit « du communisme Labiche, du communisme petit bourgeois » : « Je décrète salaire national 100 francs par jour maximum » avec toutefois des aménagements selon qu’on se trouve être célibataire, marié, « père nombreux », etc. (p. 135-138). Et 35 heures de travail au maximum par semaine (p. 147). « Plus d’enfants, plus de France », « Sans enfants plus de gaîté » ; il faudra un code de la Famille avec le même traitement pour tous les enfants, pour « toute la famille bien française, le juif en l’air bien entendu, viré dans ses Palestines, au Diable, dans la Lune » (p. 149-153). Nous sommes au début de 1941 ; Céline entend baisser de ton dans ses attaques contre les juifs parce qu’ils sont sans doute toujours aussi nombreux mais « déchus » : « C’est pas mon genre l’hallali, j’ai pas beaucoup l’habitude d’agresser les faibles, les déchus, quand je veux me faire les poignes sur la [sic] Blum je le prends en pleine force, en plein triomphe populaire, de même pour les autres et Mandel. J’attends pas qu’ils soient en prison. […] C’est comme pour devenir pro-allemand, j’attends pas que la Commandantur pavoise au Crillon. […] C’est sous Dreyfus, Lecache, Kéril [Kérillis], qu’il fallait hurler “vive l’Allemagne” ! À présent c’est de la table d’hôte… » (p. 156). Toute la fin des Beaux draps est une merveille de beauté, de lyrisme, de cœur, de délicatesse, en particulier avec l’évocation de l’hiver, des pauvres gens qui meurent de froid, de la rencontre de son confrère, le Dr Divetot. Il y a en particulier ces quelques notes du « Lac des cygnes », entendues dans la bise, les notes précisément de « l’appel des Cygnes ». Tout cela « à grand vent » qui rugit « et qui passe !… » (p. 205-222).
Les juifs hors d’Europe : c’est à quoi aspiraient Céline et les Allemands
Quant au sort des juifs, ce que Céline appelle de ses vœux, c’est, on l’a vu, leur départ d’Europe. Le juif doit de lui-même « partir pour toujours », « foutre le camp », ou bien être « viré dans ses Palestines, au Diable, dans la Lune ». S’il n’avait dépendu que de lui, Céline aurait « expédié » tous les juifs aux « Caraïbes, ça serait un bon climat pour eux ». À l’époque de la publication de Bagatelles (1937) et de L’École (1938), les Allemands mènent, en collaboration avec les sionistes, une politique de transfert des juifs en Palestine (le Transfer Agreement, conclu dès août 1933 persistera jusque dans les premiers mois de la guerre !) ; les résultats de cette collaboration sont une réussite pour les deux parties ; mais deux obstacles vont se dresser contre ce peuplement juif de la Palestine : l’opposition des Palestiniens et celle de la Grande-Bretagne, puissance mandataire. En un second temps, les Allemands envisageront la possibilité d’un établissement des juifs dans l’île de Madagascar (Madagaskar Projekt) mais la guerre maritime finalement les obligera à en abandonner le projet. En proie aux nécessités autrement pressantes de la guerre, Hitler, dès le début de 1941, décide de repousser à l’après-guerre la recherche d’«une solution définitive» de la question juive. Un document, en date du 21 janvier 1941, rédigé par Karl-Theodor Zeitschel, directeur du Judenreferat à l’ambassade d’Allemagne à Paris, commence ainsi : « Office central des juifs à Paris. Conformément à la volonté du Führer, c’est après la guerre que la question juive dans la partie de l’Europe administrée ou contrôlée par l’Allemagne devra être conduite à une solution définitive » (Gemäß dem Willem des Führers soll nach dem Kriege die Judenfrage innerhalb des von Deutschland beherrschten oder kontrollierten Teiles Europas einer endgültigen Lösung zugeführt werden) (document du Centre de documentation juive de Paris – V, 59 ; pour une traduction approximative du document tout entier, voy. Maurice Rajsfus, Des Juifs dans la collaboration. L’U.G.I.F. 1941-1944, Études et Documentation Internationales, Paris 1980, p. 78-79). Par la suite, d’autres documents confirmeront ce report à l’après-guerre de ce qui sera « une solution finale territoriale de la question juive » (eine territoriale Endlösung der Judenfrage). Bien des spécialistes se garderont de citer ces documents ou les déformeront, en particulier par l’ablation de l’adjectif « territoriale ». L’envoi des juifs dans des camps soit de transit, soit de concentration, soit de travail ne constitueront qu’une solution provisoire en attendant la fin de la guerre. Contrairement à la légende d’origine juive américaine, les Allemands n’ont jamais eu de camps appelés « extermination camps » ou « Vernichtungslagern ». Jamais, à la très brève rencontre de Berlin-Wannsee, le 20 janvier 1942, il n’a été question de tuer les juifs ; il n’est que de voir ce que Yehuda Bauer, professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem, a fini par admettre sur « la sotte histoire de Wannsee » (the silly story of Wannsee) (communiqué de la Jewish Telegraphic Agency reproduit dans The Canadian Jewish News du 30 janvier 1992). En janvier 1944, le gouvernement du Reich répond au gouvernement britannique désireux d’envoyer des juifs – principalement des enfants – en Palestine : « Le Gouvernement du Reich ne peut se prêter à une manœuvre tendant à permettre aux Juifs de chasser le noble et vaillant peuple arabe de sa mère patrie, la Palestine. Ces pourparlers ne pourront se poursuivre qu’à la condition que le Gouvernement britannique se déclare prêt à héberger les juifs en Grande-Bretagne, et non en Palestine, et qu’il leur garantisse qu’il pourront s’y établir définitivement (Document de Nuremberg NG-1794, reproduit en français dans La Persécution des Juifs dans les pays de l’Est présentée à Nuremberg, par Henri Monneray, ancien substitut au Tribunal militaire international de Nuremberg, préface du général Telford Taylor, procureur général près les Tribunaux américains pour les crimes de guerre, introduction de René Cassin, vice-président du Conseil d’État, Éditions du Centre [de documentation juive contemporaine], Paris 1949, p. 169). Un an plus tard, le 18 janvier 1945, à propos de l’ensemble des juifs détenus par les Allemands, Heinrich Himmler écrira à Jean-Marie Musy, ancien président de la Confédération helvétique et partie prenante de la négociation : « Si l’Amérique veut les prendre, nous nous en féliciterons. Mais il doit être exclu, et là-dessus une garantie devra nous être donnée, que les Juifs que nous laisserons sortir par la Suisse puissent jamais être refoulés vers la Palestine. Nous savons que les Arabes, tout autant que nous, Allemands, le faisons, refusent les Juifs et nous ne voulons pas nous prêter à une indécence [Unanständigkeit] telle que d’envoyer de nouveaux Juifs à ce pauvre peuple [de Palestine] martyrisé par les Juifs [diesem armen, von der Juden gequälten Volke] » (Documents de l’US-Document-Center. Photographie du document dans Werner Maser, Nürnberg. Tribunal der Sieger, Droemer Knaur, Munich 1979, p. 262-263). Il convient de garder ces faits présents à l’esprit pour juger du sens et de la portée des écrits antijuifs de Céline. La manière dont on parle trop souvent de Bagatelles pour un massacre est équivoque. Toute personne conduite à traiter de cet ouvrage devrait, d’emblée, se faire un devoir d’en expliquer le titre et de répéter son explication : le massacre en question est celui des trop crédules Aryens se précipitant dans une croisade guerrière voulue par les juifs ; il ne s’agit nullement d’un massacre des juifs par les Aryens.
Un contresens sur « Vinaigre ! Luxez le juif au poteau ! »
De la même façon, dans Les Beaux Draps, il n’y a, n’en déplaise à certains, aucun appel au meurtre des juifs dans la phrase : « Vinaigre ! Luxez le juif au poteau ! » (p. 197) ; en réalité, ces mots signifient : « Vite ! Coiffez le juif au poteau ! », et ce poteau n’est pas celui d’une exécution mais le poteau d’arrivée d’une course : la course au communisme. Les castrateurs de Céline aiment à amputer ses textes ; ils lui en coupent tête et queue. Ici, l’introduction du texte en question (sa « tête ») donnait : « S.O.S. – Plus de tergiverse ! Plus d’équivoques ! – Le communisme Labiche ou la mort ! Voilà comme je cause ! Et pas dans vingt ans, mais tout de suite ! Si on en arrange pas un nous, un communisme à notre manière, qui convienne à nos genres d’esprit, les juifs nous imposeront le leur […] ». Puis, après les mots « Vinaigre ! Luxez le juif au poteau ! », la fin du passage (sa « queue ») était la suivante : « y a plus une seconde à perdre ! C’est pour ainsi dire couru ! ça serait un miracle qu’on le coiffe ! une demi-tête !… un oiseau !… un poil !… un soupir !… » (Les Beaux Draps, p. 197-198). Quant au mot de « luxer » au sens de « devancer » ou de « remplacer », il appartient surtout au langage des carabins ; voyez ce que personnellement j’en ai dit d’abord dans les Actes du colloque international [Céline] de Paris (27-30 juillet 1976), Société d’études céliniennes, 1978, p. 181-182[3], puis dans « Retour sur le mot de “luxer” dans le vocabulaire de Céline », Le Bulletin célinien, juillet-août 1997, p. 5-6.[4] Pour Céline, en France, le « communisme Labiche » doit, au plus tôt, devancer l’installation d’un sinistre judéo-communisme comme celui qui règne en Russie et qui fait soit le bonheur du Docteur Touvabienovi[t]ch (« le brouillard à l’eau d’avenir [et, pour le présent,] une sorte d’immense insistance dans le navrant, la désolation »), soit les délices de Maurice Thorez, « le bébé-führer » qui, comme l’avait prédit Céline, a déserté l’armée française en temps de guerre pour aller avec femme et enfants goûter aux délices de Moscou (Bagatelles, p. 117-119 ou 302, 313).
Un antisémitisme au sens traditionnel du mot
L’antisémitisme de Céline est traditionnel et s’explique par une raison que, dès 1894, Bernard Lazare, « le premier des dreyfusards », a clairement expliquée dans les premières pages de son livre sur L’Antisémitisme, son histoire et ses causes. La préface est datée de « Paris, 25 avril 1894 ». Un mois plus tard, le 27 mai 1894, naîtra près de Paris, à Courbevoie, Louis, Ferdinand, Auguste Destouches (« Je suis né en mai, c’est moi le printemps », Mort à crédit). Entreprenant « l’histoire d’Israël depuis sa dispersion ou, pour mieux dire, depuis les temps de son expansion hors du territoire de la Palestine », B. Lazare donc, le défenseur du capitaine Dreyfus, écrit dans sa préface :
Il m’a semblé qu’une opinion aussi universelle que l’antisémitisme, ayant fleuri dans tous les lieux et dans tous les temps, avant l’ère chrétienne et après, à Alexandrie, à Rome et à Antioche, en Arabie et en Perse, dans l’Europe du Moyen Âge et dans l’Europe moderne, en un mot, dans toutes les parties du monde où il y a eu et où il y a des Juifs, il m’a semblé qu’une telle opinion ne pouvait être le résultat d’une fantaisie et d’un caprice perpétuel, et qu’il devait y avoir à son éclosion et à sa permanence des raisons profondes et sérieuses.
Au début du chapitre premier intitulé « Les causes générales de l’antisémitisme », il ajoute :
Si cette hostilité, cette répugnance même, ne s’étaient exercées vis-à-vis de Juifs qu’en un temps et en un pays, il serait facile de démêler les causes restreintes de ces colères ; mais cette race a été, au contraire, en butte à la haine de tous les peuples au milieu desquels elle s’est établie. Il faut donc, puisque les ennemis des Juifs appartenaient aux races les plus diverses, qu’ils vivaient dans des contrées fort éloignées les unes des autres, qu’ils étaient régis par des lois différentes, gouvernés par des principes opposés, qu’ils n’avaient ni les mêmes mœurs, ni les mêmes coutumes, qu’ils étaient animés d’esprits dissemblables ne leur permettant de juger également de toutes choses, il faut donc que les causes générales de l’antisémitisme aient toujours résidé en Israël même et non chez ceux qui le combattirent. – Ceci n’est pas pour affirmer que les persécuteurs des Israélites eurent toujours le droit de leur côté, ni qu’ils ne se livrèrent pas à tous les excès que comportent les haines vives mais pour poser en principe que les Juifs causèrent – en partie du moins – leurs maux. […] partout et jusqu’à nos jours, le Juif fut un être insociable. […] [Dans l’Antiquité] partout où les Juifs établirent des colonies, partout où ils furent transportés, ils demandèrent non seulement qu’on leur permît de pratiquer leur religion, mais encore qu’on ne les assujettît pas aux coutumes des peuples au milieu desquels ils étaient appelés à vivre, et qu’on les laissât se gouverner par leurs propres lois. […] Partout ils voulaient rester Juifs, et partout ils obtenaient des privilèges leur permettant de fonder un État dans l’État. À la faveur de ces privilèges, de ces exemptions, de ces décharges d’impôts, ils se trouvaient rapidement dans une situation meilleure que les citoyens mêmes des villes dans lesquelles ils vivaient ; ils avaient plus de facilité à trafiquer et à s’enrichir, et ainsi excitèrent-ils des jalousies et des haines. – Donc, l’attachement d’Israël à sa loi fut une des causes premières de sa réprobation, soit qu’il recueillît de cette loi même des bénéfices et des avantages susceptibles de provoquer l’envie, soit qu’il se targuât de l’excellence de sa Thorah pour se considérer comme au-dessus et en dehors des autres peuples.
Céline n’a jamais rien dit d’autre sur cet orgueil, ces « privilèges », cet « État dans l’État » et sur ce que, pour sa part, il a appelé « le racisme juif ». Simplement, en 1937-1938, soit près d’un demi-siècle après les observations de B. Lazare, il a estimé que le pouvoir des juifs en France s’était encore accru au point, par exemple, qu’à la faveur du Front populaire, pour la première fois de son histoire, avec Léon Blum, le gouvernement de la France était dirigé par un juif entouré de juifs. D’où sa remarque : « Le capitaine Dreyfus est bien plus grand que le capitaine Bonaparte. Il a conquis la France et il l’a gardée » (Bagatelles, p. 329). Précisons que, contrairement à ce qui se colporte sur B. Lazare, ce dernier n’a jamais renié son explication de l’antisémitisme, y compris dans son opuscule Contre l’antisémitisme (histoire d’une polémique), Stock, Paris 1896, ou dans son testament olographe du 9 septembre 1903 où, neuf ans après son premier ouvrage, il dit, sans autres précisions, que « sur beaucoup de points » son « opinion [s’est] modifiée ».
L’anti-croisade de Céline : une œuvre de salut public
Il est vrai que Céline s’est exprimé avec une verve, un talent, une force, une conviction, une indignation et une drôlerie qu’on ne trouve guère avant lui que chez Rabelais, son confrère ou son frère à la fois en médecine et en littérature. Faut-il ici rappeler les pages où Rabelais s’en prenait au bellicisme de Picrochole (« Verrons-nous Babylone et le mont Sinaï ? »), aux puissants, aux riches et aux privilégiés de son temps, aux Papefigues et aux Papimanes, à Antiphysie, aux lâches et aux brenneux ? Ce qu’on a justement dit de Rabelais, on pourrait souvent l’appliquer à Céline, son compatriote de Meudon : il joint « l’esprit » au « charme de la canaille » (La Bruyère) « Et son éclat de rire énorme / Est un des gouffres de l’esprit » (Hugo). Louis-Ferdinand va loin dans l’indignation mais, Juvénal l’avait noté dans sa première satire : « À défaut de génie, c’est l’indignation qui fait [surgir] le vers » (Si natura negat, facit indignatio versum) ; cette sentence, si magistralement frappée, signifie que, si votre nature ne vous a pas accordé le don de poésie, l’indignation, elle, pourra éventuellement susciter votre verve et vous inspirer un langage digne du poète. C’est le même Juvénal qui, indigné par certaines turpitudes, ajoutait : « Quand on voit de telles iniquités, il est difficile de ne pas écrire de satire » (difficile est saturam non scribere). Sous le coup de l’indignation ou, comme on dit, « saisi d’indignation », il peut arriver au premier venu de se découvrir soudain une éloquence qu’on ne lui connaissait pas ; il se met alors à exagérer, à inventer, à mentir, à créer des images ou des tours de phrase inattendus ; tel le poète, il « créera », et cela à tel point, d’ailleurs, qu’à l’occasion, plus tard, il estimera peut-être que « ses paroles ont dépassé sa pensée ». Céline, lui, n’est pas le premier venu et même, bien que s’exprimant en prose, il est né poète ; il est un incomparable créateur de mots ; il a un sens inné du rythme ; il est « flûtant » et « dansant » ; il a « l’exquisité d’écoute » d’un musicien et l’œil du médecin ; il a le sens du dessin, du croquis, de la caricature. Imagine-t-on alors ce que l’indignation va dicter à ce poète comblé de dons ? L’amadou ne demande plus qu’à s’enflammer. La loi du genre satirique le poussera à se montrer dans ses jugements encore plus expéditif que de nature et blessant dans ses traits d’esprit. Son indignation était noble ; l’auteur de Bagatelles et de L’École était animé du désir d’alerter ses frères humains contre l’imminence de ce qui, dans les faits, allait se révéler la plus abominable catastrophe de toute l’histoire des hommes. En prônant son Anti-Croisade Céline faisait œuvre de salut public. En 1937-1939, il aurait fallu distribuer ses écrits, en expliquer le sens et la portée, à tout le monde, y compris aux juifs de France qui, s’ils l’avaient écouté, se seraient épargné, eux aussi, certaines réelles tragédies de la guerre. Le 19 juillet 1957, dans une lettre à Roger Nimier, il écrivait : « Les juifs et leurs jérémiades m’emm… s’ils n’avaient pas fait déclarer la guerre par la France, ils n’auraient jamais connu Buchenwald et le reste… il leur suffisait de prendre au sérieux mes conseils et Bagatelles… leurs larbins goïes pleurent » (Lettres à la NRF, Gallimard, Paris 1991, p. 373). Aujourd’hui, en 2011, les juifs israéliens et les néo-cons d’Amérique seraient bien inspirés de se faire traduire quelques morceaux choisis de Bernard Lazare ou des satires de Céline. Ils les méditeraient à Tel-Aviv ou à Jérusalem, à New York ou à Washington, et peut-être songeraient-ils moins alors à prôner de nouvelles expéditions punitives contre l’Iran, l’Irak, la Cisjordanie ou Gaza au mépris des avertissements que leur lance parfois, timidement, le reste du monde mais que, dans leur orgueil et leur sentiment de supériorité, ils refusent d’entendre.
« Les juifs sont comme tout le monde ! » objectent les bonnes âmes. La formule n’a pas grand sens. Aucun individu, aucun groupe n’est « comme tout le monde » ; jamais chacun n’est comme tous les autres. Tout groupe, tout individu a son histoire, son passé et donc son caractère. À chacun d’y réfléchir et d’agir en conséquence.
Un révisionnisme de bon aloi
L’antisémitisme est réprimé par la loi. On peut tout dire contre les Allemands mais on ne peut rien dire contre les juifs. Pourquoi ? Personne ne répond à cette question. De nos jours, dans les salons et ailleurs, le qualificatif d’ « antisémite » peut ruiner la carrière et la vie d’un honnête homme. Pourquoi là encore ? Mais il y a pis. Le qualificatif de « révisionniste » ou, pour user d’un barbarisme, celui de « négationniste » est plus redoutable encore. Là, point de quartier ni de pardon. Dans une bonne partie du monde occidental, des lois spécifiques, calquées sur une loi israélienne de 1986, font obligation aux magistrats de sévir. En ce moment même, en France, Vincent Reynouard, âgé de 42 ans et père de huit enfants, est en prison. Professeur de mathématiques d’abord chassé de l’enseignement secondaire pour révisionnisme, puis réduit au chômage, il purge actuellement dans la maison d’arrêt de Valenciennes une peine d’un an de prison ferme (peine assortie de sanctions financières dont le montant s’élève à près de 70 000 €) ; son crime est d’avoir expédié à quelques personnes une remarquable brochure de 16 petites pages intitulée Holocauste ? Ce que l’on vous cache… (Bruxelles, 2005). Il y explique, à propos des « chambres à gaz nazies », que celles-ci n’ont pas existé ni même pu exister, et cela pour des raisons essentiellement physiques et chimiques. Pendant des années il avait résidé à Bruxelles avec son épouse et ses enfants dans des conditions précaires. À la demande des autorités françaises, il a été arrêté le 9 juillet 2010, mis en prison et ultérieurement livré à la France. Détenu à Valenciennes depuis près de six mois, il a demandé à bénéficier du port du bracelet électronique afin de pouvoir regagner son domicile et d’y retrouver femme et enfants. Le juge d’application des peines lui a refusé ce droit parce que le prisonnier, à la conduite pourtant exemplaire, n’avait manifesté aucun repentir et qu’une récidive était à craindre. Mais là ne s’arrête pas l’affaire. Le comble est à venir et le voici : pas un organe de la grande presse écrite, pas une station de radio ou de télévision, pas une association de défense des libertés publiques n’ont laissé filtrer la nouvelle malgré le flot de courrier qui leur a été envoyé sur le sujet et malgré une pétition lancée par l’historien Paul-Éric Blanrue en août 2010, pétition qui a notamment reçu l’approbation de Noam Chomsky. Autrement dit : « Silence ! La France jette en prison un père de huit enfants pour ses écrits ! Silence encore une fois. » Peu de pays peuvent se comparer à la France pour ce qui est des discours en faveur de la liberté d’opinion, de la liberté de recherche et de la liberté d’informer mais, dès que le tabou de la Shoah est enfreint, on y foule aux pieds ses plus chers principes. Selon la formule d’[Annie Kriegel] il existe en France « une insupportable police juive de la pensée ». Pourquoi ? De quel droit ?
« LA MAGIQUE CHAMBRE A GAZ » OU « C’ETAIT TOUT LA CHAMBRE A GAZ !
ÇA PERMETTAIT TOUT ! »
Ce que les juifs, à vrai dire, ne sauraient pardonner à Céline, c’est son révisionnisme. Au sujet de Paul Rassinier qui venait d’éditer Le Mensonge d’Ulysse (1950) il confiait à Albert Paraz : « Son livre, admirable, va faire du bruit – QUAND MÊME il tend à faire douter de la magique chambre à gaz ! ce n’est pas peu ! Tout un monde de haine va être forcé de glapir à l’iconoclaste ! C’était tout la chambre à gaz ! Ça permettait TOUT ! Il faut que le diable trouve autre chose… Oh je suis bien tranquille ! ». La lettre datait du 28 novembre 1950. Elle ne figure pas parmi les Lettres de Céline publiées en 2009 dans la Bibliothèque de la Pléiade (préface d’Henri Godard, édition établie par Henri Godard et Jean-Paul Louis, NRF, Gallimard). Peut-on nous dire exactement pourquoi ? Pour plus de renseignement sur cette lettre et sur le révisionnisme de son auteur, je me permets de renvoyer à ce que j’en ai écrit dans deux articles respectivement intitulés Céline devant le mensonge du siècle[5] et Céline devant le mensonge du siècle (suite).[6]
Personnellement, pour avoir fait le tour de la question posée par cette « arme de destruction massive » qu’aurait été la chambre à gaz nazie, je dois convenir que je ne saurais lui trouver de qualificatif plus approprié que celui de « magique ». Elle est magique en ce qu’on n’en trouve nulle trace, nulle preuve de son existence et de son fonctionnement et qu’elle est radicalement impossible pour des raisons d’ordre physique, chimique, architectural, documentaire ; elle a autant de témoins que les soucoupes volantes, des témoins qui, au surplus, sont tous des « miraculés ». Elle a sa religion, ses reliques, son commerce, sa littérature fantastique. Elle permet de fabuleuses « réparations », « indemnisations », « compensations » ainsi que de multiples arnaques, chantages et escroqueries en tout genre. Elle est la base, elle est le socle sur lequel reposent les pieds d’argile de l’un des plus colossaux mensonges de tous les temps. On n’imagine pas tour de magie plus stupéfiant.
Céline revient à la vie
Imaginons un instant que Céline, mort il y a cinquante ans, revienne aujourd’hui à la vie. Il me semble qu’au spectacle du temps présent il éprouverait plus d’un motif de satisfaction personnelle : il constaterait que, sur le plan littéraire, sa réputation est au zénith et que, sur le plan plus particulier de ses satires, sa clairvoyance a été si grande qu’en 2011 encore on persiste à le censurer tant les vues qu’il y exprimait gardent encore de leur pouvoir. Il apprendrait que, Maître Klarsfeld ayant parlé, le gouvernement français n’a plus eu qu’à s’exécuter : la mémoire de Céline doit tomber dans les oubliettes de la République française ; de toute façon, il est de facto interdit en France d’apposer la moindre plaque sur les lieux où a vécu Louis-Ferdinand Destouches. Sans surprise, Céline constaterait que, dans le monde occidental, le pouvoir des juifs n’a jamais été aussi grand. En 1998 Alain Finkielkraut s’écriait :
Ah, qu’il est doux d’être juif en cette fin de xxe siècle ! Nous ne sommes plus les accusés de l’Histoire, nous en sommes les chouchous. L’esprit du monde nous aime, nous honore, nous défend, prend en charge nos intérêts ; il a même besoin de notre imprimatur. Les journalistes dressent des réquisitoires sans merci contre tout ce que l’Europe compte encore de collaborateurs ou de nostalgiques de la période nazie. Les Églises se repentent, les États font pénitence, la Suisse ne sait plus où se mettre […] (« Mgr Stepinac et les deux douleurs de l’Europe », Le Monde, 7 octobre 1998, p. 14).
Et si parfois en France d’autres minorités en veulent aux juifs, c’est parce que ces derniers sont à leurs yeux les « chouchous de la mémoire[7] ». Pour sa part, Yvan Levaï, constatant que la presse, l’édition et la radiotélévision multiplient à l’envi documents et témoignages en rapport avec le 60e anniversaire de la fondation de l’État d’Israël, pouvait écrire : « C’est dire si cette année le fond de l’air est juif. Et tant pis si négationnistes et antisémites de tout poil enragent de ce climat, nous nous en réjouissons » (Tribune juive, [date ?] mai 2008). En 1995, Jacques Chirac, alors tout nouveau président de la République, déclarait que, durant l’Occupation, la France avait « commis l’irréparable » à l’égard des juifs. Les organisations juives, non sans un beau sang-froid, en avaient conclu : « Il faudra donc réparer (financièrement) ! » Usant de tout leur poids, elles ont vite obtenu de nouvelles « réparations » financières. Les flots d’argent ainsi acquis ne tarissent pas. Sans cesse, des pays, des institutions ou des firmes se voient réclamer encore plus de « réparations », « restitutions », « compensations », « indemnisations » par des organismes juifs dotés des moyens nécessaires pour faire plier les récalcitrants. Le sérieux des banquiers suisses est réputé : lorsque le Congrès juif mondial et son président, le milliardaire Edgar Bronfman, leur ont réclamé 1 250 000 000 $, ils ont sollicité des explications sur le mode de calcul d’une pareille somme. On leur a fait comprendre qu’ils ne recevraient pas vraiment d’explications. Ils n’ont pas insisté ; ils ont payé. En France, la SNCF s’est trouvée mise en accusation pour avoir transporté des juifs dans le cadre de leur déportation il y a près de soixante-dix ans. Elle devait, à son tour, payer. Les juifs américains faisaient alors comprendre que, faute d’obtempérer, les soumissionnements de la SNCF pour la création aux États-Unis de réseaux ferroviaires à grande vitesse, notamment en Floride et en Californie, ne seraient pas pris en considération. Guillaume Pépy, responsable de la SNCF, a vite cédé. Il est d’abord allé se recueillir à Auschwitz. Puis, le 25 janvier 2011, il s’est rendu à Bobigny, point de départ pendant la guerre des convois de déportés juifs, où il a déclaré : « La SNCF fut un rouage de la machine nazie d’extermination. » Il s’est mis en rapport avec le baron Éric de Rothschild, l’une des plus grosses fortunes de France et propriétaire de plusieurs grands crus classés, dont le château Lafite Rothschild, et président du Mémorial de la Shoah, avec lequel il a signé un accord qui prévoit le financement par la SNCF de projets pédagogiques pour enseigner « la Mémoire ». En foi de quoi, aujourd’hui, toute personne acquittant le prix d’un trajet assuré par la SNCF se trouve, sans le savoir, verser automatiquement son écot à un baron milliardaire qui l’emploiera au bénéfice de la Mémoire juive. Le lendemain, 26 janvier, G. Pépy a signé avec Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, une convention permettant à la SNCF de financer un projet, particulièrement ambitieux et coûteux, d’enseignement de la Shoah à tous les élèves de France et à tous les niveaux ; seront également financés des voyages accompagnés qui permettront à un nombre important d’élèves de se rendre à Auschwitz pour s’y recueillir et pour mieux approfondir la Mémoire. Un peu plus tard, les Français apprenaient que deux de leurs plus importants quotidiens, Le Monde et Libération à l’exemple du Figaro tombaient définitivement dans l’escarcelle de personnalités et de groupes juifs. L’actuel président de la République [Nicolas Sarkozy] est d’ascendance juive. Une insupportable police juive de la pensée + Washington + la Palestine…………………..
Notes (brouillon) pour la rédaction de la suite : de quel droit les censeurs nous privent-ils de tant de beautés céliniennes ?
Revenons à Bagatelles. Laissons pour un instant de côté son inspiration pacifiste, raciste et antijuive. Attardons-nous aux autres aspects de l’ouvrage. Ils sont si riches, si divers, si importants pour qui veut juger de leur auteur et de son art que leur censure n’en paraît que plus indéfendable. Plaçons les censeurs et les épurateurs face à leurs responsabilités et demandons-leur de quel droit ils privent leurs frères humains du droit d’accéder à de telles pages.
Une satire est composite. En latin, le mot de satura désigne d’abord un mélange de légumes ou un mélange de viandes, puis, au sens figuré, des mélanges littéraires où les contrastes ont leur place.
Le plus étonnant de ces contrastes veut qu’une œuvre qui porte essentiellement sur la menace de la guerre s’ouvre et se ferme sur des arguments de ballet. Au début de Bagatelles, « Naissance d’une fée » occupe dix pages (p. 17-26) et « Voyou Paul, brave Virginie » douze pages (p. 30-41) tandis qu’à la fin les cinq pages de « Van Bagaden » constituent la 97e et dernière section du livre (p. 375-379). Cet ensemble de vingt-sept pages présente un aspect idyllique, rafraîchissant, presque ingénu, fait de poésie rêveuse et d’inventions malicieuses. Par moments, on dirait d’une bluette. La danse et la musique y ont leur part d’enchantement.
L’évocation de la Russie occupe, elle, une cinquantaine de pages. Elle se fait principalement au début (p. 46-47), vers le milieu (p. 116-123) et, surtout, à la fin du livre (p. 332-374). L’interprète russe de Céline s’appelle Nathalie. Bien des fragments lui sont consacrés. Il est regrettable que, dans leur galerie des créatures féminines qui peuplent l’œuvre de Céline, tant d’auteurs l’omettent : « une très jolie blonde par ma foi, ardente, toute vibrante de Communisme, prosélytique à vous buter, dans les cas d’urgence… Tout à fait sérieuse d’ailleurs… allez pas penser des choses !… et surveillée ! nom de Dieu !… ». (+ nombreuses citations).
Pour l’instant, Céline ne se berce pas d’illusions sur le régime : « Je créchais à l’Hôtel de l’Europe, deuxième ordre, cafards, scolopendres à tous les étages… […] La misère russe que j’ai bien vue, elle est pas imaginable, asiatique, dostoïevskienne, un enfer moisi, concombres et délation… » (p. 46). Un personnage survient, qui est de dimension rabelaisienne ou shakespearienne : Borokrom.
Mais voilà que Céline découvre le théâtre Marinski en compagnie de Nathalie, sa « guide-policière », « une très jolie blonde par ma foi, ardente, toute vibrante de Communisme » (p. 46-47), [mais si vibrante qu’ « il lui passait des éclairs à travers les “iris” pervenche… qu’étaient des couperets » (p. 362)]. Le théâtre suscite l’enthousiasme du Français : « Dans le genre mammouth… la perfection… léger… on ne peut mieux… du mammouth léger… décoré tout de bleu ciel, pastel filé d’argent… Autant de balcons, autant de cernes, franges d’azur… en corbeilles… Le lustre, une nébuleuse d’étoiles… une pluie suspendue… cristallin… toute scintillante… Tout le parterre, tous les rangs en citronnier. Résilles de branchages aux tons passés… bois tournés, velours sur pastel… un éparpillement de palette… une poésie dans les sièges !… Le miracle même !… » (p. 342-343). Un peu plus loin, il écrit : « Je vous parle du “Marinski” avec un tel enthousiasme… Je vous vois venir… toujours suspicieux… j’avoue ! Minute !… Avec Nathalie, nous fûmes de toutes les soirées… Nous avons tout admiré, tout le répertoire… et la “Dame de Pique”… six fois… » (p. 344). Plus loin encore : « Ballet veut dire féerie [à prononcer férie !]. Voici le genre le plus ardent, le plus généreux, le plus humain de tous ! » et, ajoute-t-il, malheureusement la desséchante Raison l’emporte là aussi et l’âme y perd : « L’âme décline et se lasse » (p. 347). Céline présente au directeur du Marinski et à un groupe d’une trentaine de personnes son argument de « La Naissance d’une fée » mais ce qu’on lui demande c’est du « sozial ». C’est promis, il fera du « sozial ». Le voici en proie à une frénésie de communisme moscoutaire. Suit un passage étourdissant et digne de figurer dans une anthologie de prose française. Il se situe aux pages 352-354. Les premiers mots sont : « Dine ! Paradine ! Crèvent ! Boursouflent ! Ventre dieu ! 487 millions ! d’empalafiés cosacologues ! Quid ? Quid ? Quod ? Dans tous les chancres de Slavie ! Quid ? de Baltique slavigote en Blanche Altramer noire ? Quam ? Balkans ! » Pauvres surréalistes, malheureux traîne-patins qui s’imaginaient renouveler la langue et le monde : ils trouvent ici leur maître qui, ailleurs (p. 170), s’est moqué d’eux en les pastichant. Toujours à Leningrad, l’épisode de l’exquise vieille pianiste tombée en disgrâce et prête au suicide est bouleversant. Céline est pianiste et il a eu pour compagne pendant des années une virtuose du piano : « Elle gagnait sa vie sur Chopin et sur Haydn … vous dire que je connais les œuvres… et sensible à la qualité… » (p. 358). Il a surpris la vieille femme en train de jouer du Haydn. Il la connaît déjà bien ; elle a vécu vingt ans à l’étranger et s’exprime en un français délicieux. Elle se croyait seule dans le sordide immeuble. Prise sur le fait et sensible aux compliments de « monsieur Céline », elle s’ouvre à lui de son désespoir et aussi de son désir d’attenter à ses jours. « Ah ! Je ne fis qu’un bond !… sur ces mots… quel sursaut !… – Holà ! Madame ! voici le véritable blasphème ! … Comment ! Grande honte et remords ! Ah ! Je ne vous écoute plus !… Un tel projet ! aussi sauvage ! insensé ! sinistre !… Vous capitulez Madame ?… devant quelques arrogances de minces bureaucrates imbéciles… » Suit sur le compte de ces bureaucrates une bordée de qualificatifs injurieux ou désobligeants, tous accompagnés d’atténuations dont l’effet comique est irrésistible et cela jusqu’à une chute encore plus cocasse : « Tous ces gens du bolchévisme, dans l’ensemble, je vous l’accorde, ne sont pas très aimables… Ils sont peut-être un peu cruels… un peu grossiers… un peu sournois… un peu sadiques… un peu fainéants… un peu ivrognes… un peu voleurs… un peu lâches… un peu menteurs… un peu crasseux… je vous l’accorde… C’est à se demander par quel bout il vaudrait mieux les pendre ?… Mais le fond n’est pas mauvais !… dès que vous réfléchissez !… – La grand’mère, comme tous les Russes, c’était sa passion de réfléchir. Nous avons réfléchi ensemble… passionnément… » (p. 359).
La capacité d’enthousiasme
« La seule chose grave à l’heure actuelle, pour un grand homme, savant, écrivain, cinéaste, financier, industriel politicien (mais alors la chose gravissime) c’est de se mettre mal avec les Juifs […] Mais ne touchez pas à la question juive, ou bien il va vous en cuire… » (Bagatelles, p. 49) + « « Juifs en tant que secte, race, Juifs racistes (ils le sont tous) » (p. 50) + « on lui crève l’âme comme on crève les yeux aux pigeons » (p. 59).
2) Les juifs devant deux épreuves à venir : a) la contestation croissante de « l’Holocauste » surtout depuis que le dernier des Mohicans juifs a reconnu, le 27 décembre 2009, qu’il n’y avait pas de preuves physiques à Auschwitz (pourtant visité par des millions de pèlerins convaincus du contraire) de l’existence et du fonctionnement des « chambres à gaz » ; b) la disparition de l’État d’Israël.
3) Le caractère prophétique de ces écrits apparaîtra de plus en plus clairement et rendra de plus en plus absurde leur censure de fait.
1) B. Lazare et Céline reviennent à la vie pour y constater qu’ils avaient cent fois raison : l’omnipotence juive en France : ses satires restent interdites de facto. Klarsfeld a parlé, le ministre a obtempéré. La loi Fabius-Gayssot. La Shoah en priorité : business, industrie, religion. L’enseignement, la presse. Le colloque Céline des 4-5 février 2011. Nos dirigeants convoqués une fois par an au dîner du CRIF. La SNCF, les banques (suisses en particulier) Les procès à grand spectacle. On écume les mouroirs. Les chouchous de l’Histoire et de la Mémoire.
4) La bonté de Céline, trait commun aux satiristes : ils ne sont pas méchants. Sa géniale ingénuité. L’enfant chez lui. Le médecin secourable dans Nord. L’hymne aux infirmières.
5) Le 15 mars 2011 00:16, « pebla » a écrit :
« L’interprète russe de Céline s’appelle Nathalie. Bien des fragments lui sont consacrés. »
=> comme dans la chanson du célinien Pierre Delanoë, chantée par Gilbert Bécaud :
La place Rouge était vide
Devant moi marchait Nathalie
Il avait un joli nom, mon guide
Nathalie
6) Déflagration provoquée par mon affaire en 1978-1979
7) Pour un Palestinien comme pour un révisionniste traité en Palestinien, l’effet produit par la lecture des satires est le suivant : stupéfaction devant la justesse du dessin ou de la caricature, admiration devant l’héroïsme de l’auteur, enthousiasme, libération par le rire, soulagement : somme toute un phénomène de catharsis, d’exorcisme des effets pathogènes. Quand on sort de la lecture d’Aristophane, on ne va ni tuer ni insulter le fourbe ou le sycophante ; on est soulagé ; on est purgé, on respire. On est désarmé. Pour un peu, on donnerait l’accolade au persécuteur, ce qui serait indigne. Le rire n’arme pas ; il désarme.
8) Pourquoi, diable, Céline aurait-il dû, à la fin de sa vie présenter ses excuses, notamment pour ses propos contre les juifs ? Il avait raison de dire que c’était à lui d’attendre des excuses. Dans son extrême bonté, il a fait bénéficier de son exceptionnelle clairvoyance tous ses frères humains à commencer par ses compatriotes et tous les Européens en général. Il les a mis en garde contre le bellicisme juif, contre les appels à la guerre et à la croisade, contre les mensonges de la propagande de guerre. Il n’a pas été écouté. Tous les malheurs qu’il prédisait se sont réalisés à commencer par la défaite d’une France que la première guerre mondiale avait rendue exsangue. Il avait prédit des morts par dizaines de millions et le suicide de l’Europe, les conquêtes de Staline en Europe. Il aurait fallu l’écouter. Par ailleurs, après la guerre, il s’est rendu compte à la lecture de Paul Rassinier que les juifs nous abusaient gravement avec leur gigantesque fraude de leur prétendue extermination. Là aussi il faisait preuve d’une exceptionnelle clairvoyance. Là aussi il conviendrait de le remercier au lieu de l’accuser et d’attendre ses excuses. Voyez la naïveté de Jacqueline Morand et de bien d’autres.
Note du vendredi 15 juin 2018
________________________________________________________________
[1] Voy. Les satires, et non les pamphlets, de Céline dans Le Bulletin célinien de janvier 2001, no 216, p. 18 et 19, signé Jessie Aitken ; reproduit in Écrits révisionnistes (1999-2004), tome V, p. 209-211.
[2] Voy. En Confidence. Entretien [de Robert Faurisson] avec l’Inconnue [Maria Poumier], Pierre Marteau, Milan, 2009, p. 27-29.
[3] Écrits révisionnistes (1974-1998), tome I, p. 128.
[4] Écrits révisionnistes (1999-2004), tome V, p. 59-60.
[5] Bulletin célinien, n° 3, 3e trimestre 1982, p. 4-8 ; reproduit in Écrits révisionnistes (1974-1998), tome I, p. 315-322.
[6] Bulletin célinien, n° 4, 4e trimestre 1982, p. 5-6 ; reproduit in Écrits révisionnistes (1974-1998), tome I, p. 322-324.
[7] Le même : Mémoire à l’école : les deux « non » d’Alain Finkielkraut, interview avec Elisabeth Lévy, Causeur, 18 février 2008.