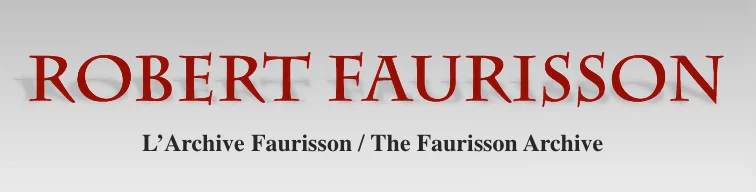Un aspect inattendu de Guy de Girard de Charbonnières
En 1985 Guy de Girard de Charbonnières a publié un livre dont le titre est emprunté d’un mot de Winston Churchill sur la Seconde guerre mondiale : La plus évitable de toutes les guerres (Éditions Albatros, Paris, 271 p.). Dans le Bulletin célinien n° 296 (avril 2008), Charles-Antoine Cardot a publié une remarquable étude sur le personnage de Charbonnières et il a été conduit à citer de larges et intéressants extraits de ce livre, dont le sous-titre est : Un témoin raconte. Personnellement, si j’avais à signaler un extrait de cet ouvrage aux céliniens, ce serait l’étrange chapitre XIV. En dix pages, l’auteur y raconte un voyage qu’il a fait avec un ami, en voiture, à travers l’Allemagne, à l’été de 1939, c’est-à-dire juste avant l’éclatement du conflit. Rarement ai-je lu un témoignage empreint de plus de compréhension et de plus de sympathie pour le peuple allemand, y compris lorsque la foule allemande à Munich, loin de toute « hystérie collective » et « sans aucune démence », manifeste une « prodigieuse ferveur » à l’endroit de son Guide (p. 198). Charbonnières était certes en faveur d’une politique de fermeté à l’égard d’Adolf Hitler mais il jugeait insensée la perspective d’une guerre entre Allemands et Français : « En quoi étions-nous des ennemis ? Je repartis [d’Allemagne] en me disant à la fois que la guerre était certaine et qu’elle était impossible » (p. 203). Au fond, à cette époque, Céline et son futur Torquemada n’étaient peut-être pas si loin de partager, sur l’essentiel, les mêmes convictions : tous deux, la mort dans l’âme, jugeaient la nouvelle guerre franco-allemande à la fois inéluctable et absurde. D’autres en ont jugé autrement.
Note du 16 décembre 2008
Pour en obtenir la parution dans Le Bulletin célinien n° 303 (décembre 2008), p. 8, j’ai dû signer ce bref article d’un nom de plume, qui se trouve être le nom de ma mère.
C’est à l’héroïque Vincent Reynouard, et à nul autre, que je dois d’avoir lu La plus évitable de toutes les guerres. Non sans raison, il qualifie ce témoignage de «capital». Il en cite de larges extraits dans ses « Réponses à un “antinazi” » (Sans Concession, septembre-décembre 2008, p. 135-137).

Vers la fin de la guerre Louis-Ferdinand Céline, avec sa femme et leur chat Bébert, a d’abord cru trouver refuge à Copenhague, mais, au Danemark comme partout ailleurs en Europe, allait se déclencher une chasse aux vaincus qui dure encore aujourd’hui, soixante-trois ans après la fin de la guerre (voyez, entre autres, la nouvelle affaire Demjanjuk). Pour leur courte honte, les autorités danoises ont arrêté Céline et, dix-huit mois durant, l’ont détenu en prison (cellule et hôpital) dans de terribles conditions. Mais, pour leur honneur, elles n’ont pas déféré à la demande d’extradition reçue des autorités françaises. Guy de Girard de Charbonnières du Rozet (1907-1990), ministre de France au Danemark, a déployé une considérable activité en vue d’obtenir cette extradition, mais il a fini par échouer dans son entreprise qui, en cas de succès, aurait peut-être abouti pour Céline à une sentence de mort. À l’époque, en France, les « Comités de libération (sic) » faisaient la loi au sein des « Cours de justice (sic) ». Communistes et gaullistes y communiaient dans des mascarades judiciaires qui leur permettaient de prononcer à la chaîne, en particulier contre les écrivains, les condamnations les plus lourdes et les plus expéditives.