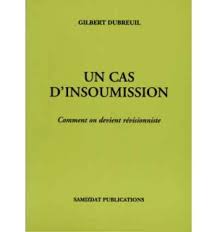Préface d’Un Cas d’insoumission (Georges Theil)
Le révisionnisme historique a été la grande aventure intellectuelle de la fin du XXe siècle. À l’aube du XXIe siècle, l’aventure se poursuit, tout aussi périlleuse.
Mais que sait-on des révisionnistes ? De quelle étoffe sont-ils faits ces insoumis qui, en France ou à l’étranger, persistent à braver les lois écrites et non écrites ? On les traque, on les cloue au pilori et il arrive qu’on brûle leurs livres. Dans les medias, on les accable d’outrages et on ne les autorise pas à présenter leurs arguments ou leur défense.
Peu à peu, ces rebelles, ces réfractaires, ces refuzniks se voient contraints à la clandestinité, y compris sur Internet où ils sont depuis peu pourchassés.
Dès lors, comment le grand public les connaîtrait-il ?
À cette question le cas de Georges Theil offre un élément de réponse.
Né en 1940, Georges Theil fait en province de solides études. Il se forge même la réputation d’un surdoué des sciences et des lettres. Il voit s’ouvrir devant lui un avenir prometteur.
Toutefois, entre treize et vingt-deux ans, des événements tragiques sont venus marquer de leur sombre empreinte l’existence de l’adolescent et du jeune homme. Tardivement, on lui a révélé qu’en avril 1944 son père avait été tué dans des circonstances obscures soit par des Géorgiens sous uniforme allemand, soit par des miliciens français ; ce père ingénieur de son métier, avait été trouvé en possession d’une arme. Déjà, lors de la première guerre mondiale, le père de ce père avait, en 1916, trouvé une mort tragique au Tonkin ; il formait sur place des tirailleurs tonkinois pour les envoyer en France « tuer du Boche » dans le cadre de la Revanche. D’autres deuils frappent une famille qui semble comme marquée par le destin. La réaction du jeune homme est inattendue. Au lieu d’incriminer, comme le veut une certaine imagerie conventionnelle, les « Huns » ou les « Nazis » pour leur responsabilité supposée dans le déclenchement des deux guerres mondiales, il va s’interroger sur le mystère historique qui fait que, de 1870 à 1945, en l’espace de trois générations, Allemands et Français se soient ainsi entretués.
En tant que Français, c’est aux Français qu’il pose ses questions sur le sujet. Orphelin d’un père qui, lui-même, était pupille de la Nation, il demande : « Qui, en France, a bien pu vouloir cela ? » ou encore « Pourquoi a-t-on envoyé à la mort tant de Français pour tuer des Allemands ? » (À l’inverse, un jeune Allemand pourrait poser à ses compatriotes des questions équivalentes sauf que, dans le cas de la deuxième guerre mondiale, aucun Allemand, y compris Adolf Hitler, n’avait souhaité une guerre contre la France puisque c’est la France qui a cru devoir entrer en guerre contre lui).
Chez le jeune Georges d’autres questions s’ensuivent et notamment celle-ci «Pourquoi, après l’armistice du 8 mai 1945, a-t-il fallu déshonorer les Allemands ?» On peut, en effet, se demander de quel droit les bouchers du camp des vainqueurs ont jugé et condamné les vaincus dans un pays qu’ils avaient réduit en cendres et dont des millions d’habitants, à l’Est, étaient contraints à une affreuse déportation, dans des circonstances bien pires que celles qu’avaient connues les juifs.
En matière de cynisme et de pharisaïsme, on ne fait pas mieux que le procès de Nuremberg (1945-1946). Le vainqueur y juge le vaincu. Sa loi est rétroactive. Il institue la responsabilité collective. Il n’est « pas lié par les règles techniques de l’administration des preuves ». Il n’exige pas que « soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique » (sic). Les yeux fermés, il accorde valeur de preuve authentique à des milliers de rapports rédigés par des « commissions de crimes de guerre » françaises, britanniques, américaines, soviétiques, yougoslaves, polonaises, tchécoslovaques,…, et c’est ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, que les rapports de la police politique soviétique acquièrent valeur de « preuves authentiques » et ne peuvent être l’objet de contestation. D’ailleurs, quasiment rien ne peut être contesté en matière d’accusation dès lors que l’accusé appartient à une organisation «criminelle» ; tout au plus, l’individu relevant d’une telle organisation aura-t-il l’autorisation de plaider que, personnellement, il n’a joué aucun rôle dans ce crime. C’est ce qui explique que, de 1945 à nos jours, on a vu tant d’Allemands ou tant de «collabos» à la fois accepter ou paraître accepter l’existence du crime et contester une participation personnelle à ce crime. Il n’y avait – et il n’y a – là aucune hypocrisie ni aucune lâcheté de la part des accusés mais la simple soumission forcée à l’article 10 du Statut du tribunal militaire international. On n’avait pas – et on n’a pas – le droit de contester l’existence et le fonctionnement de chambres à gaz à Auschwitz mais on avait – et on a – le droit de dire : « Personnellement, je n’en ai pas vu ou je n’ai participé à aucun gazage ». Tous les avocats des accusés ont dû suivre cette calamiteuse ligne de défense. Comme dans les procès de sorcellerie, il leur a fallu cautionner l’existence du Malin, la réalité des sabbats, la véracité de toutes sortes d’horreurs sataniques tout en cherchant à faire croire que leurs clients, pourtant sur place ou informés, n’y avaient personnellement pris aucune part !
Les articles 10, 19 et 21 du Statut qui permettent ces ignominies seraient à reproduire en lettres d’infamie dans le Grand Livre de l’histoire des procès truqués, des mises en scène judiciaires, des parodies de justice.
Mais peut-être l’article 13 dépasse-t-il en la matière les articles 10, 19 et 21. Il est clair comme le couperet de la guillotine. Citons-le :
Le tribunal établira les règles de sa procédure. Ces règles ne devront en aucun cas être incompatibles avec les dispositions du présent Statut.
En bon français : les juges du siège rédigeront leur propre code de procédure pénale! Et ils pourront le faire de façon quasi arbitraire puisque, aussi bien, les dispositions du Statut se réduisent à trente articles assurant à l’accusation la plus grande latitude et à la défense le minimum de droits.
Le tribunal de Nuremberg n’a rien prouvé. Il a affirmé.
Le grand public l’ignore mais les spécialistes le savent : tous les procès exigés et obtenus depuis plus d’un demi-siècle par des organisations juives soit contre des Allemands, soit contre des non-Allemands qui sont accusés d’avoir collaboré à la persécution des juifs sont calqués sur le procès de Nuremberg. Encore au procès de Maurice Papon on a vu jouer l’article 10 : tout le monde a supposé, sans le moindre commencement de preuve, que le IIIe Reich avait suivi une politique d’extermination physique des juifs ; personne n’a contesté, protesté, réclamé de preuve. Les avocats de l’accusé, tout comme leur client, ont plié l’échine. Tout le monde savait qu’en exigeant une preuve, une seule preuve, on aurait déclenché une tempête à l’échelle du monde.
Aujourd’hui, en France, la version casher de l’histoire de la seconde guerre mondiale est officiellement imposée à tous par une disposition législative datant du 13 juillet 1990 et improprement appelée « loi Gayssot » alors qu’il s’agit d’une loi préparée et obtenue par Laurent Fabius. Dès le printemps 1986, le grand rabbin René-Samuel Sirat, flanqué de Pierre Vidal-Naquet et d’autres personnalités juives, avait demandé l’institution d’une loi spéciale afin d’empêcher la contestation des conclusions du procès de Nuremberg en matière de « crimes contre l’humanité », c’est-à-dire, pour parler clair, de « crimes contre les juifs ». Laurent Fabius a été le porte-parole et la courroie de transmission de cette exigence juive.
Bien des intellectuels préconisent la lutte contre le mensonge institutionnalisé et contre la force injuste de la loi mais peu s’y risquent effectivement.
Georges Theil, pour sa part, a choisi le risque. Il l’a fait en décidant de révéler ici comment et pourquoi il s’est lancé dans l’aventure révisionniste.
10 avril 2002