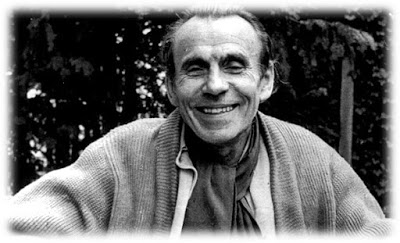Céline en joie
Le quatrième des Cahiers Céline[1] est en grande partie constitué d’inédits. En plus de quatre-vingt-deux lettres et cartes postales (dont une soixantaine d’Afrique même), on y découvre un sonnet libertin et un poème ou fragment de poème, tous deux datés de 1916, trente lignes d’une traduction de Kipling (?) et, enfin, une nouvelle, de ton enjoué, intitulée Des Vagues. Les négligences orthographiques, ainsi que je l’ai pour ma part toujours souhaité, sont respectées par l’éditeur ; certaines sont dignes d’un grand seigneur !
Pendant neuf mois, de fin juin 1916 au 2 avril 1917, Louis des Touches (de Lentillière) est surveillant, puis gérant de plantation au Cameroun. Son métier, son directeur, le climat, tout paraît plaire à ce jeune homme entreprenant que seuls des ennuis dus à sa blessure de guerre obligeront à regagner l’Europe. Sa soif d’activité et de connaissance est comparable à celle d’un Rimbaud, la joie et la générosité en plus. Il est médecin et ingénieur. Il se livre au commerce de l’ivoire et du cacao. D’Europe, ses nombreux amis (« Je ne me serais jamais cru aussi sympathique ») l’accablent de lettres et de cadeaux. L’immense culture de Céline n’a jamais été un secret pour les céliniens. Ici elle se découvre pleinement. Auteurs classiques ou modernes, les lectures du jeune homme sont impressionnantes. Les citations, manifestement faites de mémoire, abondent. On découvre qu’à Londres il fréquentait assidûment la section des manuscrits du British Museum. Il possède deux langues étrangères : l’anglais et l’allemand. Pour ce qui est de ses qualités de cœur, je recommande de lire la lettre du 20 août 1916 où, d’une façon drôle et émouvante, il explique pourquoi il ne saurait prendre maîtresse parmi les noires. Il se méfie du soleil, qu’il juge « froidement mortel », et de l’alcool, qui « dissocie les globules du sang », tandis que l’eau, elle, les « associe ». Il répugne à la quantité, qui est « fixe », et il recherche la qualité, qui est « variable et imprévisible » : du Bergson en quelque sort. « S’il y avait beaucoup de Bergson, la vie, ma bien chère Simone, serait plus douce, je vous le dis ». La guerre ainsi que la propagande débitée contre les Boches le dégoûtent. Héroïsme et patriotisme sont des impostures. Malgré tout, il aime son pays. Il croit à l’amélioration de la destinée humaine. Il croit au progrès, malgré les tueries.
Progrès[2] : tel est le titre narquois qu’il donnera dix ans plus tard à une pochade bouffonne en quatre tableaux, jusqu’ici inédite. Aux animateurs de cafés-théâtres en mal de texte à représenter, je signale cette farce subtile, qui est faussement languissante en son début et qui prend ensuite tournure de façon ébouriffante. D’un salon bourgeois assez cossu on passe à une maison de rendez-vous pour finir au ciel. Les personnages sont Gaston La Garenne, perpétuellement anxieux ou furieux, sa tendre épouse Marie, sa belle-mère, Mme Punais, qui pousse Marie à cocufier Gaston avec leur voisin, M. Berlureau, employé de ministère et pianiste (un pianiste chauve). Il y a encore la vieille et gaie Mme Doumergue, artiste de l’âme, décidée depuis toujours à arriver vierge au Bon Dieu, une « madame » avec ses « poules » (« c’est pas un bordel ici »), une troupe de clients venus voir et non consommer (« Ils sont impossibles ces types-là, ils n’y touchent pas, c’est des peintres »). Survient une splendide Américaine, venue voir elle aussi. Elle se dénude, elle danse, elle disparaît. Gaston en est « berlue ». Il en oublie le ministère Cropichon (tous des francs-maçons). Il oublie ses persécuteurs : Lempreinte, Larpentin, Sacharn et Palotin. La beauté existe sur cette terre : tel est le message du Nouveau Monde. On peut croire que la vie conjugale de Gaston connaîtra quelque amélioration. D’un trou du ciel, un brave homme de Bon Dieu, flanqué de Mme Doumergue qu’il a rappelée à lui et flanqué aussi d’un coucou mécanique en guise de Saint-Esprit, contemple Gaston et Marie goûtant un « bonheur précieux » à deux pas de l’Opéra, du côté du passage Choiseul.
Progrès est un exemple de ces fantaisies légères que Céline a toujours appelées de ses vœux. Dans une lettre d’Afrique, il cite Urbain Gohier : « La littérature française de demain devrait être purement française c’est à dire vive, saine, gaie réconfortante ». Progrès témoigne par ailleurs d’un sens aigu du jeu de scène comique, de la fantaisie propre au théâtre (chœurs de bouffons portant loups et dominos, pantins à l’unanimité mécanique, deus ex machina). L’accompagnement musical est très varié : chansons, dites populaires, au texte énigmatique, air de ronde « américain et foxtrotesque », « musique céleste » avec « harpes, harmonium et un peu de banjo. Tout cela « rêveur » (Céline y insiste).
Ces deux inédits apportent, somme toute, une éclatante confirmation à ceux que frappaient, chez Céline, son goût de la vie, son sens de la beauté, ses capacités d’enthousiasme et ce qu’il trouvait d’ailleurs en lui-même d’« un peu con », entendez par là d’un peu « naïf ». Plus tard, même dans l’expression du désespoir, on sentira chez ce faux misanthrope, ce râleur, ce nihiliste, un cœur chaud et généreux, une âme vive, un poète, un artiste. Quelle disgrâce, pour certains professeurs notamment, d’avoir fait de Céline un homme de « nausée », une sorte de Sartre «existenglaireux» ![3]
Citation (à propos du prince Catulesco) : « Son pensoir d’élection était le Pont des Arts » (p. 195).
31 décembre 1978
___________
[1] Cahiers Céline, 4 (« Lettres et premiers écrits d’Afrique, 1916-1917 »), N.R.F., Gallimard, janv. 1978, 214 p., 39F.
[2] Progrès, Mercure de France (Éditions Gallimard), 1er trimestre 1978, env. 126 pages (petit format) non numérotées.
[3] L’annotateur ou présentateur de ces deux inédits a multiplié les recherches érudites. On doit lui en savoir gré. Il lui arrive toutefois de commettre de lourdes erreurs. Certaines ont déjà été relevées par Jean Mistler (L’Aurore, 21 fév. 1978, « Céline en Afrique »). J’en vois d’autres. Par exemple, p. 144 et 203, Céline se voit reprocher par l’annotateur d’avoir écrit «Tircis» pour « Thyrsis » qui est, dit-il, la véritable orthographe du nom du personnage de Virgile. Il n’y a qu’un malheur pour cet annotateur (qui me paraît souvent hostile à Céline), c’est que Céline songeait ici à Racan et non à Virgile («Tircis, il faut penser à faire la retraite»). D’autre part, dans Progrès, Céline ne dénonce pas « les méfaits du progrès » ! C’est là prendre une œuvre à contresens !